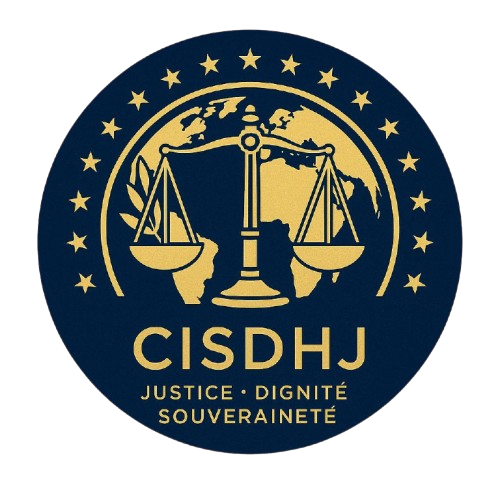Tribunaux de commerce
Code de commerce et tribunaux de commerce : l’une des plus grandes fraudes institutionnelles de la République
Ce que vous allez découvrir n’est pas une simple irrégularité juridique, mais une fraude d’État d’une ampleur historique. Derrière le vernis d’une justice commerciale apparemment légitime se dissimule un édifice entièrement illégal, bâti sur des fondements juridiques inexistants, des ordonnances jamais ratifiées, des lois abrogées, des juridictions fantômes et des professionnels de justice sans statut valide. Depuis plus de quarante ans, le Code de commerce et les tribunaux de commerce opèrent dans l’illégalité la plus totale, en parfaite contradiction avec la Constitution et les principes fondamentaux de l’État de droit.
Chaque jour, des milliers d’entreprises sont jugées, liquidées, saisies, ou expropriées par des institutions qui n’ont aucune existence légale. Ce que l’on appelle « justice commerciale » n’est rien d’autre qu’une juridiction d’exception imposée au peuple, une justice parallèle créée pour servir les intérêts des grandes banques, des mandataires judiciaires, des élites économiques et d’une classe politique complice. Le système est verrouillé, dissimulé, présenté comme normal — mais il repose sur une imposture totale.
Cette page révèle l’un des plus grands scandales juridiques de la Ve République. Elle démontre, texte par texte, décret par décret, loi par loi, comment la France a instauré un appareil judiciaire parallèle en violation directe de la souveraineté nationale. Loin d’être un outil de justice, le droit commercial français tel qu’il est appliqué aujourd’hui est devenu un instrument d’arbitraire, de violence institutionnelle et de confiscation organisée du tissu économique. Ce que vous vous apprêtez à lire ne relève pas de la critique : c’est une alerte démocratique majeure. La République est hors-la-loi. Et il est temps que cela soit dit clairement.
Sommaire
- Origines historiques et dérive normative : les fondements ébranlés des juridictions commerciales
- Le décret n°78‑329 du 16 mars 1978 : acte fondateur d’un coup de force juridique inconstitutionnel
- La loi du 16 juillet 1987 : dissimulation progressive et effacement des fondements législatifs
- La loi du 17 décembre 1991 : l’aveu d’un effondrement juridique
- La tentative de régularisation par ordonnance : une fraude aggravée entre 2000 et 2009
- L’inexistence juridique des tribunaux de commerce: une juridiction sans base légale
- Une autorité sans fondement : l’irrégularité structurelle des juges consulaires des tribunaux de commerce
- Nullité absolue des décisions rendues par les juridictions commerciales
- Violations légales et constitutionnelles
- Les conséquences dramatiques des manœuvres frauduleuses : une spoliation systématique et des vies brisées
- Conclusions sur l’illégalité des tribunaux de commerce, du Code de l’organisation judiciaire, du Code de commerce
- La responsabilité de l’État et des institutions judiciaires
- La trahison organisée : comment les partis politiques ont confisqué la démocratie et détruit la souveraineté populaire
- Conclusion générale – Une République hors-la-loi : la France est administrée par des institutions juridiquement inexistantes
Origines historiques et dérive normative : les fondements ébranlés des juridictions commerciales
Institués par le Code de commerce napoléonien de 1807, les tribunaux de commerce reposaient à l’origine sur une base législative solide, inscrite dans un code formellement adopté par le législateur. Ces juridictions spécialisées, composées de juges élus parmi les commerçants, avaient pour mission de trancher les litiges entre professionnels du commerce dans un cadre juridiquement encadré. Pendant plus d’un siècle, leur statut est resté stable, bien que progressivement complété par d’autres textes régissant la procédure ou l’organisation judiciaire.
Mais à partir des années 1970, un processus discret mais déterminant a progressivement démantelé la légalité de ces juridictions. Ce mouvement n’a pas consisté en une refonte claire, débattue et assumée par le Parlement, mais en une série de substitutions normatives, opérées en grande partie par des actes réglementaires. Le point de bascule se situe dans la loi n°72‑626 du 5 juillet 1972, qui autorise la création d’un Code de l’organisation judiciaire (COJ). Son article 15 dispose que la codification des textes relatifs à l’organisation judiciaire pourra être réalisée par décrets en Conseil d’État, à condition que ceux-ci n’apportent aucune modification de fond aux textes législatifs existants.
C’est sur ce fondement ambigu que le gouvernement a prétendu, en 1978, instituer par décret la partie « législative » du COJ. Mais en réalité, le décret n°78‑329 du 16 mars 1978 est allé bien au-delà d’un simple travail de codification ou d’adaptation formelle : il a créé de nouvelles dispositions, abrogé des lois existantes et substitué des articles législatifs par voie réglementaire, notamment ceux du Code de commerce concernant les juridictions commerciales.
Ainsi, sous couvert d’une codification technique autorisée par l’article 15 de la loi de 1972, l’exécutif a en réalité opéré une modification de fond du droit applicable, sans passer par le Parlement. Cette manœuvre marque le début d’une dérive normative majeure, où les bases juridiques des tribunaux de commerce vont être peu à peu effacées, déplacées ou remplacées en dehors de tout cadre constitutionnel régulier.
La section suivante est consacrée à ce décret de 1978, dont l’analyse révèle l’ampleur de la fraude juridique commise sous couvert de codification.
Le décret n°78‑329 du 16 mars 1978 : acte fondateur d’un coup de force juridique inconstitutionnel
En 1978, un acte réglementaire est venu bouleverser l’ordre juridique républicain de manière inédite : le décret n°78‑329 du 16 mars 1978. Ce texte, signé par le gouvernement, prétend « instituer » la partie législative du Code de l’organisation judiciaire (COJ), en y intégrant directement les dispositions relatives aux tribunaux de commerce, et en abrogeant simultanément plusieurs articles du Code de commerce ainsi que des lois historiques fondamentales. Cette opération, menée sans habilitation parlementaire explicite et en contradiction flagrante avec les articles 34 et 38 de la Constitution, constitue un cas manifeste d’usurpation du pouvoir législatif par le pouvoir exécutif.
L’article 1er du décret expose sans détour la portée anticonstitutionnelle de l’acte :
« Il est institué une première partie du code de l’organisation judiciaire (partie législative) dans laquelle sont insérées les dispositions annexées au présent décret. Ces dispositions se substituent, dans les conditions prévues à l’article 34 de la Constitution et à l’article 15 de la loi n°72-626 du 5 juillet 1972, aux dispositions législatives suivantes : Code de commerce : articles 624 (partie), 630, 631, 634, 636 à 638 et 640 ; Loi des 16-24 août 1790… »
Ce décret réglementaire prétend donc abroger des lois en vigueur et les remplacer par des dispositions émanant du seul pouvoir exécutif. Or, seul le Parlement a compétence pour adopter, modifier ou abroger une loi. En usant de la formule « se substituent », le gouvernement a franchi une limite constitutionnelle majeure, violant directement le principe de séparation des pouvoirs.
Le chapitre Ier du livre IV de ce décret crée notamment les articles L.411‑1 et suivants du COJ, définissant les tribunaux de commerce. Il en résulte une incohérence normative : dès mars 1978, deux corpus législatifs distincts (le Code de commerce et le COJ) comportent simultanément des dispositions sur les juridictions commerciales, sans qu’aucune loi claire n’ait tranché cette dualité.
Ce basculement a été justifié de manière abusive par l’article 15 de la loi n°72‑626, lequel autorisait une simple adaptation formelle dans le cadre d’une codification technique, à l’exclusion expresse de toute modification de fond. Le gouvernement a donc détourné le sens de cette habilitation, mettant en place une réforme structurelle du droit judiciaire en dehors de tout contrôle démocratique.
Le décret du 16 mars 1978 constitue ainsi la pierre angulaire d’un système illégal : il est à l’origine de la situation actuelle des juridictions commerciales, créées par voie réglementaire, sans base législative valide. Il marque l’entrée de la justice commerciale dans une zone de non-droit, où la légalité formelle est remplacée par une légalité apparente. Ce procédé relève d’une fraude constitutionnelle caractérisée.
En conséquence, toutes les décisions, procédures et condamnations rendues depuis cette date dans le cadre des tribunaux de commerce reposent sur un socle juridique nullissime, dépourvu de valeur au regard des principes fondamentaux du droit public.
La loi du 16 juillet 1987 : dissimulation progressive et effacement des fondements législatifs
Prétendument destinée à moderniser le droit judiciaire commercial, la loi n°87‑550 du 16 juillet 1987 dissimule en réalité une opération de blanchiment législatif : loin de rétablir une base légale claire pour les juridictions commerciales, elle vient entériner le coup de force juridique opéré par le décret illégal du 16 mars 1978. Ce décret, inconstitutionnel dans sa nature comme dans sa portée, avait inséré au sein du Code de l’organisation judiciaire (COJ) des articles créant les tribunaux de commerce, sans fondement parlementaire valide. Plutôt que de corriger cette usurpation, la loi de 1987 la couvre et la valide a posteriori, sans jamais restaurer les fondements juridiques supprimés.
En apparence, cette loi se borne à reprendre les articles L.411‑1 à L.414‑7 du COJ relatifs aux tribunaux de commerce. Mais ce faisant, elle accepte tacitement que ces articles aient été introduits par décret, ce qui constitue une violation manifeste des articles 34 et 38 de la Constitution. En l’absence de toute habilitation législative pour légiférer par voie réglementaire dans ce domaine, le simple fait de transposer les effets d’un décret dans une loi postérieure revient à consacrer une fraude à la séparation des pouvoirs.
Pire encore, l’article 25 de cette même loi procède à une opération de dissimulation normative en abrogeant plusieurs articles clés du Code de commerce (articles 624, 627 à 629, 644), tout en supprimant aussi l’intitulé des titres Ier, III et IV du Livre IV, sans supprimer explicitement tous les articles qu’ils contenaient. Cette suppression de l’intitulé sans abrogation franche des articles est une méthode de brouillage juridique délibérée, dont les objectifs sont clairs :
1. Effacer les traces de l’abrogation réelle sans alerter : En supprimant uniquement les intitulés, le législateur a évité d’attirer l’attention sur la disparition réelle du fondement législatif des tribunaux de commerce dans le Code de commerce. Si les articles avaient été purement et simplement supprimés, la nullité de ces juridictions aurait été flagrante. En choisissant une méthode d’effacement partiel, le gouvernement a masqué l’ampleur de la rupture juridique.
2. Entretenir une illusion de continuité : Le maintien de certains articles ou fragments dans un code amputé de ses titres permet de créer une illusion de stabilité législative. Cela empêche les citoyens, les praticiens et même certains juristes de réaliser que les bases juridiques de cette juridiction ont été méthodiquement démantelées, puis remplacées sans débat parlementaire par des textes réglementaires illégaux.
3. Masquer l’illégalité du processus : Une abrogation explicite et complète aurait exposé au grand jour l’absence totale de fondement légal des tribunaux de commerce. À l’inverse, cette suppression feutrée des intitulés autorise un glissement vers une légalité fictive, permettant à ces juridictions de continuer à exister en apparence, tout en reposant en réalité sur une base abolie ou déplacée illégalement.
Conséquences juridiques majeures : La suppression des intitulés des titres du Code de commerce revient, juridiquement, à acter la disparition des tribunaux de commerce dans leur code d’origine. À partir du 16 juillet 1987, leur existence repose donc exclusivement sur des dispositions introduites dans le COJ par un décret inconstitutionnel, le n°78‑329 du 16 mars 1978. Ce transfert, opéré sans débat parlementaire ni habilitation explicite, constitue une fraude législative manifeste. Il s’agit d’un coup d’État administratif masqué sous l’apparence d’une modernisation juridique.
La loi du 16 juillet 1987 ne constitue donc en rien une validation légale des tribunaux de commerce. Elle en prolonge la fiction juridique, en dissimulant leur suppression par une série de manipulations techniques. En légalisant les conséquences d’un décret anticonstitutionnel, sans corriger son illégalité ni restaurer la souveraineté législative du Parlement, elle participe activement à la construction d’un ordre juridictionnel parallèle, non conforme à l’État de droit.
La loi du 17 décembre 1991 : l’aveu d’un effondrement juridique
Avec la loi n°91‑1258 du 17 décembre 1991, le législateur tente un exercice périlleux : faire croire à une régularisation des juridictions commerciales, tout en perpétuant la confusion normative et l’illégalité initiale. Cette loi, loin de réparer les violations constitutionnelles précédentes, consacre en réalité un non-sens juridique et institutionnalise une contradiction majeure. L’article 3 de cette loi affirme que « les dispositions contenues dans la partie législative du Code de l’organisation judiciaire ont force de loi ». Mais ces dispositions ne sont pas issues d’un texte législatif adopté par le Parlement ; elles proviennent directement du décret n°78‑329 du 16 mars 1978, un acte réglementaire inconstitutionnel, pris sans aucune habilitation parlementaire conforme à l’article 38 de la Constitution.
Accorder rétroactivement à un décret une valeur législative revient à entériner une violation manifeste de la hiérarchie des normes. Cela revient à blanchir, a posteriori, un acte de l’exécutif qui a usurpé la fonction législative. Il s’agit ni plus ni moins que d’une fraude à la procédure parlementaire, et d’une violation caractérisée du principe de séparation des pouvoirs. Le Parlement, au lieu de légiférer, se contente ici d’avaliser les conséquences d’un acte illégal, sans produire un texte nouveau ni ouvrir un débat public sur le fond.
Mais l’absurdité ne s’arrête pas là. Le même article 3 de la loi du 17 décembre 1991 précise que sont simultanément abrogées les dispositions issues des articles 1er et 2 du décret de 1978. En d’autres termes, la loi prétend donner valeur législative à des articles tout en les supprimant dans le même temps. Cette contradiction interne invalide l’ensemble du dispositif. Une disposition ne peut être investie de force législative si elle est abrogée dans le même souffle : elle n’existe déjà plus juridiquement. Il s’agit là d’un effondrement logique du droit, d’une incohérence majeure qui ruine toute prétention à la légalité.
La gravité de cette manœuvre s’apprécie pleinement à la lumière de la loi du 16 juillet 1987, qui avait déjà amorcé un processus de dissimulation des fondements des tribunaux de commerce. Cette loi avait abrogé plusieurs articles clés du Code de commerce (notamment les articles 624, 627 à 629 et 644), et supprimé les intitulés des titres Ier, III et IV du Livre IV, supprimant ainsi les références explicites aux juridictions commerciales dans leur code d’origine.
Or, la loi du 17 décembre 1991 n’a pas rétabli ces articles, ni dans le Code de commerce, ni ailleurs. Elle n’a pas non plus légiféré directement pour donner aux tribunaux de commerce un nouveau fondement légitime. Pire encore, elle abroge les dispositions du décret de 1978 qui, bien que juridiquement viciées, étaient les seules à mentionner explicitement les tribunaux de commerce dans le Code de l’organisation judiciaire. On se retrouve donc face à une situation de vide juridique intégral.
En prétendant valider un décret inconstitutionnel tout en le supprimant, la loi de 1991 consacre l’aveu d’un échec institutionnel total : l’impossibilité pour les autorités de rétablir la légalité sans enfreindre une nouvelle fois la Constitution. C’est également une illustration parfaite de ce que l’on peut qualifier de stratégie de blanchiment législatif par contradiction normative, consistant à faire semblant de consolider un droit inexistant, tout en effaçant ses derniers fondements. Il ne s’agit pas d’une maladresse rédactionnelle, mais d’un procédé volontairement confus, destiné à masquer l’illégalité fondamentale des juridictions commerciales.
Ainsi, loin de rétablir une quelconque légitimité, la loi du 17 décembre 1991 parachève un processus de destruction juridique : à son issue, les tribunaux de commerce ne disposent plus d’aucun fondement valide, ni dans le Code de commerce, ni dans le Code de l’organisation judiciaire. Toute leur prétendue existence repose uniquement sur l’héritage d’un décret inconstitutionnel, désormais abrogé. Ce que la loi a voulu dissimuler en 1987, la loi de 1991 l’enterre définitivement, en créant une fiction normative sans contenu légal. Depuis cette date, l’ensemble de la justice commerciale française fonctionne sur une base inexistante — une imposture institutionnelle d’une gravité exceptionnelle. les tribunaux de commerce ont dès lors été maintenus dans un vide juridique, reposant sur des textes inopposables
La tentative de régularisation par ordonnance : une fraude aggravée entre 2000 et 2009
Face au vide juridique causé par les abrogations successives opérées en 1987 et 1991, le pouvoir exécutif entreprend, à partir de l’an 2000, une nouvelle tentative de légitimation du Code de commerce et des juridictions consulaires. Cette opération s’appuie d’abord sur l’ordonnance n°2000‑912 du 18 septembre 2000, prise sur le fondement de la loi d’habilitation n°99‑1071 du 16 décembre 1999. Cette loi autorisait le gouvernement à procéder par ordonnance à la codification à droit constant de certains textes, dont ceux du Code de commerce. L’article 1er de cette loi imposait expressément que les dispositions codifiées soient celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances.
Or, au 18 septembre 2000, aucune des dispositions relatives aux tribunaux de commerce n’était encore en vigueur. Elles avaient toutes été soit abrogées par la loi du 16 juillet 1987, soit supprimées par la loi du 17 décembre 1991. Le décret de 1978, qui avait tenté d’introduire dans le Code de l’organisation judiciaire des articles relatifs aux juridictions commerciales, avait été expressément abrogé par la loi de 1991. En conséquence, l’ordonnance de 2000 ne pouvait valablement codifier que du vide juridique. Codifier à droit constant un droit inexistant constitue un détournement de procédure et une violation manifeste de la loi d’habilitation.
Une ratification illégale et frauduleuse : la dissimulation de la caducité de l’ordonnance de 2000
L’ordonnance n°2000‑912 du 18 septembre 2000, censée établir la partie législative du Code de commerce, a été prise en application de la loi d’habilitation n°99‑1071 du 16 décembre 1999. Cette loi encadrait strictement le recours aux ordonnances, notamment par l’exigence impérative d’un projet de loi de ratification déposé et adopté dans un délai déterminé. Or, bien que ce projet ait été déposé à l’Assemblée nationale le 15 novembre 2000, il n’a jamais été inscrit à l’ordre du jour. À la dissolution de la législature en 2002, il est devenu caduc.
Le Sénat lui-même reconnaît explicitement ce principe : « Les projets de loi dont l'Assemblée nationale était encore saisie au moment où ses pouvoirs ont expiré deviennent caducs, qu'ils aient ou non fait l'objet d'une ou de plusieurs lectures devant l'une des assemblées du Parlement ». Autrement dit, à compter de 2002, l’ordonnance n°2000‑912 a perdu toute validité juridique, faute de ratification régulière.
Pourtant, loin d’admettre cette nullité, le gouvernement a entrepris une manœuvre législative frauduleuse. Il a inséré, dans la loi n°2003‑7 du 3 janvier 2003, un article 50 prétendant ratifier l’ordonnance de 2000. Cette tentative postérieure de ratification viole le cadre fixé par l’article 38 de la Constitution : la ratification doit intervenir dans les délais et ne peut s’accompagner d’aucune modification. Or, non seulement cette prétendue ratification est intervenue plus de deux ans après l’expiration du délai, mais elle a également modifié le Code de commerce, ce qui est contraire au principe d’une ratification « pure et simple ».
Le rapport parlementaire n°752, enregistré à l’Assemblée nationale le 26 mars 2003, reconnaît d’ailleurs que le projet de ratification initial est devenu caduc, et que la loi n°2003‑7 tente d’y substituer une validation rétroactive. Mais cette substitution viole non seulement la loi d’habilitation, mais aussi les principes constitutionnels de sécurité juridique et de séparation des pouvoirs.
Une ratification tronquée : l’annexe non ratifiée et le Code de commerce incertain
La supercherie ne s’arrête pas là. L’article 50 de la loi de 2003 ne ratifie que l’ordonnance de 2000 – sans mention explicite de son annexe, laquelle contient pourtant l’intégralité du texte du Code de commerce. Dès lors, même si l’on admettait la validité de cette ratification tardive (ce qui est exclu), elle ne concernerait que le corps de l’ordonnance, et non le contenu même du Code qu’elle entendait instaurer. Le texte codifié demeure donc dépourvu de toute valeur juridique.
Pis encore, cet article 50 modifie le Code de commerce, alors même que celui-ci – en tant qu’annexe à une ordonnance caduque – n’a jamais été ratifié ni authentifié par une publication officielle régulière au Journal officiel. En l’absence d’une republication conforme, toutes les modifications postérieures sont entachées d’irrégularité, car elles reposent sur un texte fantôme.
Une invalidité définitive : le Code de commerce n’existe pas juridiquement
En résumé, la loi du 3 janvier 2003 n’a pas pu sauver l’ordonnance n°2000‑912, ni en droit, ni en fait. La tentative de validation rétroactive par une ratification frauduleuse, couplée à des modifications illégales du texte, démontre une violation manifeste de la Constitution et de la loi d’habilitation. Le Code de commerce tel qu’il est appliqué aujourd’hui repose donc sur un fondement inexistant.
Il en résulte que l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux de commerce, les actes produits par les greffiers, administrateurs et mandataires judiciaires, ainsi que les agréments ou inscriptions fondés sur ce code, sont viciés d’illégalité. Cette fraude législative, soigneusement dissimulée, constitue une des atteintes les plus graves à l’État de droit de la Ve République.
Il ne s’agit pas d’un simple vice de procédure. C’est un coup d’État administratif, un effondrement volontaire des garanties juridiques de la Nation, orchestré par ceux-là mêmes qui prétendent défendre la légalité républicaine.
L’ordonnance de 2000 vient pourtant entériner l’abrogation de dispositions « fantômes », en tentant de recréer une architecture normative autour de juridictions supprimées. C’est dans cette logique que l’article 127 de la loi n°2001‑420 du 15 mai 2001 modifie les articles L.411‑1 et L.411‑4 à L.411‑7 du Code de l’organisation judiciaire. Ces articles, issus à l’origine du décret inconstitutionnel de 1978, avaient été abrogés par la loi du 17 décembre 1991. Leur réintroduction en 2001, par voie législative, tente d’installer rétroactivement une base légale aux tribunaux de commerce. Mais une norme abrogée ne peut renaître que par une loi qui la rétablit expressément, dans des conditions de régularité. En l’espèce, la loi du 15 mai 2001 modifie des articles qui, juridiquement, n’existent plus, et le fait dans la continuité d’une ordonnance qui viole sa propre habilitation. Il s’agit donc d’une opération de camouflage législatif, visant à effacer les effets de la disparition légale des juridictions consulaires.
L’ordonnance de 2000 vient pourtant entériner l’abrogation de dispositions « fantômes », en tentant de recréer une architecture normative autour de juridictions supprimées. C’est dans cette logique que l’article 127 de la loi n°2001‑420 du 15 mai 2001 modifie les articles L.411‑1 et L.411‑4 à L.411‑7 du Code de l’organisation judiciaire. Ces articles, issus à l’origine du décret inconstitutionnel de 1978, avaient été abrogés par la loi du 17 décembre 1991. Leur réintroduction en 2001, par voie législative, tente d’installer rétroactivement une base légale aux tribunaux de commerce. Mais une norme abrogée ne peut renaître que par une loi qui la rétablit expressément, dans des conditions de régularité. En l’espèce, la loi du 15 mai 2001 modifie des articles qui, juridiquement, n’existent plus, et le fait dans la continuité d’une ordonnance qui viole sa propre habilitation. Il s’agit donc d’une opération de camouflage législatif, visant à effacer les effets de la disparition légale des juridictions consulaires.
Cette manœuvre se poursuit avec l’ordonnance n°2006‑673 du 8 juin 2006, prise en vertu de l’article 92 de la loi n°2004‑1343 du 9 décembre 2004. Cette ordonnance vise à refondre le Code de l’organisation judiciaire en abrogeant à nouveau les articles L.411‑2 et suivants, censés régir les tribunaux de commerce, et à les déplacer vers le Code de commerce sous les articles L.721‑1 à L.724‑7. L’article 2 de cette ordonnance réécrit ainsi entièrement le titre II du livre VII du Code de commerce. L’article 4 prévoit que certaines abrogations ne prendront effet qu’à l’entrée en vigueur du décret portant partie réglementaire du Code de commerce. Cela introduit une forme de transition conditionnelle qui masque une réalité : l’ordonnance 2006‑673 prétend refondre des dispositions qui ont déjà été abrogées à deux reprises, et dont la validité initiale reposait sur un décret inconstitutionnel.
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance, déposé au Sénat le 30 août 2006, n’a jamais été adopté. Conformément aux règles parlementaires, la fin de la législature en juin 2007 a rendu ce projet de loi caduc. L’ordonnance, non ratifiée dans les délais, est donc privée de valeur législative. Pourtant, loin de renoncer à sa stratégie, le gouvernement introduit en mai 2009 un dispositif encore plus problématique : l’article 138 de la loi n°2009‑526 du 12 mai 2009 opère une ratification globale de 38 ordonnances, dont celle du 8 juin 2006. Cet article, véritable opération de blanchiment législatif, ratifie massivement des ordonnances hors délais, souvent en les modifiant au sein du même texte, ce qui contrevient au principe de séparation des pouvoirs et à l’exigence de clarté de la loi.
Cette pseudo-ratification postérieure ne saurait pallier l’irrégularité initiale. En premier lieu, la loi du 9 décembre 2004 imposait un délai strict de trois mois pour le dépôt du projet de ratification. Ce délai a été violé. Ensuite, la ratification de 2009 intervient sans débat spécifique sur chacune des ordonnances concernées, et parfois en modifiant leur contenu, ce qui transforme l’acte de ratification en une recréation déguisée. Enfin, plusieurs articles abrogés à répétition, notamment ceux relatifs aux juridictions commerciales dans le COJ, sont à nouveau modifiés, malgré leur absence de base légale. Ces procédés cumulatifs de substitution, d’effacement et de transposition ne produisent pas d’effet régulier. Ils démontrent, au contraire, l’impossibilité juridique de régulariser un décret inconstitutionnel ou des textes abrogés depuis plusieurs années.
Ainsi, de 2000 à 2009, tous les mécanismes mis en œuvre par les pouvoirs publics pour tenter de recréer une base légale aux tribunaux de commerce échouent à restaurer la légalité. Le recours aux ordonnances hors délai, à la codification de normes abrogées, à la manipulation des échéances parlementaires, et à la ratification globale postérieure constitue une fraude constitutionnelle aggravée. Cette séquence législative ne corrige rien : elle aggrave l’irrégularité en donnant l’illusion d’une légalité retrouvée, alors que les fondements mêmes des juridictions consulaires et de l’organisation judiciaire ont disparu ou n’ont jamais existé validement.
L’inexistence juridique des tribunaux de commerce: une juridiction sans base légale
Après avoir retracé l’enchaînement des textes illégaux, des abrogations ignorées et des tentatives de régularisation manquées, le constat est sans appel : les tribunaux de commerce, tels qu’ils fonctionnent aujourd’hui, ne reposent sur aucun fondement juridique valide. Leur prétendue légalité repose sur une succession de décrets inconstitutionnels, d’ordonnances non ratifiées, et de lois qui ont soit été abrogées, soit violé la hiérarchie des normes. Aucune base législative claire, continue et conforme à la Constitution ne justifie leur existence actuelle.
Cette situation n’est pas un simple oubli législatif ou une imprécision rédactionnelle. Elle traduit une dérive structurelle, où des juridictions exerçant des prérogatives majeures — liquidation d’entreprises, désignation de mandataires, expropriations — agissent dans un vide normatif absolu. Depuis la suppression des fondements législatifs en 1987 et 1991, aucun texte n’est venu rétablir valablement l’existence des juridictions commerciales. Les rares tentatives postérieures, qu’il s’agisse des ordonnances de 2000 ou 2006, ou encore de la loi de 2009, sont toutes entachées d’irrégularité ou de caducité manifeste.
Il en résulte une situation juridique gravissime : ces tribunaux n’ont jamais été valablement institués par la loi au sens de l’article 34 de la Constitution. Les juges consulaires, désignés au sein d’une juridiction inexistante, exercent une autorité qu’aucun texte valable ne leur confère. Leurs décisions sont rendues au nom d’une justice fictive, construite sur des ruines normatives et maintenue par la seule inertie administrative et institutionnelle.
Dans un État de droit, une telle situation ne peut être tolérée. Être jugé par une juridiction instituée par la loi n’est pas une option : c’est un droit fondamental, garanti tant par la Constitution française que par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. En poursuivant leurs activités malgré l’effondrement juridique de leur base, les tribunaux de commerce violent ce droit, compromettent la légitimité des décisions rendues, et exposent les citoyens à une justice d’exception sans cadre légal.
C’est à partir de ce constat, déjà insoutenable en soi, que découle logiquement la conséquence suivante : la nullité absolue et irréfragable de toutes les décisions rendues par ces juridictions fantômes.
Une autorité sans fondement : l’irrégularité structurelle des juges consulaires des tribunaux de commerce
Les magistrats siégeant dans les tribunaux de commerce, appelés juges consulaires, sont présentés comme des auxiliaires de justice élus par leurs pairs au sein du monde entrepreneurial. Ils ne sont pas issus de l’École nationale de la magistrature, ne prêtent pas serment devant une juridiction judiciaire indépendante, et n’exercent pas leurs fonctions en vertu d’un véritable statut légal de magistrat. Ce modèle, souvent défendu comme garant d’une "justice de proximité économique", masque en réalité une anomalie juridique et institutionnelle d’une gravité extrême. Car ces juges ne disposent d’aucune assise constitutionnelle, d’aucune formation impérative reconnue, et surtout, d’aucune base législative valide permettant de justifier l’existence même de leurs fonctions depuis plus de quarante ans.
Le premier problème tient à leur mode de désignation. Les juges consulaires ne sont ni nommés par décret, ni désignés sur concours, ni soumis à un processus d’assermentation sous contrôle judiciaire indépendant. Leur élection par d’autres commerçants ne garantit ni l’impartialité, ni l’indépendance, ni l’expertise juridique. Ces magistrats auto-désignés peuvent être amenés à juger des concurrents, des partenaires, voire d’anciens associés. Ce conflit d’intérêts structurel viole les exigences fondamentales de neutralité imposées par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui exige que tout justiciable soit entendu par un tribunal impartial, établi par la loi.
À cela s’ajoute un second problème majeur : leur statut repose entièrement sur des textes qui ont été abrogés, ou jamais valablement institués. Le décret n°78‑329 du 16 mars 1978, qui a prétendu créer les articles L.411‑1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire, est radicalement inconstitutionnel. Un décret, même pris en Conseil d’État, ne peut créer une partie législative à un code judiciaire, encore moins instituer une catégorie de magistrats. Or, c’est sur ce décret que repose encore aujourd’hui toute la prétendue légalité des juges consulaires. La loi n°87‑550 du 16 juillet 1987, en supprimant les titres du Code de commerce relatifs aux juridictions commerciales, a effacé toute référence légale à ces fonctions. La loi n°91‑1258 du 17 décembre 1991 a aggravé la situation en abrogeant les articles issus du décret de 1978, sans les remplacer, instaurant un vide juridique définitif.
Depuis ces abrogations, aucune loi n’est venue rétablir valablement un statut ou une organisation juridiquement contraignante des juges consulaires. Ni l’ordonnance de 2000, ni celle de 2006, ni la loi de ratification globale de 2009 ne rétablissent ce socle indispensable à leur existence légale. Ces textes sont eux-mêmes viciés, soit pour avoir été pris en dehors du champ de l’habilitation parlementaire, soit pour avoir été ratifiés hors délais ou de manière frauduleuse. En l’absence de toute base normative claire, cohérente et constitutionnelle, les fonctions exercées par les juges consulaires ne reposent sur rien d’autre qu’une fiction administrative entretenue par inertie.
Cette situation n’est pas sans conséquences. Elle implique la nullité de toutes les désignations opérées depuis 1978, la nullité des décisions rendues par ces magistrats irrégulièrement institués, et l’inopposabilité de tous les actes de procédure engagés dans le cadre de juridictions fondées sur un texte abrogé. Cela inclut les liquidations judiciaires, les redressements, les injonctions de payer, les désignations d’administrateurs ou de mandataires, ainsi que les mesures conservatoires. Le juge consulaire, n’étant pas une autorité juridictionnelle au sens de la loi, rend des actes dénués de toute force obligatoire.
Plus largement, cette anomalie institutionnelle constitue une fraude législative systémique. En prétendant maintenir un corps de magistrats sans loi, l’État viole les principes de séparation des pouvoirs, d’égalité devant la justice et de légalité des juridictions. Elle mine également la confiance du public dans le système judiciaire, en donnant à des commerçants le pouvoir d’ordonner des saisies, des dépôts de bilan ou des expulsions au nom de l’État, sans en avoir ni la compétence juridique, ni la légitimité constitutionnelle.
En conséquence, les juges consulaires ne peuvent être considérés comme des magistrats réguliers au sens du droit français ou européen. Leur statut est nul, leurs décisions sont nulles, et leur prétendue autorité est usurpée. Toute procédure dans laquelle ils interviennent doit être considérée comme radicalement viciée, et ouvrir droit à réparation pour violation du droit à un tribunal légalement établi. Cette réalité impose une remise en cause globale de l’organisation commerciale de la justice française, fondée depuis plusieurs décennies sur une illusion d’institutionnalité qui ne résiste à aucune analyse juridique sérieuse.
Nullité absolue des décisions rendues par les juridictions commerciales
Au terme de l’analyse des textes fondateurs, des lois d’abrogation et des tentatives de régularisation illégales, une conclusion s’impose avec une évidence implacable : les juridictions commerciales françaises, et notamment les tribunaux de commerce, ne reposent sur aucune base légale valable depuis plus de quarante ans. Leurs fondements ont été supprimés du Code de commerce par la loi du 16 juillet 1987, effacés du Code de l’organisation judiciaire par la loi du 17 décembre 1991, puis réintroduits de manière frauduleuse et inconstitutionnelle dans des codes caducs par ordonnance non ratifiée.
Mais au-delà de la seule illégalité structurelle de ces juridictions, c’est l’inexistence juridique des juges consulaires qui rend leurs décisions radicalement nulles. Ces derniers, élus parmi les commerçants, ne bénéficient d’aucune reconnaissance législative régulière, leur statut ayant été balayé par les abrogations successives sans jamais être rétabli par une loi conforme aux exigences constitutionnelles. En l’absence de texte valable régissant leur désignation, leurs fonctions ou leurs pouvoirs, ces juges n’ont aucune qualité pour exercer un acte juridictionnel au nom de l’État.
Cette double illégalité – à la fois de l’organe (le tribunal) et de ses membres (les juges consulaires) – frappe d’une nullité absolue toutes les décisions rendues depuis 1987. Il ne s’agit pas d’un simple vice de procédure, ni d’une irrégularité régularisable, mais d’une nullité d’ordre public, permanente, imprescriptible. Chaque jugement, ordonnance ou injonction émanant d’un tribunal de commerce doit être considéré comme juridiquement inexistant, privé de tout effet contraignant ou opposable.
Il en résulte que toutes les procédures engagées devant ou par ces juridictions – redressements judiciaires, liquidations, désignations d’administrateurs ou de mandataires, injonctions de payer, saisies – sont entachées d’irrégularité radicale. Les professions qui gravitent autour de ces juridictions, comme les greffiers, mandataires judiciaires et administrateurs, ne tirent leur autorité que d’un pouvoir inexistant. Leurs actes, tout comme leurs fonctions, sont nuls de plein droit, et les sociétés qu’ils dirigent ou mandatent ne peuvent se prévaloir d’aucune légitimité.
Cette situation constitue une violation manifeste du droit à un tribunal établi par la loi, garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi qu’une rupture du principe fondamental de légalité des juridictions en droit français. En entretenant l’illusion d’une légitimité institutionnelle là où il n’existe qu’un vide juridique, l’État et les institutions impliquées se rendent coupables d’une fraude institutionnelle d’une ampleur historique, qui appelle l’annulation pure et simple de toutes les décisions rendues par ces juridictions commerciales depuis leur désancrage légal.
Il n’existe, en droit, aucune possibilité de régularisation rétroactive d’une juridiction supprimée par la loi puis reconstituée par décret ou ordonnance sans ratification. L’ensemble des décisions rendues par les tribunaux de commerce depuis 1987 est donc frappé de nullité absolue, les fonctions exercées par les juges consulaires étant entachées d’usurpation, et les actes qui en résultent dépourvus de toute force légale. La justice commerciale française repose ainsi sur une fiction juridique illégitime, qui appelle une remise en cause immédiate, la réhabilitation des victimes de ces procédures, et l’engagement de la responsabilité de l’État pour faute grave dans l’organisation de son service public de la justice.
Violations légales et constitutionnelles
Les analyses précédentes révèlent un ensemble de manœuvres délibérées, organisées et persistantes, qui ne relèvent plus de simples irrégularités juridiques, mais bien d’une fraude institutionnelle d’État. Depuis 1978, l’adoption illégale du Code de commerce, la création inconstitutionnelle du Code de l’organisation judiciaire, l’établissement fictif des tribunaux de commerce et la légalisation fallacieuse de professions judiciaires en société ont formé un système parallèle, dépourvu de toute base légale conforme à la Constitution. Ce système a généré une mécanique de spoliation des entreprises et des citoyens français, orchestrée sous apparence de légalité, par des juridictions et des structures professionnelles qui n’existent pas en droit.
Cette situation constitue une violation manifeste de l’article 38 de la Constitution, lequel encadre strictement le recours aux ordonnances. L’ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000, l’ordonnance n°2006-676 du 8 juin 2006 et l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 ont toutes excédé le périmètre fixé par leurs lois d’habilitation respectives. Elles ont procédé à des codifications de dispositions abrogées, réintroduit des articles supprimés, et modifié des normes sans respecter ni le droit en vigueur, ni les limites constitutionnelles. Leur caducité résulte de l'absence de ratification régulière et de leur incompatibilité avec les exigences posées par le Conseil constitutionnel, notamment quant au respect du domaine de la loi.
Ce dispositif illégal viole également la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. L’égalité devant la loi, consacrée à l’article 1er, est bafouée par l’existence de juridictions d’exception réservées au monde économique, dont les juges ne sont ni impartiaux ni régulièrement institués. La liberté d’entreprendre, protégée par l’article 4, est écrasée par un système qui organise la destruction d’activités économiques sous prétexte de procédures judiciaires invalides. L’article 6, qui exige que la loi soit l’expression de la volonté générale, est violé par l’application de textes issus d’ordonnances non ratifiées, caduques ou anticonstitutionnelles. L’article 7, qui interdit les arrestations ou sanctions arbitraires, est détourné lorsque des liquidations judiciaires ou saisies de patrimoine sont opérées sans base légale réelle. L’article 16, qui fonde l’État de droit sur la séparation des pouvoirs et la garantie des droits, est gravement atteint par l’instauration d’une justice parallèle, hors du cadre normatif républicain. Enfin, l’article 17, protecteur de la propriété, est violé chaque fois qu’une décision illégale de liquidation ou de saisie est exécutée par des juridictions et professionnels n’ayant aucun fondement légal pour agir.
Sur le plan européen, la Convention européenne des droits de l’homme est elle aussi constamment violée. L’article 6 garantit le droit à un procès équitable devant un tribunal établi par la loi. Or, les tribunaux de commerce, les juges consulaires et les greffes qui les composent ne remplissent aucun de ces critères, rendant toutes les procédures entachées d’invalidité. L’insécurité juridique affecte non seulement les droits procéduraux, mais aussi les droits économiques, à commencer par le droit de propriété garanti par l’article 1er du Protocole additionnel n°1 de la Convention. La privation de biens opérée sans base légale, par voie de redressement ou de liquidation, constitue une expropriation illégale, relevant de la compétence des juridictions internationales.
La responsabilité pénale des auteurs et complices de ce système est directement engagée. Les juges consulaires, greffiers, administrateurs judiciaires et mandataires agissent en violation des textes régissant l’exercice légal de leurs fonctions. Il y a usurpation de titre et de fonction au sens des articles 433-12, 433-13 et 433-17 du Code pénal. Il y a également escroquerie en bande organisée, visée aux articles 313-2 et 132-71, dès lors qu’un faux système juridictionnel est utilisé pour tromper les justiciables et détourner leur patrimoine. Les conflits d’intérêts, notamment ceux des juges consulaires, relèvent de la prise illégale d’intérêts (article 432-12), et les nombreuses interactions entre magistrats, mandataires et entreprises concurrentes ou repreneuses révèlent des faits de corruption et de trafic d’influence (articles 432-11 et 433-1).
Chaque décision rendue sans base légale constitue un faux en écriture publique, sanctionné par l’article 441-1, et tout acte tiré de ces décisions, notamment les actes des greffiers ou les publications au registre du commerce, relève de l’usage de faux. Il y a abus de confiance dès lors que les patrimoines confiés ou gérés par ces intervenants ont été détournés (article 314-1), mais aussi abus de pouvoir lorsque des fonctions inexistantes sont utilisées pour imposer des décisions coercitives, souvent au bénéfice d’intérêts privés. Dans les cas de vente d’actifs ou de gestion d’entreprises en liquidation, les fonds publics ou collectifs ont pu être détournés, engageant la responsabilité des auteurs pour détournement de fonds publics (article 432-15).
L’ensemble de ces actes forme une entreprise criminelle, au sens de l’article 450-1 du Code pénal, structurée, organisée, couverte par les institutions, et poursuivant un objectif : la destruction de la souveraineté judiciaire au profit d’un système parajudiciaire soumis à des intérêts économiques. Il s’agit d’un mécanisme de spoliation institutionnelle, dans lequel des juridictions inconstitutionnelles sont utilisées pour spolier les entreprises, détruire les activités, confisquer les patrimoines, et transférer la richesse à des acteurs privés sans contrôle démocratique.
Ce système ne se limite pas à l’illégalité administrative. Il constitue une extorsion systématique de fonds et de biens au sens de l’article 312-1 du Code pénal, par l’utilisation d’un cadre juridique fictif pour contraindre des citoyens et entrepreneurs à abandonner leurs droits. Le rôle actif de l’État, qui a couvert ces pratiques depuis plus de quarante ans, engage sa responsabilité au titre du crime d’État. Il ne s’agit pas d’un échec, mais d’une complicité volontaire et persistante dans la mise en place d’un régime frauduleux.
Il est désormais nécessaire que des actions pénales, tant nationales qu’internationales, soient engagées contre les responsables politiques, judiciaires, ministériels et administratifs ayant contribué ou laissé faire cette fraude structurelle. Les victimes, entreprises liquidées, patrimoines saisis, familles ruinées, doivent pouvoir obtenir réparation intégrale. Ce système n’a aucune base juridique. Il doit être démantelé, et ses acteurs traduits devant les juridictions compétentes. Il en va du respect de l’État de droit, de la souveraineté populaire, et de l’intégrité des institutions républicaines.
Les conséquences dramatiques des manœuvres frauduleuses : une spoliation systématique et des vies brisées
Ce qui aurait dû être un mécanisme de soutien et de protection pour les entreprises en difficulté s’est transformé, sous l’apparence trompeuse de la légalité, en un dispositif de prédation institutionnalisée. Depuis plusieurs décennies, des juridictions commerciales sans existence légale, des professionnels du droit sans statut juridiquement valable, et des procédures biaisées opérant hors de tout cadre normatif légitime ont œuvré à la ruine de citoyens, d’entreprises et de familles entières. Ce système judiciaire frauduleux, imposé en toute impunité, a broyé des existences, détruit des patrimoines et plongé des milliers de victimes dans une détresse profonde, irréparable, souvent irréversible.
Des artisans, commerçants et chefs d’entreprise ont vu s’effondrer, en quelques audiences, des années ou des décennies de travail. Mis en liquidation par des tribunaux de commerce juridiquement inexistants, ils ont été privés de toute voie de recours équitable, de toute véritable défense, et souvent même du droit fondamental d’être entendus par une juridiction régulièrement établie. Des familles ont été chassées de leur logement, précipitées dans la précarité à la suite de saisies forcées opérées sur la base de décisions rendues par des organes illégitimes. Derrière les chiffres abstraits des faillites se trouvent des drames humains concrets : des domiciles saisis, des couples détruits, des enfants confrontés à l’insécurité matérielle, à l’angoisse quotidienne, à la stigmatisation sociale.
La destruction économique a laissé place, dans de nombreux cas, à une détresse psychologique majeure. Le nombre de suicides chez les entrepreneurs, commerçants et dirigeants d’entreprise frappés par ces procédures arbitraires est un indicateur glaçant de la violence systémique exercée par l’appareil judiciaire commercial illégal. Des hommes et des femmes ont mis fin à leurs jours, acculés par l’humiliation d’être ruinés sans avoir été réellement jugés, sans qu’aucun droit réel à la défense ne leur ait été reconnu. L’angoisse d’être dépouillé de son travail, la solitude face à une institution aveugle, l’absence de recours face à une injustice scellée par l’apparence d’un jugement, ont mené des centaines de personnes à l’irréparable. Chaque suicide commis dans ces circonstances est un acte d’accusation contre l’État, une preuve irréfutable que le droit a été détourné pour devenir un instrument de destruction. Ces morts sont le fruit direct de l’illégalité couverte par les institutions. Elles engagent non seulement la responsabilité morale de l’État, mais aussi, en toute rigueur, sa responsabilité pénale.
Il ne s’agit pas d’excès marginaux, de fautes isolées ou de simples abus individuels. C’est l’ensemble du système qui est vicié. Ce que l’on présente comme de la justice commerciale n’est en réalité qu’un outil de spoliation méthodique, un instrument de redistribution violente des richesses au profit de puissances économiques ou d’intérêts dissimulés derrière des façades institutionnelles. La prétendue régulation judiciaire du tissu économique est devenue une entreprise organisée de démolition. L’État, au lieu de protéger, a trahi. Les institutions judiciaires, au lieu de garantir le droit, ont légitimé l’inacceptable. Tout a été mis en œuvre pour créer une illusion de légalité autour de procédures intrinsèquement frauduleuses : faux tribunaux, faux magistrats, faux greffiers, textes de loi inexistants ou abrogés, codes bricolés à partir d’ordonnances caduques, pouvoirs exorbitants exercés sans fondement législatif. À chaque étape, les victimes ont été piégées dans une mécanique écrasante, incapable d’être stoppée par le droit puisqu’elle prétendait en incarner l’autorité.
Le bilan humain de cette fraude d’État est incalculable. Il ne s’agit pas simplement d’un effondrement de légalité. Il s’agit d’un écroulement moral, d’un crime institutionnel de masse, perpétré sous couvert de justice, au sein même de ce qui aurait dû incarner la République. Tant qu’aucune réforme radicale ne sera engagée, tant que les responsables ne seront pas poursuivis, tant que les victimes ne seront pas réparées, aucune autorité ne pourra prétendre parler au nom du droit, de la légitimité ou de la justice.
Une fraude institutionnelle aux conséquences humaines irréparables
Derrière chaque décision de justice rendue par des magistrats, greffiers, huissiers et autres auxiliaires de justice impliqués dans le fonctionnement des juridictions commerciales illégales, se dissimule une violence institutionnelle d’une intensité extrême, trop souvent dissimulée sous l’apparence rassurante de la légalité. Ce ne sont pas de simples mécanismes de recouvrement ou d’application du droit : ce sont des procédures brutales, dépourvues de fondement légal, menées avec une froideur bureaucratique, qui broient des vies sans jamais rendre de comptes.
Les huissiers de justice, véritables exécutants d’un système oppressif, interviennent sans discernement, expulsant des familles, saisissant des biens, ruinant des vies au nom de décisions judiciaires dont la base juridique est contestable, voire inexistante. Ils exécutent des actes dont ils ne vérifient ni la légitimité des auteurs, ni la validité des textes fondant les décisions. À chaque expulsion, c’est une humiliation, une blessure morale, un traumatisme irréversible.
Les greffiers des tribunaux de commerce, en apposant leur sceau sur ces décisions, valident et légitiment des actes judiciaires émis par des juridictions dépourvues de toute existence légale. Leur rôle, loin d’être neutre, est devenu celui de garants apparents d’une justice qui, en réalité, opère dans l’illégalité la plus totale. Ils participent à la mécanique d’une spoliation institutionnelle, où les plus petits acteurs économiques sont systématiquement sacrifiés au profit des puissants.
Les administrateurs et mandataires judiciaires, prétendument désignés pour sauver les entreprises en difficulté, agissent en réalité comme les acteurs clés d’un système de prédation. Leurs interventions visent rarement à préserver l’activité ou les emplois. Elles consistent, dans la majorité des cas, à liquider, à vendre à la découpe, à transférer les actifs vers des tiers souvent proches du réseau judiciaire ou économique local. Ils exercent ces fonctions alors même que leur statut repose sur des ordonnances illégales et des textes caducs, rendant l’ensemble de leurs actes juridiquement et éthiquement viciés.
Les juges consulaires des tribunaux de commerce, eux-mêmes issus du monde des affaires, rendent des décisions au nom du peuple français alors qu’ils ne disposent d’aucune des garanties attachées à un véritable statut de magistrat. Élus entre pairs, ils statuent sur des affaires impliquant parfois leurs concurrents, leurs partenaires ou leurs associés. Leur proximité avec les milieux économiques engendre une partialité structurelle et permanente, transformant les tribunaux de commerce en instruments d’un pouvoir économique sans contre-pouvoir.
Ce système n’épargne personne. Des artisans, commerçants et chefs d’entreprise, dépossédés du fruit de leur travail, se retrouvent ruinés, expulsés, marginalisés. Le désespoir engendré par la perte brutale de tout un projet de vie mène, dans de nombreux cas, à la dépression, à l’isolement, et parfois au suicide. Ces drames humains sont la conséquence directe d’une justice illégitime, où les droits fondamentaux sont méprisés, où l’homme est réduit à un numéro de dossier.
Ces actes judiciaires, censés représenter l’expression la plus haute de l’État de droit, ne sont en réalité qu’une forme de violence d’État légalisée, mise au service d’une minorité agissante. La souffrance des victimes est ignorée, niée, effacée par une administration qui ne connaît ni empathie ni reddition de comptes. Pendant ce temps, les élites économiques et les grandes fortunes bénéficient d’une justice docile, protectrice, complice.
Nous ne sommes pas en présence d’une justice imparfaite, mais d’un appareil judiciaire perverti jusqu’à son ossature. Ce n’est pas la justice, c’est un pillage organisé, systématique, implacable, perpétré sous couvert de légalité par des structures et des personnes qui n’ont aucune légitimité à agir. Il est temps de mettre un terme à cette mascarade, de rendre justice aux victimes, et de juger ceux qui, au mépris de toute légalité, ont transformé les institutions en armes contre le peuple.
Conclusions sur l’illégalité des tribunaux de commerce, du Code de commerce
La crise juridique que traverse aujourd’hui la justice française ne relève pas d’un simple dysfonctionnement administratif ou d’une erreur technique. Elle repose sur un vice structurel d’une gravité extrême, affectant l’ensemble de l’édifice juridictionnel du pays. Le Code de l’organisation judiciaire (COJ), censé constituer l’ossature légale de l’appareil judiciaire, n’a jamais été adopté selon une procédure constitutionnellement valide. Sa prétendue existence législative repose sur le décret n°78-329 du 16 mars 1978, un texte inconstitutionnel dès sa publication, qui a illégalement substitué des dispositions législatives sans passer par le Parlement, violant de manière flagrante l’article 34 de la Constitution et les principes de hiérarchie des normes.
Toutes les tentatives ultérieures de régularisation, notamment à travers la loi du 17 décembre 1991, relèvent d’un artifice juridique grossier : donner « force de loi » à un décret frappé d’inconstitutionnalité, tout en abrogeant les dispositions mêmes qu’il contenait, aboutit non seulement à une contradiction manifeste, mais à un vide juridique abyssal. En abrogeant les fondements du décret de 1978, le législateur n’a jamais recréé un socle légitime pour organiser la justice. Le COJ n’a donc jamais existé en droit. Il est un simulacre de légalité, un outil de façade, sans aucune validité juridique réelle.
Or, l’ensemble de la structure judiciaire repose sur ce code. Tribunaux de commerce, tribunaux judiciaires, cours d’appel, Cour de cassation, chambres spécialisées : toutes ces juridictions tirent leur compétence, leur organisation, leurs statuts et leur autorité du Code de l’organisation judiciaire. Si ce code est illégal, alors tout ce qui en découle l’est également. Il ne s’agit pas d’une hypothèse théorique ou marginale, mais d’une réalité juridique incontournable : la justice française fonctionne, depuis plusieurs décennies, sans base légale. Elle agit dans un cadre de fait, et non de droit. C’est la négation même de l’État de droit.
Les tribunaux de commerce, quant à eux, constituent un cas emblématique de cette fraude. Démantelés progressivement par les lois de 1987 et de 1991, privés de toute mention légale dans le Code de commerce, ils n’existent plus juridiquement depuis plus de trente ans. Pourtant, ils continuent de statuer, d’ordonner des liquidations, de désigner des mandataires, de spolier des entrepreneurs au nom d’une autorité qui n’a plus aucun fondement. C’est une justice fantôme, sans cadre, sans légitimité, mais dotée de tous les attributs extérieurs du pouvoir judiciaire, au service d’intérêts financiers, institutionnels et mafieux.
Les conséquences de cette gigantesque imposture sont incalculables. Des millions de décisions judiciaires ont été rendues par des juridictions illégales, composées de personnes sans titre, appliquant des codes eux-mêmes sans validité. Il en résulte une invalidité de masse de tout le contentieux civil, commercial, et même pénal, sur le fondement de juridictions inexistantes. Des saisies, des expulsions, des faillites ont été ordonnées sans qu’aucune autorité légitime ne les autorise. Ce n’est pas seulement un scandale juridique ; c’est un crime institutionnel d’une ampleur inédite.
En poursuivant le fonctionnement de ces structures en dépit de leur illégalité manifeste, l’État français viole sciemment les principes les plus fondamentaux de la démocratie et du droit. Il foule aux pieds le principe de séparation des pouvoirs, il détruit la garantie du procès équitable, il anéantit la sécurité juridique. Ce système n’est pas réformable de l’intérieur : il est corrompu à la racine. Il repose sur une usurpation continue de l’autorité judiciaire par des entités et des individus qui n’ont ni mandat légitime ni autorité reconnue.
Il faut avoir le courage de l’affirmer clairement : la justice française, telle qu’elle fonctionne depuis 1978, n’existe pas en droit. Elle est un pouvoir de fait, arbitraire, dont les décisions, bien que revêtues de force exécutoire, sont entachées d’une nullité radicale. Elle ne peut être considérée comme un véritable pouvoir judiciaire. Ce constat est accablant, mais il est nécessaire pour restaurer la vérité juridique, la souveraineté du peuple, et le respect du droit.
Le retour à un véritable État de droit impose la suspension immédiate de toutes les juridictions fondées sur le COJ frauduleux, l’abrogation complète des ordonnances illégales, la restitution des droits des victimes de cette justice d’apparence, et l’engagement de poursuites contre les auteurs, co-auteurs et complices de cette fraude d’État historique.
La responsabilité de l’État et des institutions judiciaires
Le désastre juridique, humain et social qui résulte de l’organisation judiciaire française depuis 1978 ne peut être réduit à une simple série d’erreurs administratives. Il s’agit d’une fraude institutionnelle d’État, d’une trahison volontaire des principes républicains et constitutionnels, menée en connaissance de cause par l’ensemble des institutions. Ce système illégal n’a pas été le fruit d’un oubli ou d’une négligence ; il est le résultat d’une volonté politique, juridique et administrative coordonnée, ayant pour effet d’imposer aux citoyens un appareil judiciaire dénué de légitimité, tout en maintenant l’apparence d’un État de droit.
Les gouvernements successifs, qu’ils soient de droite ou de gauche, ont tous eu connaissance des vices de fond qui entachent le Code de l’organisation judiciaire, le Code de commerce, et les statuts des professions qui en découlent. Pourtant, aucun n’a engagé la réforme nécessaire ni saisi le Conseil constitutionnel pour remédier à cette illégalité manifeste. Par leur inaction, ils ont trahi leur serment de respecter la Constitution et ont contribué à la pérennisation d’un système illégal.
Les présidents de la République successifs ont tous validé, par promulgation ou silence complice, les lois et ordonnances frauduleuses qui ont permis à ce système d’exister. Garants des institutions et du respect des engagements internationaux de la France, ils n’ont jamais exercé leur devoir d’alerte, préférant préserver la stabilité apparente d’un pouvoir judiciaire devenu structurellement corrompu.
Les parlementaires ont quant à eux voté à plusieurs reprises des lois de ratification rétroactives en violation de l’article 38 de la Constitution. Plutôt que de dénoncer les abus et d’exiger la régularisation des textes en cause, ils ont tenté de blanchir le passé législatif, engageant ainsi leur propre responsabilité dans la consolidation d’un appareil judiciaire fondé sur des bases frauduleuses.
Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État, censés être les gardiens de la légalité et des principes constitutionnels, ont entériné ces textes illégitimes, notamment par des décisions d’irrecevabilité, des validations implicites ou des interprétations manifestement contraires à l’esprit de la Constitution. Leur silence, leur passivité ou leur approbation ont contribué à couvrir cette imposture législative, en lui conférant un vernis de légalité aux yeux de l’opinion publique.
Les magistrats professionnels et juges consulaires, quant à eux, ont continué de siéger, de rendre des jugements, d’ordonner des saisies, des liquidations, des incarcérations, en toute connaissance de cause. Leur formation juridique ne permet pas de croire qu’ils ignoraient l’absence de base légale des juridictions commerciales, ni les atteintes fondamentales au droit au juge naturel, au contradictoire ou à l’indépendance. En acceptant d’exercer dans un cadre vicié, ils ont perpétué un système illégal et discriminatoire, qui ne rend pas justice mais produit de la violence d’État.
Les greffiers, administrateurs et mandataires judiciaires, avocats, notaires et commissaires de justice ont quant à eux largement bénéficié de ce désordre institutionnel. Agissant comme exécutants zélés d’un appareil judiciaire illégal, ils ont organisé ou participé à des spoliations de masse, à des ventes forcées, à des saisies sans fondement légal, à des expulsions de familles entières, tout en tirant profit d’honoraires, de prélèvements, de frais et de commissions injustifiables. Cette caste professionnelle s’est constituée en corporation protégée, agissant sous le couvert de la légalité mais sans fondement législatif valide.
Le ministère public, quant à lui, n’a jamais joué son rôle de garant de l’ordre public et des libertés fondamentales. La Cour européenne des droits de l’homme a confirmé à plusieurs reprises que le parquet français n’est pas une autorité judiciaire indépendante, en violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Les procureurs, au service direct de l’exécutif, ont validé, couvert ou ignoré sciemment les irrégularités commises, allant jusqu’à poursuivre les justiciables qui dénonçaient les abus, dans une inversion totale des principes de droit.
Les institutions européennes ne peuvent non plus être exonérées de leur part de responsabilité. Malgré les multiples alertes, rapports et contentieux engagés devant les juridictions de Strasbourg ou Luxembourg, elles ont laissé la France violer les principes les plus élémentaires de l’État de droit, en ne sanctionnant pas l’illégalité structurelle de son organisation judiciaire.
Enfin, les médias de masse et les grandes écoles de droit ont joué un rôle dans la normalisation de cette fraude, en taisant les incohérences fondamentales du système judiciaire, en refusant le débat sur la légalité des juridictions commerciales, et en formant des générations de juristes à l’obéissance plutôt qu’à la défense des droits fondamentaux.
Cette organisation illégale de la justice ne se limite pas à un dysfonctionnement. Elle constitue une violation systémique, institutionnalisée et durable de la Constitution, de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de la Convention européenne des droits de l’homme, et des engagements internationaux de la France. En cela, elle engage la responsabilité pleine et entière de l’État, tant sur le plan interne que devant les juridictions internationales.
Ce système est, dans son essence, une trahison du pacte républicain. Il sacrifie les citoyens au profit des puissants, détruit la confiance dans l’État de droit, et fait de la justice un outil d’oppression plutôt qu’un rempart contre l’arbitraire. À ce titre, il ne peut être réformé à la marge : il doit être entièrement démantelé, ses auteurs jugés, ses victimes indemnisées, et une refondation complète du système judiciaire engagée sous contrôle citoyen.
La trahison organisée : Comment les partis politiques ont confisqué la démocratie et détruit la souveraineté populaire
Depuis plus de quarante ans, la démocratie française ne fonctionne plus selon les principes d’une véritable République fondée sur la souveraineté du peuple. Les institutions ont été méthodiquement détournées de leur vocation originelle au profit d’une oligarchie politico-financière qui a confisqué le pouvoir à travers un réseau d’intérêts croisés entre partis politiques, élites économiques, hautes juridictions et médias. Loin de représenter le peuple, les partis politiques se sont progressivement transformés en appareils de domination, œuvrant à la préservation de leurs privilèges et à la reproduction d’un ordre établi profondément inégalitaire.
Cette trahison structurelle s’est notamment matérialisée par la mise en place de textes frauduleux tels que le Code de commerce, le Code de l’organisation judiciaire, ou encore les ordonnances régissant les professions de greffier, mandataire ou administrateur judiciaire. Ces dispositifs, adoptés en violation manifeste des règles constitutionnelles et jamais validés par une ratification législative régulière, n’ont été rendus possibles que par l’action directe des partis politiques au pouvoir et de ceux qui prétendent leur faire opposition. Car c’est bien l’ensemble du spectre parlementaire qui, dans sa totalité, a couvert, accompagné et protégé cette vaste entreprise de falsification juridique et de démantèlement des principes républicains.
Les députés et sénateurs, loin d’exercer un contrôle démocratique effectif, ont massivement participé à la validation de textes inconstitutionnels, voté des lois de ratification frauduleuses, et accordé des habilitations en violation de l’article 38 de la Constitution. Non seulement ils ont manqué à leur mission de représentation, mais ils ont activement œuvré à la destruction des piliers fondamentaux de l’État de droit, en érigeant une architecture normative illégitime destinée à favoriser les puissances d’argent, les grandes entreprises et les banques, au détriment du peuple souverain. Ces élus, grassement rémunérés, disposant d’avantages indus et agissant en vase clos, n’ont cessé de renforcer leur propre pouvoir tout en affaiblissant les contre-pouvoirs institutionnels et en neutralisant toute forme de contestation réelle.
Dans cette mécanique de dépossession, les partis politiques ne sont plus les instruments de la volonté générale, mais les rouages d’une machine de contrôle et d’oppression. Ils ont organisé une pseudo-alternance politique fondée sur des clivages factices, dissimulant leur parfaite complicité dans les réformes les plus régressives. La prétendue opposition n’est qu’un théâtre démocratique destiné à masquer l’unanimité des élites sur les sujets essentiels : démantèlement des protections sociales, criminalisation de la contestation, asphyxie des petites entreprises, soumission de la justice à l’exécutif et alignement sur les intérêts transnationaux. Ainsi, qu’il s’agisse de la majorité ou de ses prétendus opposants, tous les partis ont trahi la souveraineté populaire pour maintenir un pouvoir fondé sur la manipulation, la peur et la répression.
Ce détournement n’aurait pu réussir sans l’appui des institutions judiciaires et des médias de masse. Les grandes rédactions, détenues par des groupes privés étroitement liés au pouvoir, ont systématiquement étouffé les scandales d’État, occulté les atteintes aux droits fondamentaux et participé à la construction d’un récit falsifié de la réalité politique, économique et juridique. La justice, quant à elle, s’est souvent montrée docile face aux abus des puissants et impitoyable envers les plus fragiles, allant jusqu’à couvrir des illégalités manifestes, des spoliations massives, voire des violations flagrantes de la Constitution, de la Déclaration des droits de l’homme et des conventions internationales.
Les partis politiques sont ainsi devenus les agents d’une dépossession totale. Ils ont vidé la République de son contenu, trahi la confiance des citoyens, et substitué à la souveraineté populaire une gouvernance opaque fondée sur le mensonge institutionnalisé. Leur responsabilité dans la destruction du tissu social, la ruine des indépendants, l’effondrement des services publics, la criminalisation des résistances et la négation du droit est écrasante. En agissant ainsi, ils ont franchi la frontière entre la simple compromission politique et la complicité active dans un crime d’État.
Cette trahison n’est pas une erreur d’appréciation ou une déviation accidentelle : c’est une stratégie délibérée de confiscation du pouvoir, de concentration des richesses, et d’asservissement progressif du peuple sous couvert de légalité. En refusant toute remise en question du système, en persécutant ceux qui osent dénoncer les fraudes institutionnelles, et en verrouillant tous les mécanismes de contrôle démocratique, les partis politiques ont transformé la République française en une structure autoritaire, où la loi ne sert plus la justice, mais l’oppression.
La question centrale n’est donc plus de savoir s’il y a eu trahison. Elle est désormais de savoir jusqu’à quand cette trahison sera tolérée, et quand le peuple, spolié, manipulé et écrasé, décidera de reprendre le pouvoir qui lui appartient.
Conclusion générale de la CISDHJ – Une République hors-la-loi : la France est administrée par des institutions juridiquement inexistantes
Au terme de cette démonstration rigoureuse, aucun doute ne subsiste : les juridictions françaises, les codes qui les régissent, les professions judiciaires qui y exercent, et les structures qui en émanent sont, pour une large part, totalement dépourvues de fondement juridique valide. Cette situation n’est pas marginale. Elle ne relève pas d’un simple vice de forme ou d’un oubli ponctuel. Elle constitue une fraude systémique, un effondrement structurel du droit et de l’État républicain.
Le Code de commerce, le Code de l’organisation judiciaire (COJ), le statut des greffiers, des mandataires, des administrateurs judiciaires et même celui des juges consulaires, reposent sur des ordonnances non ratifiées, des lois abrogées, des décrets inconstitutionnels ou des tentatives de régularisation frauduleuse. La justice commerciale, dans son ensemble, n’a donc jamais été établie conformément aux principes fondamentaux de la légalité républicaine. Elle opère pourtant quotidiennement, distribuant saisies, liquidations et condamnations, au mépris du droit et de la dignité humaine.
La République française s’est ainsi dotée, en toute illégalité, d’un appareil judiciaire parallèle, fondé non pas sur la souveraineté du peuple et le respect de la Constitution, mais sur la volonté d’une caste politique et économique d’organiser la spoliation des citoyens, d’encadrer la faillite organisée des entreprises, de favoriser la concentration des richesses et de maintenir une mainmise totale sur la vie économique et sociale. Ce que l’on nomme aujourd’hui "justice" n’est bien souvent qu’une mécanique de prédation institutionnalisée, où les procédures, codifiées par des textes sans légitimité, sont utilisées pour déposséder les justiciables au bénéfice d’intérêts privés ou d’organismes hors de tout contrôle démocratique.
La responsabilité de l’État dans cette situation est totale. Elle engage non seulement les gouvernements successifs et les parlementaires complices, mais également les plus hautes institutions juridictionnelles et administratives, qui ont validé, consolidé et protégé un édifice juridique entièrement frauduleux. La justice française fonctionne aujourd’hui comme une fiction d’État, où l’apparence de la légalité est utilisée pour masquer l’illégalité intrinsèque de ses fondements.
Cette faillite du droit n’est pas sans conséquences. Elle a permis la ruine de milliers de citoyens, la confiscation de patrimoines, la liquidation de sociétés, la destruction du tissu économique, et la propagation d’une violence institutionnelle d’une ampleur rarement égalée dans un pays se prétendant démocratique. Elle a nourri le désespoir, engendré des drames humains irréparables, et instauré un climat de défiance absolue à l’égard des institutions. Elle a rendu la République illisible, incohérente et profondément injuste.
Le constat est clair : la République française est hors-la-loi. Elle se maintient par la force de la peur, par l’opacité des procédures, par la manipulation des textes et par le silence complice des élites. Elle fonctionne sans légitimité réelle, sans contrôle effectif du peuple et sans respect des principes constitutionnels fondamentaux.
La CISDHJ, à travers cette analyse, appelle solennellement à une reprise de contrôle démocratique par les citoyens eux-mêmes. Il ne peut y avoir de justice sans légalité. Il ne peut y avoir de République sans respect des droits fondamentaux. Il ne peut y avoir de souveraineté populaire tant que l’appareil judiciaire est fondé sur la fraude, le mensonge et l’impunité.
L’heure n’est plus aux demi-mesures. Il faut rompre avec ce système illégal, exiger la suspension immédiate des juridictions commerciales frauduleuses, l’abrogation des textes inconstitutionnels, et l’ouverture d’une enquête nationale indépendante sur l’ensemble des décisions rendues depuis 1978 sous l’autorité d’institutions sans existence légale.
Il est temps que le droit redevienne un outil de justice, et non un instrument de domination. Il est temps que le peuple reprenne le pouvoir qui lui a été volé. La vérité juridique est désormais établie : ce système n’est plus réformable. Il doit être désavoué, dénoncé et remplacé par un ordre institutionnel respectueux du droit, de la souveraineté nationale et de la dignité humaine.