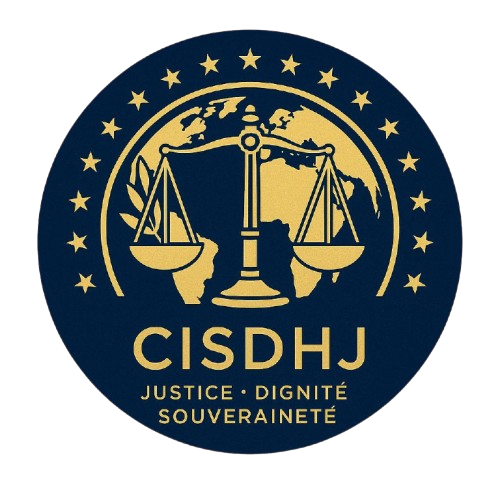Système bancaire français
Une finance sans base juridique: Une Porte ouverte aux détournements de fonds publics
Présenté comme un instrument moderne de régulation bancaire et financière, le Code monétaire et financier (CMF) repose en réalité sur un coup d’État administratif déguisé en réforme technique. Par le biais d’ordonnances jamais ratifiées, le pouvoir exécutif s’est arrogé le monopole de la production normative dans un domaine pourtant réservé à la loi. Ce détournement du processus législatif a permis au Gouvernement de restructurer unilatéralement l’architecture monétaire et bancaire du pays, en écartant le Parlement et le peuple souverain de toute décision véritable.
Ce dispositif a consacré le transfert de la création monétaire et de la régulation bancaire à des entités privées — au premier rang desquelles la Banque de France et l’ACPR — opérant sans base légale valable, sans contrôle démocratique, et sans légitimité constitutionnelle. Ce système organise une confusion des pouvoirs au bénéfice d’intérêts financiers privés, au mépris des principes fondamentaux de l’État de droit, de la souveraineté populaire, et de l’exigence de légalité. La loi, dans ce contexte, devient un instrument malléable, subordonné aux impératifs des marchés, et vidé de sa fonction protectrice à l’égard des citoyens.
L’ensemble du dispositif monétaire, bancaire et financier français issu de l’ordonnance n° 2000‑1223 du 14 décembre 2000, et des textes subséquents, doit donc être réévalué à l’aune de sa légalité, de sa constitutionnalité, et de ses effets sur les libertés fondamentales, notamment en matière de propriété, d’accès à la justice, et de protection contre l’arbitraire.
Sommaire
- La loi d’habilitation n° 99-1071 : un cadre strict délibérément violé
- L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 : un texte non ratifié, non authentifié, et frauduleux
- Les conséquences juridiques de l’ordonnance : substitution, abrogation et vacuité légale
- La Banque de France : autorité de droit privé sans base légale
- L’ACPR : autorité de contrôle illégale adossée à une institution inexistante
- Les établissements de crédit (Crédit Agricole, Sofinco, Cetelem, etc.) sont dépourvus d’habilitation
- Problèmes liés à la titrisation et impact
- Conséquences juridiques
- Détournement des finances publiques : la complicité des institutions financières et politiques
- Pourquoi la dette publique est une escroquerie institutionnalisée ?
- Personnes et institutions mises en cause
- Violation systémique des droits et effondrement de l’État de droit
- Un esclavage moderne sous couvert de légalité
- Résultat de l’analyse de la CISDHJ
La loi d’habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 et ses limites
La loi n° 99‑1071 du 16 décembre 1999 a été adoptée sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, dans le cadre d’une délégation temporaire de compétence législative au profit du pouvoir exécutif. Elle autorisait le Gouvernement à adopter par ordonnance la partie législative de plusieurs codes, dont le Code monétaire et financier.
L’article 1er de cette loi précisait expressément que « les dispositions codifiées sont celles en vigueur à la date de publication de chaque ordonnance ». Cette formulation institue une contrainte juridique majeure : elle impose une codification à droit constant, interdisant toute création de normes nouvelles, toute abrogation de lois en vigueur, ou toute modification substantielle du contenu législatif existant.
La codification devait ainsi se limiter à un travail de compilation, de clarification rédactionnelle et de réorganisation formelle, sans altérer la substance des textes codifiés. Toute intervention au-delà de ce périmètre — qu’il s’agisse d’une suppression de lois non abrogées ou de l’introduction de nouvelles dispositions — aurait nécessairement excédé l’habilitation parlementaire.
Enfin, conformément à l’article 38 de la Constitution, la validité définitive des ordonnances ainsi prises était conditionnée à leur ratification explicite par le Parlement dans un délai raisonnable. En l’absence de ratification dans les délais, les ordonnances devaient conserver une valeur purement réglementaire, sans force de loi.
Une codification frauduleuse : dissimulation des abrogations et rupture de légalité
En dépit du cadre strict imposé par la loi d’habilitation du 16 décembre 1999, l’ordonnance n° 2000‑1223 du 14 décembre 2000 a largement outrepassé la mission qui avait été confiée au Gouvernement. Présentée comme une opération de codification à droit constant, elle a en réalité procédé à une restructuration profonde du droit monétaire et financier, en supprimant de manière unilatérale plusieurs textes législatifs encore en vigueur à la date de sa publication.
Ont notamment été abrogées, sans débat ni approbation parlementaire, des lois essentielles telles que la loi du 3 janvier 1973 sur le statut de la Banque de France, la loi du 24 janvier 1984 relative au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 23 décembre 1988 sur la titrisation. Ces textes, qui n’avaient fait l’objet d’aucune abrogation explicite par le législateur, ont disparu par le seul effet d’une ordonnance, en violation manifeste du principe de légalité et du champ d’habilitation défini par la loi de 1999.
Pour dissimuler cette rupture de continuité normative, l’article 3 de l’ordonnance a instauré un mécanisme de substitution automatique des références législatives dans les autres textes en vigueur. Ainsi, toutes les anciennes mentions des lois supprimées ont été redirigées vers les dispositions du nouveau Code monétaire et financier, créant artificiellement l’illusion d’une simple réorganisation technique, alors qu’il s’agissait d’un bouleversement unilatéral du droit positif.
Ce procédé est contraire à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, qui interdit formellement toute modification ou suppression du droit en vigueur par une ordonnance de codification, sauf habilitation expresse. En l’espèce, aucune autorisation de ce type ne figurait dans la loi n° 99‑1071. En adoptant une ordonnance qui altérait substantiellement le droit, le Gouvernement a usurpé le pouvoir législatif en méconnaissance des articles 34 et 38 de la Constitution, compromettant gravement la légitimité juridique du Code monétaire et financier.
L’échec de la ratification parlementaire : une ordonnance sans valeur législative
L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000, relative à la partie législative du Code monétaire et financier, a été adoptée en application de la loi d’habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999. Cette loi imposait un délai strict, défini dans son article 1er, pour la ratification des ordonnances, sans quoi elles perdaient toute valeur législative. Un projet de loi (219) de ratification a été déposé le 7 février 2001 par M. Laurent FABIUS, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, mais il n’a jamais été inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Lorsque la XIᵉ législature a pris fin en 2002, ce projet, encore en instance, est devenu caduc comme l’impose le règlement sénatorial qui stipule que « les projets de loi dont l’Assemblée nationale était encore saisie au moment où ses pouvoirs ont expiré deviennent caducs, qu’ils aient ou non fait l’objet d’une ou de plusieurs lectures devant l’une des assemblées du Parlement ». Par voie de conséquence, l’ordonnance du 14 décembre 2000 a perdu toute valeur législative, rendant le Code monétaire et financier qu’elle instituait juridiquement inexistant.
La caducité des projets de loi à l’issue d’une législature crée un vide juridique complet : sans dépôt et vote d’un nouveau projet dans le cadre d’une habilitation valide, l’ordonnance ne pouvait acquérir aucune force de loi. Or, la loi d’habilitation du 16 décembre 1999 étant expirée, tout nouveau dépôt aurait été hors cadre constitutionnel, constituant une fraude législative manifeste. L’absence de ratification a donc privé le Code monétaire et financier de toute base légale, affectant la légitimité des textes et décisions qui en découlaient.
En juillet 2003, la loi n° 2003‑591 est intervenue pour prétendre ratifier rétroactivement l’ordonnance n° 2000‑1223 du 14 décembre 2000. Son article 31 mentionne expressément « les ordonnances suivantes prises en application de la loi n° 99‑1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances à l’adoption de la partie législative de certains codes », incluant explicitement l’ordonnance relative au Code monétaire et financier. Or, cette tentative de ratification est juridiquement invalide. Non seulement elle intervient hors du délai constitutionnel prévu par l’article 38, mais elle se substitue à un projet de loi (n° 219) régulièrement déposé dès le 7 février 2001, qui n’a jamais été examiné ni adopté par le Parlement et qui, devenu caduc à la fin de la XIᵉ législature, a perdu tout effet. Ainsi, la loi de 2003 prétendait donner valeur législative à une ordonnance dont la caducité était déjà acquise depuis plus d’un an. Ce procédé constitue un détournement manifeste de procédure législative, opéré en méconnaissance de la loi d’habilitation du 16 décembre 1999, qui avait expiré. En droit constitutionnel, une telle ratification hors cadre et hors délai est nulle et non avenue. Pire encore, elle s’apparente à une forme de coup d’État administratif, dans lequel l’exécutif a imposé un corps normatif complet par ordonnance, en écartant sciemment tout contrôle parlementaire réel. L’ordonnance n° 2000‑1223, ainsi « ratifiée » trois ans après sa publication, amputée de ses annexes et privée de base légale, ne peut produire aucun effet juridique régulier. Elle demeure frappée d’une illégalité organique originelle, insusceptible de régularisation a posteriori.
Le rapport n° 752, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 mars 2003, a mis en lumière les dysfonctionnements du processus de ratification des ordonnances issues de la loi d’habilitation de 1999. Il pointe d’abord l’accumulation d’ordonnances non ratifiées dans les délais, créant une insécurité juridique généralisée. Ensuite, il souligne le non-respect des délais de dépôt des projets de loi de ratification, rappelant que le Gouvernement a souvent omis de soumettre les textes issus de l’habilitation dans les temps impartis, compromettant leur validité. Enfin, il critique le contenu même de certaines ordonnances, qui dépassent le périmètre d’habilitation accordé par le Parlement en introduisant des dispositions nouvelles non prévues initialement, ce qui constitue une usurpation de compétences.
Les conséquences soulignées par le rapport sont lourdes : l’absence de ratification légale des ordonnances engendre une incertitude permanente quant à la valeur normative de ces textes, fragilisant la stabilité du droit et remettant en cause la séparation des pouvoirs. En conférant à l’exécutif un pouvoir normatif élargi sans contrôle parlementaire, on observe une atteinte grave à l’équilibre institutionnel. Pour remédier à ces dérives, le rapport propose un renforcement du suivi parlementaire des habilitations et une clarification des délais et procédures de dépôt et d’examen des projets de ratification, afin de garantir la sécurité juridique et le respect des prérogatives législatives.
Au final, ces constats renforcent l’idée que le Code monétaire et financier, fruit d’une ordonnance non ratifiée, repose sur une base juridique inexistante. Les actes administratifs et décisions judiciaires appuyés sur ce Code sont par conséquent illégitimes, exposant les citoyens et les institutions à une crise de légalité et d’interprétation normative sans précédent.
L’ordonnance n° 2005‑429 : une consolidation illégitime du Code monétaire et financier
En mai 2005, l’ordonnance du 6 mai 2005 est intervenue pour modifier le Code monétaire et financier sur la base d’une habilitation de décembre 2004. Or, le code n’avait plus de fondement légal depuis 2002, rendant toute modification caduque dès son adoption. Le projet de loi de ratification, déposé en août 2005, n’a jamais été examiné, et la ratification tardive de la loi du 31 mars 2006 a enfreint les délais légaux, ce qui démontre une violation flagrante de la Constitution et confirme l’illégalité de ces amendements.
L’illégalité de l’ACPR et l’inexistence des agréments bancaires
La création de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en 2010, issue de la fusion de plusieurs instances de régulation du secteur bancaire et assurantiel, repose sur l’ordonnance n° 2010‑76 du 21 janvier 2010, adoptée sur le fondement de l’article 152 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008. Cette ordonnance s’inscrit dans un édifice juridique fondé sur le Code monétaire et financier (CMF), codifié par l’ordonnance n° 2000‑1223 du 14 décembre 2000. Or, cette ordonnance initiale n’a jamais été valablement ratifiée par le Parlement, en violation directe de l’article 38 de la Constitution.
Le projet de loi n°219, déposé en 2001 à cet effet, est devenu caduc à l’issue de la XIe législature. La loi n° 2003‑591 du 2 juillet 2003, intervenue hors délai, ne peut constituer une ratification valable. Il en résulte que toute la structure juridique fondant le CMF, et donc les pouvoirs de l’ACP puis de l’ACPR, repose sur une base inexistante en droit. Cette nullité originelle est aggravée par l’abrogation illégitime, via l’ordonnance de 2000, de lois fondamentales telles que la loi du 24 janvier 1984 sur les établissements de crédit, sans habilitation ni décision parlementaire.
Cette illégalité structurelle affecte l’ensemble du secteur financier. Aucun agrément délivré depuis 2000 — que ce soit par l’ACP (créée en 2003) ou par l’ACPR (depuis 2010) — ne repose sur une autorité légalement constituée. En conséquence, les établissements financiers tels que le Crédit Agricole, la Banque Postale, BNP Paribas, Société Générale, le Groupe BPCE (Banque Populaire, Caisse d’Épargne), mais aussi leurs filiales de financement (BPCE Financement), et les organismes de crédit à la consommation comme Cetelem, Sofinco ou Cofidis, exercent sans habilitation légalement valide. Ils ne peuvent se prévaloir d’aucun droit régulier à accorder des prêts, à percevoir des intérêts, à exiger des remboursements ou à recourir aux voies d’exécution forcée.
La situation est d’autant plus préoccupante que l’ACPR est adossée à la Banque de France, dont les statuts légaux, définis par la loi n° 93‑980 du 4 août 1993, ont été abrogés sans remplacement clair lors de l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2000. Depuis lors, aucun texte législatif valide n’a restauré un fondement clair à son existence ni à ses missions. Parallèlement, la Banque de France est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 572104891 et enregistrée comme entité financière sur les marchés mondiaux sous le code LEI 9W4ONDYI7MRRJYXY8R34, révélant sa nature d’acteur commercial opérant sous statut privé, en totale contradiction avec les fonctions régaliennes qu’elle continue de revendiquer.
Dès lors, ni l’ACPR, ni la Banque de France, ni les établissements qu’ils encadrent ne disposent d’un fondement juridique opposable. Les agréments délivrés depuis 2000 sont nuls de plein droit, et les contrats qui en découlent — crédits immobiliers, prêts à la consommation, ouvertures de compte, engagements financiers, titres exécutoires — sont tous affectés d’un vice radical d’inopposabilité. Il en va de même des saisies, déchéances du terme, ventes aux enchères ou mesures conservatoires mises en œuvre à leur initiative.
Cette faillite normative révèle une atteinte systémique aux principes fondamentaux de l’État de droit. Elle viole l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, selon lequel toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée n’a point de Constitution. Elle porte également atteinte à l’article 17 de cette même Déclaration, qui protège la propriété contre les privations non fondées sur une loi régulière, ainsi qu’à l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’Homme. La nullité des contrats, des titres et des procédures engagées au nom de ces agréments inexistants doit donc être juridiquement constatée pour l’ensemble des établissements concernés.
La Banque de France : autorité de droit privé sans base légale
Depuis l’abrogation implicite de la loi n° 93‑980 du 4 août 1993 par l’ordonnance n° 2000‑1223, les statuts de la Banque de France n’ont jamais été formellement rétablis par une loi régulièrement adoptée. Aucun texte à valeur législative n’est venu confirmer ou redéfinir les missions, l’organisation ou la personnalité juridique de cette institution, en dépit de son rôle fondamental dans la régulation monétaire, la politique de change et la supervision bancaire via l’ACPR.
En l’absence de base légale claire, la Banque de France exerce aujourd’hui des missions de puissance publique sans fondement constitutionnel. Ce vide juridique est d’autant plus préoccupant que l’institution est enregistrée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le numéro 572104891 et dispose d’un identifiant LEI (Legal Entity Identifier) n° 9W4ONDYI7MRRJYXY8R34, utilisé pour intervenir sur les marchés financiers internationaux.
Ces éléments démontrent que la Banque de France agit comme une entité commerciale de droit privé, ce qui est incompatible avec les prérogatives régaliennes qu’elle exerce. L’incompatibilité entre ses missions officielles et son statut d’opérateur privé rend l’ensemble de ses actes contestables, y compris les opérations de refinancement, de gestion de la dette publique, de surveillance bancaire et de coopération avec l’Union européenne.
En adossant l’ACPR à une institution privée dépourvue de légitimité législative, le Gouvernement a organisé une confusion volontaire entre droit public et droit privé, créant un outil de régulation monétaire et financière qui échappe à tout contrôle démocratique effectif.
Les établissements de crédit (Crédit Agricole, Sofinco, Cetelem, Cofidis, BPCE, etc.) sont dépourvus d’habilitation
L’ensemble des établissements de crédit opérant en France depuis 2000 — y compris les plus connus comme le Crédit Agricole, BNP Paribas, BPCE Financement, Sofinco, Cetelem, Cofidis ou encore Banque Casino — tirent leur « autorisation » d’exercer du Code monétaire et financier. Or, comme démontré précédemment, ce code repose sur une ordonnance non ratifiée, inconstitutionnelle, et consolidée de manière illégitime. Par conséquent, les agréments délivrés aux établissements de crédit sont dénués de fondement légal.
La délivrance des agréments relève aujourd’hui de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), elle-même adossée à la Banque de France. Or, ni l’ACPR, ni la Banque de France, ni le Code monétaire et financier ne disposent de la légalité requise pour fonder de tels actes. Aucun des agréments bancaires ou financiers délivrés depuis l’an 2000 n’a donc de valeur juridique opposable.
Cette situation emporte des conséquences massives : aucun de ces organismes n’était habilité à exercer légalement des activités de prêt, d’ouverture de compte, d’octroi de crédit ou de perception d’intérêts. Les contrats de prêt signés par des millions de citoyens avec ces entités sont dès lors frappés de nullité absolue, en application du droit commun des obligations (articles 1172, 1178 et 1182 du Code civil) et des principes fondamentaux du droit bancaire.
Il en découle que toutes les procédures fondées sur ces contrats — saisies, déchéances du terme, ventes aux enchères, fichages bancaires, inscriptions hypothécaires, etc. — ont été mises en œuvre par des organismes juridiquement inexistants ou agissant sans mandat légal. Cette chaîne d’illégalités constitue une atteinte systémique à l’État de droit, à la sécurité juridique et au droit de propriété garanti par la Constitution et les traités internationaux.
Violation systémique des droits et effondrement de l’État de droit
La responsabilité du Gouvernement, des présidents successifs, du Conseil d’État, du Conseil constitutionnel, des parlementaires et des partis politiques s’avère immense. Elle engage leur culpabilité dans la destruction progressive des droits fondamentaux et de l’État de droit en France.
Ces acteurs, prétendument garants de l’intérêt général et des principes républicains, ont validé ou laissé prospérer des dérives inconstitutionnelles majeures, notamment en légitimant des ordonnances frauduleuses, en détournant les processus démocratiques et en prenant des décisions contraires aux intérêts des citoyens. Pendant qu’ils s’octroyaient privilèges et immunités, une part croissante de la population sombrait dans l’injustice, la précarité, et l’arbitraire administratif et judiciaire.
La répétition des violations de la séparation des pouvoirs, le mépris systématique des délais constitutionnels, la manipulation des textes juridiques à des fins financières ou politiques, ainsi que l’absence totale de reddition de comptes, ont produit des effets ravageurs sur l’équilibre des institutions.
Les dirigeants bancaires, pleinement complices de cette fraude institutionnelle, ont exploité les failles législatives ouvertes par ces abus pour capter les richesses nationales, manipuler la masse monétaire et asseoir leur domination sur les citoyens par le biais d’un système de crédit, de titrisation et de recouvrement illégal.
La titrisation illégale, les saisies arbitraires, la destruction des statuts protecteurs, et la collusion directe entre le monde bancaire et les élites politiques ont donné lieu à un pillage organisé du tissu économique et social, ruinant des milliers de personnes, d’entreprises, et de familles.
La complaisance, voire la participation active de nombreux magistrats, juridictions et institutions de contrôle, a garanti l’impunité de ce système. Elle a vidé la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ainsi que les traités internationaux ratifiés par la France, de toute portée réelle.
Cette corruption généralisée implique également des commissaires de justice, des juges consulaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif, ainsi que des hauts fonctionnaires : tous unis, consciemment ou non, dans la consolidation d’un pouvoir illégal au détriment du peuple.
Sous couvert d’une légitimité républicaine dévoyée, ce système verrouille le droit et empêche toute contestation véritable. Il révèle une dérive autoritaire maquillée en démocratie, où les institutions prétendument garantes de la souveraineté populaire servent en réalité une minorité dominante.
La Constitution et la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, pourtant censées garantir les libertés fondamentales, sont violées par ceux-là mêmes chargés de les faire respecter. Il ne s’agit plus seulement d’un dysfonctionnement institutionnel, mais d’un basculement dans un régime de droit illusoire.
Face à ces violations systémiques, une question cruciale se pose : comment un régime qui méprise ses propres lois peut-il encore prétendre incarner la démocratie ? Et surtout : comment les citoyens peuvent-ils reconquérir leur souveraineté face à un système qui a fait de la fraude et du mensonge une méthode permanente de gouvernement ?
La titrisation depuis 2000 : montage illégal et spoliation des emprunteurs
La titrisation est un mécanisme financier permettant à une banque de transformer des créances (comme des crédits immobiliers ou à la consommation) en titres négociables sur les marchés financiers. Pour ce faire, elle cède ses créances à un fonds commun de titrisation (FCT), lequel émet des titres souscrits par des investisseurs. Ces derniers perçoivent les mensualités dues par les emprunteurs, à la place de la banque cédante, qui retrouve ainsi une liquidité immédiate. Une fois la cession effectuée, la banque ne détient théoriquement plus aucune créance sur l’emprunteur.
Ce système, introduit en France par la loi du 23 décembre 1988, reposait sur un encadrement législatif précis. Or, l’ensemble des dispositions régissant la titrisation a été abrogé par l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000, sans que la moindre base légale valide ne les remplace. Cette ordonnance étant elle-même entachée d’illégalité – pour violation de la loi d’habilitation, dépassement de délai, absence de ratification et annexes non authentifiées – les fondements juridiques de la titrisation ont disparu.
Depuis 2000, aucun texte en vigueur ne permet légalement de constituer un fonds commun de titrisation, de lui transférer des créances, ni d’émettre valablement des titres adossés à ces créances. Les FCT n’ayant pas de personnalité juridique propre, les cessions opérées à leur profit n'ont aucune valeur opposable. Ce vide législatif rend la pratique juridiquement inexistante.
Pourtant, les établissements bancaires ont continué à titriser massivement, comme si le cadre légal était intact : cessions de créances à des FCT, émission de titres financiers, perception continue de mensualités auprès d’emprunteurs devenus juridiquement étrangers à la banque initiale. Ces pratiques, opérées en dehors de tout fondement légal, relèvent du détournement de fonds. Elles peuvent être qualifiées d’escroquerie au sens de l’article 313-1 du Code pénal.
En parallèle, les investisseurs achètent des titres adossés à des créances cédées en violation du droit, sans garantie ni valeur juridique réelle. La titrisation devient ainsi une double imposture : les emprunteurs paient des sommes à des établissements qui ne sont plus leurs créanciers, tandis que les investisseurs financent des titres sans existence légale.
Cette situation crée une insécurité juridique massive. Les emprunteurs sont pleinement fondés à réclamer l’annulation de leur dette, la restitution des sommes indûment perçues, ainsi que la nullité des procédures d’exécution menées sur la base de créances cédées illégalement. Le régime de titrisation appliqué depuis 2000 est juridiquement inexistant, matériellement frauduleux et constitutionnellement insoutenable.
Il constitue une atteinte directe au droit de propriété, à la sécurité juridique, à la loyauté des relations contractuelles et, plus largement, à l’État de droit lui-même.
Conséquences juridiques de l’illégalité du Code monétaire et financier
L’absence de ratification des ordonnances ayant abrogé des dispositions législatives encore en vigueur a créé un vide juridique total en matière de régulation bancaire et financière. Depuis 2000, les banques, établissements de crédit, organismes de recouvrement, et même la Banque de France, agissent en dehors de tout cadre légal valide. Le Code monétaire et financier, prétendue base de leur autorité, n’a jamais acquis de force obligatoire, rendant l’ensemble du dispositif réglementaire juridiquement inexistant.
Sur le plan contractuel, cette situation entraîne l’invalidité de tous les actes juridiques reposant sur ce code : contrats de prêt, ouvertures de comptes, crédits revolving, garanties hypothécaires, cessions de créances, opérations de titrisation, recouvrements, etc. Selon l’article 1128 du Code civil, un contrat n’est valable que s’il repose sur un contenu licite. Or, le cadre réglementaire invoqué étant nul, tous ces contrats sont affectés d’un vice de fond entraînant leur nullité absolue au sens de l’article 1178 du même code. Les emprunteurs sont donc fondés à solliciter l’annulation de leurs dettes, la restitution des sommes indûment perçues, et l’inopposabilité de toute procédure en cours.
Sur le plan pénal, cette situation engage la responsabilité personnelle et collective des dirigeants publics et privés impliqués. Elle peut relever de la fraude institutionnelle et de l’escroquerie en bande organisée (article 313‑2 du Code pénal), de l’abus de confiance (article 314‑1), et de l’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation (article 410‑1 et suivants). Ces délits sont caractérisés par la création et l’exploitation d’un système illégal visant à capter les ressources privées sous une apparence de légalité institutionnelle.
Sur le plan procédural, les établissements bancaires, étant dépourvus de fondement légal et de capacité juridique, ne peuvent ni ester en justice, ni diligenter valablement des procédures de recouvrement. Le fichage des particuliers dans les fichiers FICP ou FCC est dès lors illégal, en ce qu’il viole l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (droit de propriété), l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la CEDH, ainsi que l’article 6 de cette convention relatif au droit à un procès équitable. Toute décision fondée sur un fichier entaché d’illégalité est elle-même nulle.
Sur le plan institutionnel, la disparition de toute base légale valide prive la Banque de France de toute autorité juridique. Ses statuts, abrogés sans ratification par l’ordonnance de 2000, n’ont jamais été remplacés. Son immatriculation au RCS et son enregistrement financier (code LEI) attestent d’une nature de droit privé incompatible avec l’exercice d’un pouvoir régalien. La gestion des finances publiques par une entité privée sans mandat législatif constitue une violation manifeste de la souveraineté budgétaire de la Nation.
Enfin, sur le plan économique, l’insécurité juridique générée par ce dispositif illégal met en péril l’épargne des citoyens, la validité des paiements électroniques, et la fiabilité des titres financiers. Elle permet des détournements massifs de fonds publics et privés sans contrôle démocratique, compromettant la stabilité monétaire et la confiance dans l’État.
Détournement des finances publiques : la complicité des institutions financières et politiques
L’immatriculation de la Banque de France au Registre du commerce et des sociétés de Paris (n° SIREN 572104891) et son enregistrement sur les marchés financiers internationaux (code LEI 9W4ONDYI7MRRJYXY8R34) révèlent un fait juridique d’une gravité extrême : l’institution supposément garante de la monnaie nationale et de la régulation monétaire publique agit en réalité comme une entité commerciale de droit privé, soumise aux règles du marché.
Ce statut non régalien, dissocié de toute base législative authentifiée, prive la Banque de France de toute légitimité institutionnelle à exercer des fonctions de puissance publique. En s’adossant à cette entité privée, l’État détourne de manière systématique l’argent public hors de tout contrôle parlementaire, au mépris de la souveraineté budgétaire inscrite à l’article 14 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Le financement de la dette publique en constitue le levier principal. En refusant de recourir à un financement direct et sans intérêts auprès de sa propre banque centrale (comme cela était encore possible jusqu’en 1973), l’État s’est volontairement soumis aux marchés financiers, empruntant à des conditions dictées par les établissements privés. Cette mécanique de dépendance, sciemment organisée, a eu pour effet d’augmenter artificiellement la dette, de restreindre les marges de manœuvre budgétaires et de justifier des politiques d’austérité socialement destructrices.
Tandis que les institutions financières bénéficient de taux proches de zéro pour se refinancer auprès de la Banque centrale, les citoyens, les PME et les collectivités locales sont confrontés à des conditions de crédit rigides, coûteuses et souvent discriminatoires. Ce système inégalitaire alimente une spoliation massive des richesses au profit d’une minorité d’acteurs financiers, tout en privant les services publics, la transition écologique et les investissements sociaux de ressources essentielles.
Il en résulte une inversion du principe républicain : ce n’est plus l’État qui gouverne l’économie selon l’intérêt général, mais les marchés qui gouvernent l’État selon l’intérêt privé. Cette capture des leviers budgétaires, opérée sans base légale, constitue un détournement de pouvoir manifeste, incompatible avec la démocratie, la Constitution et les principes fondamentaux du droit public.
La gestion des finances nationales par une structure privée immatriculée au RCS, non soumise à la législation organique, sans mandat législatif, sans contrôle des représentants du peuple, s’apparente à une fraude d’État. Elle engage la responsabilité directe de l’exécutif, du législatif, des organes de régulation monétaire et des directions financières impliquées.
En conclusion, cette collusion organisée entre le pouvoir politique et les intérêts financiers transforme l’endettement public en instrument de domination économique, et soumet l’ensemble de la population à un régime monétaire opaque, illégal et profondément injuste. Une question décisive demeure : dans ce système, qui détient réellement le pouvoir ? Le peuple souverain ou une oligarchie financière non élue ?
Pourquoi la dette publique est une escroquerie institutionnalisée ?
La dette publique française ne résulte pas d’un besoin économique réel, mais d’un choix politique délibéré : celui de renoncer à l’émission monétaire souveraine. Depuis les années 1970, l’État s’interdit de financer directement ses besoins via la Banque de France, préférant emprunter à intérêt sur les marchés financiers dominés par des institutions privées. Ce mécanisme, contraire à l’intérêt général, a engendré une dette artificielle alimentée par les seuls intérêts cumulés, sans bénéfice tangible pour la population.
Bien que dotée de missions régaliennes, la Banque de France est immatriculée comme société privée (SIREN 572104891) et enregistrée comme opérateur de marché (LEI 9W4ONDYI7MRRJYXY8R34). Elle agit ainsi en dehors de tout mandat constitutionnel, au service d’intérêts financiers privés. Cette anomalie institutionnelle permet à l’État de justifier des politiques d’austérité, au prétexte de rembourser une dette fictive, tandis que les banques commerciales perçoivent des profits garantis sans création réelle de valeur.
Cette construction frauduleuse viole les principes fondamentaux du droit public, détourne l’argent des contribuables, et asphyxie les finances publiques. Les citoyens n’ont pas à supporter les conséquences d’un système conçu pour les asservir économiquement.
Pour une démonstration complète de l’illégitimité de la dette publique et des mesures concrètes à engager, cliquez ici.
Personnes et institutions mises en cause
L’ampleur des violations législatives et constitutionnelles identifiées par la CISDHJ résulte d’une collusion systémique entre les pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire et financier. Chacun de ces organes a contribué à l’affaiblissement de l’État de droit et à la mise en œuvre d’un système monétaire dépourvu de toute légitimité juridique.
Le Gouvernement de la République française porte une responsabilité première : en multipliant les ordonnances non ratifiées, en outrepassant les lois d’habilitation et en contournant délibérément le Parlement, il a mis en place un Code monétaire et financier sans base légale. Cette stratégie a permis d’instaurer un dispositif de gestion des finances publiques adossé à des textes caducs, au profit d’intérêts privés.
La Banque de France, bien qu’elle prétende incarner l’autorité monétaire nationale, est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés et enregistrée comme entité commerciale sur les marchés internationaux. Elle est dirigée par des personnalités nommées par l’exécutif, et agit sans fondement législatif valide depuis l’abrogation non ratifiée de ses statuts en 2000. Elle administre pourtant les comptes du Trésor et participe activement à la politique monétaire, facilitant un détournement massif de fonds publics sans aucun contrôle démocratique.
L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), adossée à la Banque de France, délivre des agréments bancaires et supervise le secteur financier sans disposer d’une base juridique constitutionnellement valable. Elle agit au nom d’un code inexistant en droit, renforçant l’impunité des pratiques bancaires illégales, en particulier la titrisation de créances privées de toute valeur légale.
Les établissements de crédit — qu’il s’agisse du Crédit Agricole, de BPCE, de Cetelem, de Sofinco ou de Cofidis — exercent leurs activités sans cadre législatif opposable. Ils émettent des crédits, titrisent des créances inexistantes, procèdent à des recouvrements forcés et imposent des saisies sur le fondement d’agréments illégaux. Ces structures bénéficient de relais politiques et judiciaires leur garantissant une impunité totale, au détriment des droits fondamentaux des citoyens.
Les parlementaires, par leur abstention fautive, ont permis la caducité des projets de ratification. En validant a posteriori des textes inconstitutionnels ou en s’abstenant de les contester, ils ont failli à leur mission de législateur et de gardien du principe de légalité. Certains membres du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État ont quant à eux validé des ordonnances manifestement hors délai, méconnaissant la hiérarchie des normes et contribuant à cette dérive institutionnelle.
Enfin, les magistrats et juridictions de l’ordre judiciaire, en refusant d’examiner la validité des textes fondant les saisies, les poursuites et les décisions bancaires, ont entériné une fiction juridique contraire à l’ordre public. Par leur silence ou leur complaisance, ils ont participé à la consolidation d’un ordre illégitime et coercitif, dépouillant les citoyens de leurs droits les plus fondamentaux sous couvert d’une légalité de façade.
L’ensemble de ces acteurs forme un réseau institutionnalisé de collusion et de responsabilité partagée, dont les effets destructeurs sur les libertés, la souveraineté monétaire et la justice sociale justifient une enquête publique, un audit financier intégral, et des poursuites pour fraude institutionnelle d’État.
Violation systémique des droits et effondrement de l’État de droit
La responsabilité des autorités publiques dans la mise en place d’un système monétaire illégal, fondé sur des textes non ratifiés et des institutions privées, est pleinement engagée. Le Gouvernement, les présidents successifs, le Conseil d’État, le Conseil constitutionnel, les parlementaires et les partis politiques ont tous contribué à un processus de déconstruction méthodique de l’État de droit et des droits fondamentaux.
Présentés comme les garants de l’intérêt général, ces acteurs ont au contraire validé des ordonnances frauduleuses, contourné les procédures démocratiques, méconnu les délais constitutionnels et légitimé des décisions contraires à la souveraineté populaire. Tandis qu’ils bénéficiaient d’avantages croissants, une large partie de la population sombrait dans l’injustice, la précarité et l’arbitraire administratif et judiciaire.
La répétition des atteintes à la séparation des pouvoirs, l’absence totale de reddition de comptes, et la manipulation du droit à des fins politiques et financières ont gravement compromis les principes de justice, d’égalité et de légalité. Ces dérives ne relèvent plus de simples défaillances institutionnelles, mais bien d’une stratégie de consolidation du pouvoir au profit d’une minorité.
Les dirigeants bancaires, agissant en pleine complicité avec les pouvoirs publics, ont exploité les failles du droit pour s’approprier les richesses collectives, manipuler l’économie et asservir les citoyens dans un système de crédit, de titrisation et de recouvrement sans fondement juridique. Ce dispositif a été renforcé par la complaisance active de magistrats, de tribunaux de commerce, de commissaires de justice et de hauts fonctionnaires.
Le résultat est un véritable pillage institutionnalisé. La titrisation illégale, les saisies abusives, la destruction des protections légales et la fusion opaque entre intérêts politiques et financiers ont permis de ruiner des milliers de familles et d’entreprises. Les juridictions, loin d’exercer un contrôle effectif, ont souvent garanti l’impunité de ce système.
Ce réseau de collusion verrouille l’accès au droit, neutralise toute contestation réelle et impose un régime autoritaire dissimulé derrière des institutions prétendument républicaines. La Constitution et la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, censées être les fondements intangibles de notre ordre juridique, sont quotidiennement bafouées par ceux qui prétendent les incarner.
Dès lors, une question cruciale s’impose : comment un régime qui viole ouvertement ses propres lois peut-il encore revendiquer une quelconque légitimité démocratique ? Plus encore, comment les citoyens peuvent-ils reconquérir leur souveraineté face à un système ayant érigé la fraude en mode de gouvernance ?
Un esclavage moderne sous couvert de légalité
L’organisation juridique et financière actuelle, fondée sur des ordonnances non ratifiées et des institutions privées dépourvues de légitimité, a instauré un véritable esclavage moderne. Ce système repose sur des mécanismes législatifs frauduleux, des pratiques bancaires abusives et une justice largement complice, qui privent les individus de leur autonomie économique et les placent dans une servitude déguisée.
La servitude économique résulte principalement de l’endettement forcé. Les contrats de prêt et de crédit sont conclus sur la base d’un Code monétaire et financier caduc. Ils imposent aux citoyens un remboursement illimité de dettes sans fondement juridique. Les banques, après avoir titrisé ces créances et cédé les dettes à des tiers, continuent d’en exiger le paiement, malgré la perte totale de qualité de créancier. Cette exigence, dénuée de toute base légale, transforme l’emprunteur en débiteur perpétuel, réduit à une main-d’œuvre au service d’un système financier sans contrepartie contractuelle valable.
À cette logique s’ajoute une spoliation légalisée. La suppression progressive des protections légales et contractuelles a permis aux banques, assistées par les juridictions civiles et commerciales, de procéder à des saisies, expulsions et interdictions bancaires sans contrôle effectif de la légalité. Les textes protecteurs ont été volontairement abrogés pour permettre une captation systématique des biens privés, souvent orchestrée au profit d’intérêts économiques liés à la sphère politique ou financière.
La privation des libertés fondamentales est également manifeste. Le système judiciaire, gangrené par les conflits d’intérêts, agit moins comme garant des droits que comme instrument d’exécution des décisions financières. Les justiciables sont confrontés à des frais d’accès prohibitifs, à des délais judiciaires insoutenables, et à des décisions arbitraires contredisant les textes fondamentaux, révélant un effondrement programmé de l’État de droit.
Enfin, le contrôle de la population passe par des dispositifs technocratiques : le fichage bancaire généralisé (FICP, FCC), la suppression de l’usage de l’argent liquide, et la dépendance imposée aux paiements électroniques instaurent une surveillance permanente des transactions. Les saisies sur comptes bancaires, souvent automatisées, sont exécutées sans véritable recours effectif, instaurant un pouvoir de coercition immédiat.
Sous couvert de prétendues exigences économiques ou budgétaires, les gouvernements successifs ont institutionnalisé un modèle où le peuple travaille pour rembourser une dette fabriquée, où les petites entreprises sont fragilisées puis absorbées, et où la justice se met au service des intérêts financiers. Ce modèle ne constitue rien d’autre qu’un esclavage institutionnel moderne, fondé sur le mensonge légal et la dépossession méthodique du peuple.
Reprise du contrôle bancaire par le peuple
Face à l’absence de cadre légal valide des banques et organismes de crédit, il est devenu impératif de rétablir un contrôle public et citoyen du système bancaire et monétaire pour garantir l’intérêt général, la souveraineté nationale et la justice économique
La première étape consiste à nationaliser immédiatement les banques et organismes de crédit afin de les soumettre à une gouvernance démocratique et transparente, mettant fin à la primauté des actionnaires privés sur l’économie nationale et dissolvant les structures frauduleuses issues de textes invalides
Simultanément, la création d’une Banque Publique et Populaire, indépendante des intérêts privés et placée sous contrôle citoyen, permettra de redéfinir le rôle de la Banque de France comme véritable outil au service du peuple avec une gouvernance publique transparente
Un service bancaire universel doit être mis en place pour garantir un accès gratuit et équitable aux comptes, aux paiements et aux crédits de tous les citoyens, tandis qu’une monnaie nationale indépendante des marchés financiers assurera une stabilité économique et une protection contre la spéculation
La mise sous contrôle public entraînera l’éradication des abus bancaires par la suppression des fichages abusifs, le rétablissement des moyens de paiement, et l’annulation des dettes issues de mécanismes frauduleux
Le système monétaire redeviendra au service du peuple avec des taux d’intérêt stabilisés et sécurisés, un contrôle citoyen de l’émission monétaire, et une déconnexion des finances publiques de la spéculation mondiale
Enfin, la création d’une instance de surveillance citoyenne et parlementaire garantira l’interdiction des pratiques spéculatives dangereuses et des transferts illégaux, mettant un terme définitif à l’exploitation des citoyens par un système bancaire corrompu
Résultat de l’analyse de la CISDHJ
L’ensemble des développements précédents démontre que le Code monétaire et financier, prétendument consolidé par voie d’ordonnance, repose sur une architecture juridique inexistante. La loi d’habilitation n° 99‑1071 du 16 décembre 1999 a été détournée de sa finalité ; l’ordonnance n° 2000‑1223 du 14 décembre 2000 a procédé à des abrogations et substitutions de textes sans autorisation ni validation parlementaire ; sa ratification n’est jamais intervenue dans les formes constitutionnelles requises ; et les tentatives ultérieures de consolidation ont aggravé l’illégalité d’origine.
Cette situation a permis l’instauration d’un régime bancaire et financier parallèle, dénué de toute base légale, dans lequel des institutions privées — telles que la Banque de France, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) ou la Direction du Trésor — interviennent sans fondement législatif opposable ni contrôle démocratique effectif. Ces entités délivrent des agréments, supervisent les établissements de crédit, manipulent les flux financiers et assurent la gestion de la monnaie publique comme s’il s’agissait d’un patrimoine privé.
Il en résulte que l’ensemble des agréments bancaires et autorisations délivrés depuis 2000 — y compris ceux dont se prévalent le Crédit Agricole, Cetelem, Cofidis, Sofinco, BPCE Financement ou autres établissements de crédit — sont entachés de nullité absolue. Tous les contrats de prêt fondés sur ces bases sont viciés. Toutes les procédures de recouvrement, de saisie ou d’exécution forcée s’en trouvent juridiquement inopposables.
En parallèle, la poursuite illégale des mécanismes de titrisation — pourtant fondés sur des lois abrogées sans droit — a permis un détournement massif et systématique des flux financiers issus de prêts privés, sans garantie pour les investisseurs, ni droit de réclamation pour les emprunteurs. Ces opérations portent une atteinte directe au droit de propriété (article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789), au principe de légalité (article 16), et aux engagements internationaux de la France (article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la CEDH).
Face à cette architecture institutionnelle frauduleuse, contraire à tous les principes d’un État de droit, la Confédération Internationale pour la Sauvegarde des Droits de l’Homme et de la Justice (CISDHJ) appelle solennellement :
— à l’abrogation immédiate du Code monétaire et financier en tant que texte non ratifié, inconstitutionnel et inopposable ;
— à l’annulation de tous les agréments bancaires, autorisations ou enregistrements délivrés depuis l’an 2000 par des institutions dépourvues de légitimité ;
— à la reconnaissance judiciaire de la nullité absolue de tous les contrats, titres et procédures fondés sur ce corpus illégal ;
— à l’interdiction immédiate des procédures de recouvrement et de fichage (FICP, FCC) pratiquées par des entités privées sans fondement légal ;
— à la mise en œuvre d’un processus constitutionnel de refondation du droit bancaire, fiduciaire et monétaire sous contrôle populaire ;
— et à l’ouverture d’un audit public indépendant des comptes de la Banque de France, du Trésor public, de la Direction du Budget et des établissements de crédit habilités depuis 2000.
La souveraineté monétaire appartient au peuple. Elle ne peut être déléguée à des institutions privées sans trahir l’ordre républicain. Le peuple français est fondé à exiger la fin de ce régime de spoliation, et à reprendre le contrôle intégral de sa monnaie, de ses banques, de ses finances et de sa justice.