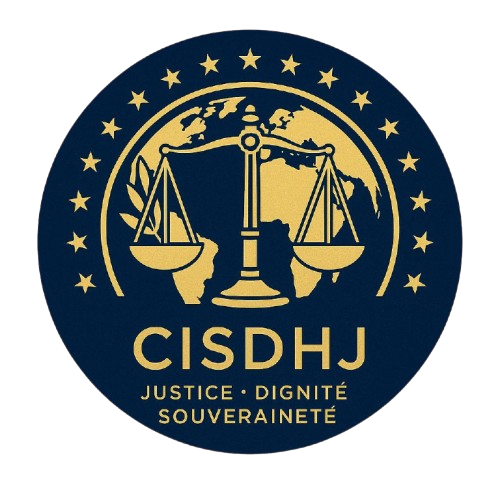Code des procédures civiles d’exécution
Un instrument de contrainte fondé sur une fraude législative
Le Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), présenté comme un outil moderne d’organisation des voies d’exécution en matière civile, est en réalité l’un des instruments les plus redoutables de la contrainte étatique contemporaine. Il encadre, structure et autorise toutes les formes de saisies, d’expulsions, de ventes judiciaires, de privations de biens et d’exécutions forcées à l’encontre des citoyens, des entreprises et des collectivités.
Depuis sa mise en application en 2012, ce code est utilisé quotidiennement par les magistrats, les commissaires de justice, les mandataires, les préfets et les administrations pour exécuter des décisions aux conséquences parfois irréversibles. Or, derrière l’apparence d’un texte codifié et officiel se cache une réalité accablante : le CPCE n’a jamais été adopté dans le respect des exigences constitutionnelles. Il repose sur une ordonnance devenue caduque, jamais ratifiée dans les délais, et validée par une loi postérieure en violation flagrante de la Constitution.
Loin d’être un simple défaut procédural, cette situation révèle une faille majeure dans l’architecture juridique de la République. Elle expose un mécanisme de contournement du suffrage universel, une falsification de la loi, et une complicité active des institutions censées protéger l’État de droit. Les actes d’exécution forcée opérés sur cette base sont illégaux, les décisions judiciaires prises en application de ce texte sont inconstitutionnelles, et les préjudices infligés aux citoyens sont incalculables.
La Confédération Internationale des syndicats des Droits de l’Homme pour la Justice (CISDHJ) présente ici une analyse exhaustive du CPCE, démontrant son invalidité juridique, les violations fondamentales de la hiérarchie des normes qui en résultent, et les responsabilités civiles, pénales et institutionnelles qui en découlent. Cette démonstration n’est pas seulement juridique : elle est politique, sociale, humaine. Elle engage l’honneur de la République et le droit des peuples à vivre dans un État fondé sur la loi, et non sur la fraude.
Sommaire
- Violation de la loi d’habilitation n° 2010-1609 du 22 décembre 2010
- Une ordonnance illégitime, au-delà du mandat parlementaire
- Un fondement juridiquement inexistant : caducité, ratification illégale et fiction constitutionnelle
- Responsabilité pénale des magistrats et fonctionnaires utilisant des textes illégaux
- Violation de la séparation des pouvoirs et des principes fondamentaux
- Responsabilité des parlementaires et des professionnels du droit : une trahison de leur mission
- Conséquences pour les citoyens, les entreprises et les administrations
- Conclusion de l’analyse de la CISDHJ
Violation de la loi d’habilitation n° 2010-1609 du 22 décembre 2010
La création du Code des procédures civiles d’exécution repose sur l’ordonnance prise en application de la loi d’habilitation n° 2010 1609 du 22 décembre 2010, adoptée sur le fondement de l’article 38 de la Constitution. Cette loi autorisait le Gouvernement à codifier la partie législative du droit des voies d’exécution, mais à des conditions très strictes, censées encadrer rigoureusement l’exercice de cette compétence exceptionnelle.
Selon les termes mêmes de l’article 7 de ladite loi, le Gouvernement n’était autorisé à intervenir que dans les limites d’une codification « à droit constant », c’est-à-dire sans aucune création normative nouvelle. Les seules modifications permises devaient être justifiées par des nécessités formelles : respect de la hiérarchie des normes, cohérence rédactionnelle des textes, harmonisation ponctuelle du droit applicable, notamment en matière de prescription, rectification d’erreurs, ou suppression de dispositions obsolètes. Il ne s’agissait donc en aucun cas d’un blanc-seing permettant d’introduire de nouveaux régimes juridiques, ni d’élargir les dispositifs existants de saisie ou d’exécution, encore moins de créer des mécanismes de contrainte inédits.
Cette loi d’habilitation fixait également des délais impératifs, sans lesquels l’ordonnance perdait toute validité. L’acte devait être pris dans un délai maximal de douze mois à compter de la promulgation de la loi, soit avant le 22 décembre 2011. Par ailleurs, un projet de loi de ratification devait être déposé devant le Parlement dans un délai strict de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. Ces délais n’étaient pas de simples recommandations, mais constituaient des conditions substantielles de validité de la procédure, imposées par le cadre constitutionnel lui-même.
Une ordonnance illégitime, au-delà du mandat parlementaire
L’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011, censée mettre en œuvre la loi d’habilitation n° 2010-1609, est allée bien au-delà du cadre juridique autorisé. En principe, cette ordonnance devait se limiter à organiser à droit constant les textes existants, sans en altérer le contenu, conformément à l’article 7 de la loi d’habilitation. Or, non seulement elle a modifié en profondeur les équilibres juridiques des procédures civiles d’exécution, mais elle a également procédé à des abrogations et substitutions normatives en contradiction flagrante avec le mandat législatif.
L’article 4 de l’ordonnance a ainsi abrogé la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, plusieurs dispositions du Code civil, du Code de la construction et de l’habitation, ainsi que d’autres textes législatifs, sans qu’aucune justification fondée sur les critères prévus par la loi d’habilitation ne soit apportée. Ces abrogations, loin de corriger de simples incohérences formelles, ont supprimé des normes en vigueur pour les remplacer par de nouvelles règles introduites dans le CPCE, modifiant de facto la substance même du droit applicable. De telles manœuvres ne sauraient être assimilées à une codification, mais relèvent d’une réforme déguisée.
L’article 3 de l’ordonnance, notamment, a altéré les règles relatives à la prescription, touchant à l’article 2244 du Code civil, alors que de telles modifications ne sauraient être qualifiées de corrections rédactionnelles. Le remplacement des termes « saisie-arrêt » par « saisie » dans plusieurs codes a en outre affecté l’interprétation juridique de nombreux actes, entraînant une requalification implicite de procédures existantes, sans que le législateur n’ait été consulté. Ces substitutions, opérées sans débat parlementaire, sont venues modifier des éléments de droit substantiel, en violation du principe de séparation des pouvoirs.
L’article 2 de l’ordonnance parachève cette fraude législative en affirmant que les références aux dispositions abrogées sont remplacées par celles du nouveau code. Une telle formulation, sous couvert d’un renvoi de pure forme, dissimule en réalité une réintroduction illégitime de normes expressément supprimées, sous de nouvelles numérotations. Le texte abrogé par voie réglementaire est ainsi recyclé, hors de tout contrôle démocratique, dans un corpus normatif prétendument cohérent, mais fondamentalement vicié.
Il convient de rappeler que le principe même d’une codification à droit constant implique une stricte neutralité : elle n’autorise ni la création de nouvelles obligations, ni la suppression de garanties existantes. Or, l’ordonnance du 19 décembre 2011 a réécrit, supprimé, reformulé et intégré des règles ayant des conséquences directes sur la substance du droit des citoyens. En matière de saisie, de prescription, de titre exécutoire ou de recours, elle a modifié les équilibres juridiques et les garanties procédurales fondamentales, sans aucune intervention du Parlement.
Cette méthode constitue une violation manifeste de l’État de droit. Le pouvoir exécutif, en s’arrogeant un rôle de législateur de fond sous prétexte de codification, a détourné l’objet même de la loi d’habilitation et trahi le mandat confié par le Parlement. Ce détournement de procédure n’est pas une simple erreur formelle, mais une fraude normative portant atteinte aux droits fondamentaux des justiciables. Il ne s’agit donc pas d’une codification, mais d’une réforme opérée sans base démocratique.
Or, conformément à la hiérarchie des normes, une ordonnance qui n’a pas été ratifiée dans les délais impartis ne peut avoir qu’une valeur réglementaire. Dès lors, elle ne peut ni abroger une loi législative, ni se substituer à elle. Seul un texte de même valeur peut abroger une loi en vigueur. Pourtant, l’ordonnance n° 2011-1895 a procédé à des abrogations massives, en violation de ce principe fondamental, sans que le Parlement ne soit intervenu. En droit strict, ces abrogations sont nulles, et les textes supprimés sont toujours en vigueur.
Les conséquences sont d’une gravité extrême. Toutes les procédures d’exécution fondées sur le CPCE reposent sur un socle juridique inexistant. Les actes pris sur cette base – saisies, contraintes, poursuites, expulsions – sont entachés d’illégalité. Les professionnels du droit, qu’il s’agisse de magistrats, de commissaires de justice ou d’administrateurs judiciaires, engagent leur responsabilité en appliquant un code sans valeur légale. L’État lui-même, en promulguant un texte irrégulier et en le faisant appliquer par la contrainte, se rend coupable d’une atteinte systémique aux principes de la légalité républicaine.
Ainsi, l’ordonnance du 19 décembre 2011 a violé le mandat législatif, contourné la souveraineté parlementaire, modifié un pan entier du droit sans autorisation, et produit des effets de droit profondément illégaux. En conséquence, le Code des procédures civiles d’exécution ne peut être regardé comme un texte légitime, opposable ou applicable. Il constitue une construction normative frauduleuse, et doit être dénoncé comme tel.
Or, comme cela sera démontré dans la section suivante, ces exigences n’ont pas été respectées, entraînant de fait l’inconstitutionnalité de l’ensemble du Code des procédures civiles d’exécution. Le Gouvernement a outrepassé le cadre de la délégation, tant sur le fond que sur la forme, violant ainsi le principe de séparation des pouvoirs et les droits fondamentaux des citoyens soumis à des procédures d’exécution fondées sur un texte privé de toute légitimité législative.
Un fondement juridiquement inexistant : caducité, ratification illégale et fiction constitutionnelle
Le Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), issu de l’ordonnance n° 2011‑1895 du 19 décembre 2011, repose sur une base juridique totalement viciée, pour plusieurs raisons distinctes mais convergentes : l’absence de ratification dans les délais impartis, une tentative de régularisation inconstitutionnelle par la loi n° 2015‑177, et une interprétation dévoyée du Conseil constitutionnel en 2020.
En vertu de l’article 38 de la Constitution, une ordonnance ne peut acquérir force de loi qu’à condition d’être expressément ratifiée par le Parlement, dans les délais prévus par la loi d’habilitation. À défaut, elle demeure un simple acte réglementaire, limité au domaine de compétence de l’exécutif, et ne peut ni créer, ni modifier, ni abroger une norme législative.
L’ordonnance n° 2011‑1895 a certes été adoptée in extremis dans le délai de douze mois prévu par l’article 7 de la loi d’habilitation n° 2010‑1609 du 22 décembre 2010. Mais le projet de loi de ratification, déposé le 15 février 2012 au Sénat sous le numéro 377, n’a jamais été inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale avant la fin de la législature en juin 2012. Ce projet est donc devenu caduc de plein droit. Le Gouvernement n’a jamais relancé la procédure devant le nouveau Parlement. Dès lors, l’ordonnance a définitivement perdu toute perspective de ratification et ne pouvait plus accéder au rang législatif.
En 2015, trois ans après l’expiration des délais, la loi n° 2015‑177 du 16 février a prétendu ratifier rétroactivement l’ordonnance de 2011, par le biais de son article 11. Cette manœuvre constitue une fraude législative manifeste. Une ordonnance devenue caduque n’a plus d’existence juridique à valider : elle est juridiquement morte. Toute ratification postérieure viole non seulement l’article 38 de la Constitution, mais également les principes de sécurité juridique, de non-rétroactivité de la loi (article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), et de séparation des pouvoirs.
Ce contournement constitutionnel a été aggravé par la décision n° 2020‑843 QPC du Conseil constitutionnel, qui a introduit l’idée qu’une ordonnance pourrait être « regardée comme législative » à défaut de rejet explicite à l’expiration du délai de ratification. Cette lecture dénature l’article 38, en assimilant le silence du Parlement à un consentement implicite. Elle transforme une exigence de ratification expresse en simple formalité secondaire, bafouant ainsi le principe selon lequel la loi est l’expression de la volonté générale adoptée par les représentants du peuple.
Dans le cas du CPCE, le Parlement n’a jamais débattu ni voté la ratification. Le projet de loi est devenu caduc. Aucune reprise, aucune discussion n’est intervenue. Le silence ne vaut pas loi. Le Conseil constitutionnel, en cautionnant cette dérive, a abandonné son rôle de garant de la hiérarchie des normes et permis l’imposition d’un texte majeur sans contrôle démocratique.
Ainsi, le Code des procédures civiles d’exécution repose sur une triple illégalité : une ordonnance non ratifiée dans les délais, une ratification rétroactive inconstitutionnelle, et une fiction juridique avalisée par une jurisprudence infidèle à la Constitution. Ce triptyque démontre que le CPCE est un instrument d’exécution sans fondement légal, inopposable aux citoyens, et nul de plein droit.
Responsabilité pénale des magistrats et fonctionnaires utilisant des textes illégaux
Dans un État de droit digne de ce nom, nul ne peut se prévaloir de l’ignorance de la loi, encore moins les magistrats, fonctionnaires, officiers publics et ministériels chargés de l’appliquer. L’obligation de respecter le principe de légalité incombe à tous les agents de l’État, à tous les membres de l’autorité judiciaire et à tous les auxiliaires de justice. Cette obligation est d’autant plus impérieuse lorsqu’il s’agit d’un texte fondant la contrainte publique, tel que le Code des procédures civiles d’exécution.
L’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011, qui a institué ce code, est devenue juridiquement caduque en 2012, faute d’avoir été ratifiée dans les délais fixés par la loi d’habilitation. Dès cette date, elle a perdu toute possibilité d’acquérir une valeur législative. Elle ne pouvait donc plus servir de fondement valable à quelque mesure de contrainte que ce soit. L’ensemble des actes pris postérieurement sur la base de ce texte, qu’il s’agisse de saisies, d’expulsions, de contraintes, de jugements ou de décisions administratives, reposent sur un fondement inexistant. Leur exécution constitue une violation manifeste du principe de légalité garanti tant par le droit national que par les conventions internationales.
L’article 5 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen rappelle que « tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas ». Appliquer un texte caduc, inopposable et inconstitutionnel constitue donc une usurpation d’autorité et une voie de fait. Un magistrat ne saurait se retrancher derrière une prétendue ignorance de l’irrégularité d’un texte, encore moins lorsqu’il s’agit d’un texte fondamentalement contesté, dont l’illégalité est connue, documentée et publique. Il en va de même pour tout fonctionnaire d’autorité ou tout auxiliaire de justice. Leur devoir de loyauté envers la Constitution prime toute instruction hiérarchique ou administrative.
En persistant à appliquer l’ordonnance de 2011 après sa caducité, ces agents publics commettent une faute grave. Leur responsabilité personnelle peut être engagée sur le plan disciplinaire, civil et pénal. Le fait d’exécuter des mesures fondées sur un texte privé de valeur légale constitue un abus de pouvoir. Lorsqu’il est répété, systémique, ou lorsqu’il porte atteinte à des droits fondamentaux – comme le droit de propriété, le droit à un recours effectif ou le respect du contradictoire – cet abus peut être requalifié en déni de justice ou en forfaiture.
Les citoyens victimes de décisions judiciaires ou administratives reposant sur le Code des procédures civiles d’exécution ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent contester la validité de ces décisions, demander leur annulation, et réclamer réparation pour les préjudices subis. Ces recours ne visent pas seulement l’État, mais aussi les personnes physiques qui ont sciemment appliqué un texte dénué de légitimité. La protection fonctionnelle prévue par le statut de la fonction publique ne saurait couvrir les actes manifestement illégaux. La jurisprudence administrative et judiciaire reconnaît d’ailleurs que la responsabilité individuelle d’un agent peut être engagée en cas de faute détachable du service.
L’application de l’ordonnance n° 2011-1895 après sa caducité constitue une telle faute. Elle engage non seulement la responsabilité des auteurs directs, mais aussi celle des supérieurs hiérarchiques, des ordonnateurs, des greffiers, des commissaires de justice et de tous ceux qui, en connaissance de cause, ont prêté leur concours à une procédure irrégulière. L’argument selon lequel un texte irrégulier mais appliqué depuis longtemps deviendrait régulier par habitude ou par tolérance n’a aucune valeur juridique. Il n’existe pas de prescription de l’illégalité constitutionnelle.
En conclusion, toute personne ayant contribué à l’application ou à l’exécution de l’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 après sa caducité engage sa responsabilité. Les magistrats et agents publics ne peuvent ignorer qu’ils ont agi sans fondement légal. Ils devront en répondre devant les juridictions compétentes. L’argument d’autorité ne saurait prévaloir sur l’exigence de légalité. Et la légalité exige, en toute circonstance, la conformité des actes au droit, à la Constitution et à la souveraineté du peuple.
Violation de la séparation des pouvoirs et des principes fondamentaux
L’élaboration, la ratification et l’application du Code des procédures civiles d’exécution constituent une violation manifeste des principes constitutionnels les plus fondamentaux. L’ordonnance n° 2011-1895, devenue caduque en 2012, a été frauduleusement maintenue en vigueur, puis prétendument ratifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, dans des conditions radicalement contraires à la Constitution, à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC), à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), ainsi qu’au droit de l’Union européenne.
La loi constitutionnelle du 3 juin 1958, fondement direct de la Cinquième République, impose expressément la séparation des pouvoirs, le respect de la hiérarchie des normes et l'existence d’un contrôle de constitutionnalité effectif. Ces principes ne sont pas accessoires : ils conditionnent la validité même de tout texte législatif ou réglementaire. En avalisant une ratification illégale en 2015, le Conseil constitutionnel a failli à sa mission. Il n’a exercé aucun contrôle sur la régularité du processus législatif, autorisant ainsi une violation structurelle de la Constitution et du principe démocratique.
Cette dérive ne saurait être présentée comme un accident isolé. Elle s’inscrit dans une fraude institutionnelle récurrente, où le pouvoir exécutif contourne les mécanismes de représentation nationale pour imposer des normes illégales par la voie des ordonnances. Le Conseil constitutionnel, loin d’exercer un contre-pouvoir, a systématiquement validé ces pratiques, devenant un organe d’accompagnement des dérives gouvernementales. Par ce comportement, il contribue à l’effacement de la souveraineté parlementaire et à l’érosion de la séparation des pouvoirs. Cette dérive ne saurait être présentée comme un accident isolé. Elle s’inscrit dans une fraude institutionnelle récurrente, où le pouvoir exécutif contourne les mécanismes de représentation nationale pour imposer des normes illégales par la voie des ordonnances. Le Conseil constitutionnel, loin d’exercer un contre-pouvoir, a systématiquement validé ces pratiques, devenant un organe d’accompagnement des dérives gouvernementales. Par ce comportement, il contribue à l’effacement de la souveraineté parlementaire et à l’érosion de la séparation des pouvoirs.
Cette situation viole également les dispositions les plus fondamentales de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. L’article 1er, qui affirme l’égalité en droits de tous les citoyens, est méconnu dès lors que des textes inconstitutionnels sont appliqués à certains justiciables, en dehors de toute légalité. L’article 6 est lui aussi violé : la loi, censée être l’expression de la volonté générale, n’a ici jamais été débattue ni votée, car l’ordonnance de 2011 a échappé au contrôle parlementaire. Plus grave encore, l’article 16 de la DDHC affirme qu’une société où la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. L’application du CPCE fondé sur une ordonnance caduque prive donc la République de toute légitimité constitutionnelle effective. Enfin, l’article 17, qui consacre le caractère inviolable et sacré du droit de propriété, est directement bafoué par les procédures de saisie et d’exécution forcée opérées sur la base d’un texte juridiquement inexistant.
Les violations s’étendent également à la Convention européenne des droits de l’homme. L’article 6 garantit le droit à un procès équitable, devant un tribunal établi par la loi. Or, juger un citoyen sur le fondement d’un texte caduc constitue un déni de justice manifeste. L’article 1er du Protocole additionnel, qui protège le droit de propriété, est lui aussi méconnu, puisque des saisies sont réalisées sans base légale. L’article 7 de la CEDH, tout comme l’article 8 de la DDHC, proscrit toute rétroactivité de la loi pénale. La ratification illégitime de l’ordonnance en 2015, trois ans après sa caducité, viole donc de manière frontale ces garanties fondamentales.
Sur le plan du droit de l’Union européenne, les manquements sont tout aussi graves. L’article 2 du Traité sur l’Union européenne impose à tous les États membres le respect de l’État de droit, de la démocratie et de la séparation des pouvoirs. L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union garantit un droit effectif à un recours et à un procès équitable. En continuant à appliquer le CPCE malgré l’illégalité manifeste de son fondement, l’État français viole directement ces principes. De plus, le recours à une norme frauduleusement présentée comme législative constitue une atteinte au principe de confiance légitime, en trompant les citoyens et les entreprises sur la régularité du droit applicable.
À cela s’ajoute un conflit d’intérêts structurel entre les organes de l’État. Le Conseil constitutionnel, censé être indépendant, est en réalité étroitement dépendant du pouvoir politique. Il est composé de membres nommés par les plus hautes autorités de l’exécutif et du Parlement, lesquelles appartiennent le plus souvent aux mêmes partis. Cette proximité crée une confusion de rôles. Le Conseil, loin de censurer les excès, accompagne les violations constitutionnelles. Il valide systématiquement les lois et ordonnances qui étendent les prérogatives de l’exécutif, sans exercer le moindre contrôle sur leur légalité. Jamais il n’a censuré une ordonnance pour violation des articles 38 ou 16 de la Constitution, même lorsqu’elles ont manifestement contourné la souveraineté populaire.
Il en résulte un effondrement des garanties constitutionnelles. La loi n’est plus l’expression de la volonté générale, mais un instrument de pouvoir au service d’intérêts politiques. Le droit cesse d’être une protection pour devenir un vecteur de domination. Le fondement juridique du Code des procédures civiles d’exécution est non seulement inexistant, mais son application constitue une violation systémique des droits fondamentaux. Ce constat appelle des recours nationaux et européens, et une mobilisation immédiate des citoyens pour restaurer la légalité, la souveraineté et la justice dans la République.
Responsabilité des parlementaires et des professionnels du droit : une trahison de leur mission
La crise de légalité révélée par l’ordonnance n° 2011-1895 et le Code des procédures civiles d’exécution ne peut être imputée uniquement au pouvoir exécutif. Elle engage également, de manière directe et grave, la responsabilité des parlementaires, des représentants de l’État et des professionnels du droit, qui ont failli à leur mission fondamentale de garantie de l’ordre constitutionnel et du respect des droits fondamentaux.
L’article 24 de la Constitution confie au Parlement le soin de voter la loi, mais aussi de contrôler l’action du Gouvernement. En omettant de s’opposer à la ratification illégitime de l’ordonnance en 2015, et en tolérant l’application d’un texte devenu caduc dès 2012, les députés et sénateurs ont trahi la mission que leur conférait la souveraineté nationale. Ils n’ont exercé aucun contrôle démocratique. Ils ont fermé les yeux sur les atteintes manifestes à la hiérarchie des normes et ont laissé l’exécutif gouverner par ordonnances, au mépris du principe de séparation des pouvoirs. La plupart n’ont agi que selon les consignes partisanes, sacrifiant leur rôle de représentants du peuple à des intérêts électoraux, financiers ou de carrière.
Cette défaillance institutionnelle a eu des conséquences humaines tragiques. Le maintien en vigueur d’un code sans base légale a légitimé des saisies, des expulsions, des liquidations, des procédures judiciaires d’une violence sociale extrême. Des familles entières ont été précipitées dans la ruine, certains citoyens dans la détresse psychologique ou jusqu’au suicide, alors même que les mesures dont ils étaient victimes reposaient sur un texte juridiquement inexistant. Cette réalité dépasse le simple manquement politique. Elle engage la responsabilité pénale des parlementaires.
En acceptant, voire en validant expressément, des lois et ordonnances inconstitutionnelles, les membres du Parlement peuvent être considérés comme complices de forfaiture, d’abus d’autorité (article 432 1 du Code pénal), de mise en danger délibérée de la vie d’autrui, voire d’homicide involontaire par abstention fautive (article 221 6). Leur silence, leur inaction ou leur complicité face à des violations majeures du droit républicain les rendent comptables des souffrances qu’ils ont contribué à institutionnaliser. Ils devront en répondre devant l’histoire, mais aussi devant le droit.
Cette responsabilité ne s’arrête pas au Parlement. L’ensemble des professions juridiques, judiciaires, administratives et ordinales se trouve également engagé. Commissaires de justice, mandataires judiciaires, avocats, notaires, greffiers, préfets, présidents de région, directeurs d’administrations – tous ont poursuivi, assisté ou ordonné des actes d’exécution, des procédures de contrainte, des décisions graves en s’appuyant sur un texte manifestement illégal. Tous avaient l’obligation, en vertu de leur serment professionnel et de leur statut, de vérifier la légalité des textes qu’ils appliquaient
En continuant d’invoquer l’ordonnance n° 2011-1895 après sa caducité, ces agents publics et auxiliaires de justice se sont rendus coupables d’une application fautive du droit. Ils ont violé leur serment de loyauté envers la loi. Ils ont justifié des spoliations massives, des expulsions sans fondement, des décisions contraires à la justice et à la dignité humaine. Ils sont ainsi susceptibles de poursuites pour complicité de forfaiture, abus de pouvoir, fautes professionnelles graves, voire mise en danger de la vie d’autrui, dès lors que leurs actes ont eu pour conséquence la ruine, l’atteinte à la santé, ou le désespoir de citoyens placés dans des situations extrêmes.
Aucun de ces acteurs ne peut prétendre à l’ignorance. Depuis plus de dix ans, les questions juridiques autour du CPCE, de la ratification de l’ordonnance, de la séparation des pouvoirs, ont été soulevées par de nombreux juristes, citoyens, syndicats, associations. L’illégalité est connue, documentée, établie. Le maintien de cette fiction normative, avec la complicité active ou passive de ceux qui ont prêté serment de défendre le droit, constitue un des plus grands scandales juridiques de la République contemporaine.
La responsabilité collective de ces institutions est immense. Leur silence est une trahison. Leur persistance à appliquer un texte inexistant est un crime contre la justice. Cette compromission généralisée justifie non seulement l’annulation de toutes les procédures fondées sur le CPCE, mais aussi l’ouverture de poursuites disciplinaires, civiles et pénales contre les auteurs, complices et instigateurs de cette violation organisée de l’ordre constitutionnel.
Conséquences pour les citoyens, les entreprises et les administrations
La nullité de l’ordonnance n° 2011 1895 et l’inconstitutionnalité manifeste du Code des procédures civiles d’exécution entraînent des conséquences d’une extrême gravité pour l’ensemble du tissu social, économique et institutionnel du pays. Ce n’est pas seulement l’appareil juridique qui se trouve discrédité : ce sont des vies humaines, des entreprises et des collectivités entières qui ont été brisées par l’application d’un texte juridiquement inexistant.
Toutes les mesures d’exécution forcée — saisies mobilières, saisies-attributions, expulsions, ventes aux enchères, liquidations judiciaires — fondées sur le CPCE depuis 2012 sont entachées d’irrégularité. Elles reposent sur un fondement juridique nul. Ces procédures, initiées sur la base d’un texte caduc et jamais ratifié, sont contestables dans leur intégralité. Elles n’ont aucune valeur légale, et leurs effets doivent être annulés.
Des entreprises ont été liquidées, parfois en quelques semaines, sur la seule base de procédures engagées par des mandataires, huissiers ou greffiers s’appuyant sur des dispositions du CPCE. La conséquence directe en est la destruction de milliers d’emplois, la disparition de savoir-faire locaux, l’éviction d’entrepreneurs et la concentration des actifs entre les mains d’acteurs financiers ou institutionnels proches du pouvoir. Ces faillites ne sont pas seulement des échecs économiques : elles sont le produit d’un détournement juridique, qui a permis la spoliation d’outils de production et de patrimoine professionnel au moyen d’un code sans base légale.
Dans le même temps, des titres exécutoires ont été établis contre des particuliers et des sociétés, sur la base de décisions rendues à l’appui du CPCE. Des prélèvements bancaires, des saisies sur rémunération ou sur comptes, des ventes judiciaires, ont été effectués alors que leur fondement normatif était caduc. Ces actes sont juridiquement viciés, et les sommes perçues au titre de procédures d’exécution illégales doivent être restituées.
Les juridictions, en se fondant sur ce code pour condamner, saisir, ou valider des procédures d’exécution, ont elles-mêmes produit des décisions inconstitutionnelles. Ces décisions doivent être contestées et annulées. Elles n’ont pas été rendues selon un droit en vigueur, mais selon une fiction juridique. Toute personne frappée par une décision d’exécution fondée sur le CPCE doit pouvoir faire reconnaître l’irrégularité du fondement juridique et obtenir réparation.
Les conséquences humaines de cette fraude sont incalculables. Des citoyens ont été expulsés de leur domicile, privés de leurs biens, privés de leurs revenus, placés sous procédures judiciaires interminables, sans que les textes ayant permis ces mesures aient la moindre validité. Cette situation a provoqué un appauvrissement massif, des troubles psychologiques graves, des ruptures sociales, familiales, économiques, et dans les cas les plus extrêmes, des suicides. L’État, par son inertie et sa complicité, est pleinement responsable de cette violence institutionnelle.
La responsabilité de l’État est ici engagée pour faute lourde. Il en va de même pour tous les agents publics, officiers ministériels, administrations, collectivités territoriales, ordres professionnels, qui ont exécuté ou ordonné des actes reposant sur un texte manifestement illégal. Tous doivent répondre de leurs actes, et assumer la charge des réparations dues aux victimes. Les citoyens, entreprises et associations doivent pouvoir engager des recours en responsabilité contre l’État et ses agents, pour obtenir une juste indemnisation des préjudices subis.
Enfin, cette situation appelle une mobilisation générale. Des actions en justice, collectives et coordonnées, doivent être entreprises pour exiger l’annulation de toutes les procédures fondées sur le CPCE, la restitution des biens et sommes indûment saisis, la réintégration des entreprises spoliées, et la condamnation des auteurs de cette fraude normative. Le droit ne peut être respecté que s’il est défendu. Et la République ne peut subsister que si ses institutions sont rendues à la légalité.
Conclusion de l’analyse de la CISDHJ
Le Code des procédures civiles d’exécution est juridiquement nul, inopposable et inapplicableAu terme de cette démonstration rigoureuse, la CISDHJ constate que le Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), instauré par l’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011, est juridiquement inexistant. Ce texte n’a jamais été valablement ratifié. Il est devenu caduc dès 2012, et la tentative de le valider par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 constitue une violation manifeste de la Constitution, des principes de légalité, de non-rétroactivité, et de séparation des pouvoirs.
En validant a posteriori une ordonnance morte juridiquement, les institutions de la République ont commis une fraude normative d’une gravité extrême. Le Conseil constitutionnel a renié sa mission de gardien de la hiérarchie des normes. Le Parlement a renoncé à son rôle de contre-pouvoir. Le pouvoir exécutif a imposé, par voie réglementaire, un texte sans fondement législatif. Les juridictions ont poursuivi son application en violation des principes fondamentaux du droit.
Les conséquences de cette imposture sont dramatiques. Des citoyens ont été saisis, expulsés, ruinés. Des entreprises ont été liquidées. Des décisions judiciaires ont été rendues sans base légale. Des titres exécutoires ont été établis sur un code caduc. L’ensemble de l’appareil d’exécution forcée repose ainsi sur une fiction juridique, instrumentalisée au service d’intérêts politiques, économiques et financiers.
Cette situation n’est pas une simple irrégularité. Elle constitue un effondrement de l’État de droit. Une société où des mesures de contrainte sont exécutées sans base législative, où la séparation des pouvoirs est annihilée, où les citoyens n’ont plus aucun recours effectif contre la machine judiciaire, n’a plus de Constitution. Elle n’est plus une démocratie.
Le Code des procédures civiles d’exécution ne repose sur aucun fondement légitime. Il doit être dénoncé, combattu et révoqué. La souveraineté appartient au peuple. Et aucun texte, aucun pouvoir, aucune procédure ne peut prévaloir contre le droit et la justice.
Explorer d’autres analyses :
- Les professions judiciaires affiliées aux tribunaux de commerce: un système illégal fondé sur des textes abrogés et des institutions inexistantes
- Commissaires de Justice : Profession sans Fondement Légal
- Code de commerce et tribunaux de commerce : l’une des plus grandes fraudes institutionnelles de la République