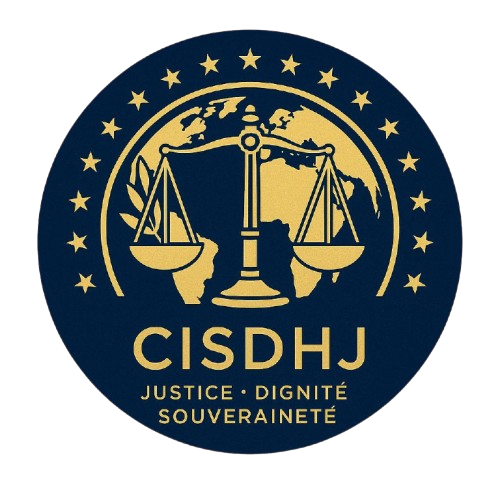Professions judiciaires réglementées
Les professions judiciaires affiliées aux tribunaux de commerce : un système illégal fondé sur des textes abrogés et des institutions inexistantes
Depuis la codification frauduleuse du Code de l’organisation judiciaire en 1978, la justice commerciale française repose sur un socle juridique profondément vicié. Les tribunaux de commerce, bien qu’apparus dès l’Ancien Régime, ont été maintenus sous la Cinquième République sans qu’aucune loi n’ait jamais expressément réinstitué leur existence dans le respect des exigences constitutionnelles. Pire encore, leur prétendue légitimité repose aujourd’hui sur un décret simple — le décret n°78 329 du 16 mars 1978 — qui a opéré une substitution illégale de normes réglementaires à des textes législatifs antérieurs, en contradiction flagrante avec l’article 34 de la Constitution.
Cette anomalie n’est pas restée cantonnée aux seules juridictions : elle a irrigué l’ensemble des professions qui gravitent autour des tribunaux de commerce, et qui en tirent leur pouvoir d’agir. Greffiers, administrateurs judiciaires, mandataires, commissaires de justice, experts ou encore notaires interviennent dans des procédures de redressement, liquidation, saisie ou vente, alors même que leur statut repose sur des textes abrogés, non ratifiés ou pris par des autorités incompétentes. Beaucoup exercent en outre sous forme de sociétés commerciales — SCP, SELARL ou SELAS — sans qu’aucun fondement législatif en vigueur ne les y autorise.
Il en résulte une dérive institutionnelle massive, où des fonctions d’autorité sont exercées par des structures sans existence légale, dans le silence — ou avec la complicité — des pouvoirs publics. Ces professions ne se contentent pas d’opérer dans un cadre juridiquement instable : elles valident, déclenchent et exécutent des procédures privatives de droits, entraînant ruine économique, saisies forcées, ventes aux enchères illégales, et spoliations patrimoniales irréversibles.
Cette page établit de manière rigoureuse et documentée que l’ensemble des professions judiciaires rattachées aux juridictions commerciales françaises exerce dans un vide juridique absolu depuis plus de quarante ans. Elle démontre que les fondements textuels invoqués — lois de 1966, 1987, ordonnances de 2000 à 2023, décrets de codification, articles insérés dans les annexes de décrets — sont tous inopposables, inconstitutionnels ou abrogés.
En révélant l’ampleur de cette fraude institutionnelle, il ne s’agit pas seulement de remettre en cause des mécanismes techniques ou des textes secondaires. Il s’agit d’affirmer un principe fondamental : dans un État de droit, nul ne peut être jugé, poursuivi ou ruiné par des institutions ou des personnes dépourvues d’existence légale.
Sommaire
- Le décret n°78 329 du 16 mars 1978 : fondement illégal d’un appareil judiciaire parallèle
- La loi du 16 juillet 1987 : dissimulation législative et validation rétroactive d’un ordre juridictionnel illégal
- La loi du 17 décembre 1991 : l’aveu d’un effondrement juridique et l’enterrement des professions rattachées
- L’ordonnance de 2000 : la résurrection fictive des professions judiciaires commerciales sur fond de vide juridique
- La tentative de régularisation par ordonnance : une fraude aggravée entre 2006 et 2009
- L’illégalité radicale de l’exercice en société des professions judiciaires commerciales : une fraude institutionnelle généralisée
- Un système global de dissimulation et de validation illégale : de la constitution aux fonctions exercées
- L’ordonnance n°2023 77 du 8 février 2023 : une tentative avortée de régularisation sur fond d’inexistence juridique
- L’effondrement juridique du cadre professionnel : conséquences directes et systémiques
- Les structures ordinales et syndicales : complices de la fraude par organisation illégale de professions inexistantes
- Conclusions sur l’illégalité des tribunaux de commerce, du Code de l’organisation judiciaire, du Code de commerce
- Les autres professions libérales réglementées : un régime d’exercice en société juridiquement inexistant
- Une chaîne opaque de captation des biens dans les procédures collectives
- Conséquences juridiques directes : responsabilité, nullité, inconstitutionnalité et rupture des droits fondamentaux
- Bilan systémique : responsabilité des institutions, ampleur de la fraude
- Conclusion générale de l’analyse de la CISDHJ : Une République hors-la-loi, une souveraineté confisquée
Le décret n°78 329 du 16 mars 1978 : fondement illégal d’un appareil judiciaire parallèle
Le point d’origine de la fraude institutionnelle qui gangrène l’organisation judiciaire commerciale en France remonte au décret n°78 329 du 16 mars 1978, par lequel le gouvernement a prétendu instituer, par simple voie réglementaire, la « première partie (législative) » du Code de l’organisation judiciaire. Ce décret, présenté comme une mesure de simplification, a en réalité opéré un bouleversement inconstitutionnel majeur : il a substitué un acte réglementaire à un ensemble de lois, sans l’intervention du Parlement.
À travers ce texte, l’exécutif a codifié des dispositions relatives à l’organisation judiciaire, à la compétence des juridictions, à la structuration des greffes et des fonctions judiciaires, en les insérant dans un corpus présenté comme ayant valeur législative. En parallèle, il a abrogé une série de textes législatifs historiques, parmi lesquels les articles 631 à 640 de l’ancien Code de commerce, qui fondaient expressément le statut, les émoluments et la nomination des greffiers des tribunaux de commerce. Le décret a ainsi effacé un pan entier du droit sans habilitation parlementaire.
Cette opération repose sur une lecture frauduleuse de l’article 15 de la loi n°72 626 du 5 juillet 1972, qui prévoyait la simplification des textes, mais ne permettait en aucun cas d’abroger des dispositions législatives ou de codifier des normes relevant de l’article 34 de la Constitution. Or, cet article réserve formellement à la loi le soin de fixer les règles relatives à la création des juridictions, à l’organisation judiciaire, aux statuts des officiers publics et ministériels, et aux procédures civiles.
Le Conseil constitutionnel a rappelé à maintes reprises que seul le Parlement peut édicter ou modifier des normes de niveau législatif. En procédant par simple décret à la refonte complète d’un code législatif, sans ratification parlementaire, l’exécutif a outrepassé ses compétences, créant une codification inconstitutionnelle, sans valeur légale.
Les conséquences sont profondes. En abrogeant les articles du Code de commerce qui fondaient légalement l’existence des greffiers des tribunaux de commerce, sans les remplacer par une loi, et en insérant à leur place les articles L.821 1 à L.821 3 dans une annexe dépourvue de force législative, le gouvernement a anéanti le fondement juridique de cette profession. Il en va de même pour les juridictions commerciales elles-mêmes, dont la base constitutionnelle a été supprimée, les réduisant à une existence fictive et illégale.
La situation est identique pour les administrateurs et mandataires judiciaires. Avant 1985, ces fonctions existaient sous diverses appellations (syndics de faillite, commissaires à l’exécution du concordat), sans régime unifié. La loi du 13 juillet 1967 avait introduit des listes d’administrateurs pour les procédures de redressement et des syndics pour les liquidations, mais sans leur conférer un véritable statut législatif autonome. Ces fonctions restaient entièrement rattachées aux juridictions commerciales, elles-mêmes désormais privées de toute base légale depuis le décret de 1978.
La loi n°85 98 du 25 janvier 1985 a bien tenté d’unifier ces professions, mais sans recréer de base juridictionnelle valide. Elle ne mentionne jamais explicitement les tribunaux de commerce comme juridictions compétentes, et s’inscrit dans un vide juridique laissé par l’abrogation des textes fondateurs. En outre, les commissions d’inscription des administrateurs et mandataires sont rattachées aux cours d’appel, dont l’organisation repose elle aussi sur le Code de l’organisation judiciaire issu du décret de 1978, et donc frappé d’inconstitutionnalité.
Depuis le 16 mars 1978, toutes les professions judiciaires rattachées aux juridictions commerciales — greffiers, administrateurs judiciaires, mandataires — exercent dans un cadre dénué de fondement légal. Leurs nominations, leurs actes, leurs procédures, et même leur existence juridique, sont affectés d’une nullité radicale. Ce décret marque ainsi le point de rupture : c’est lui qui a fait basculer la justice commerciale dans l’illégalité structurelle, en effaçant les fondements législatifs des fonctions qui en assuraient le fonctionnement.
La loi du 16 juillet 1987 : dissimulation législative et validation rétroactive d’un ordre juridictionnel illégal
Présentée comme une réforme de modernisation du droit judiciaire commercial, la loi n°87-550 du 16 juillet 1987 a en réalité opéré une dissimulation législative d’une rare gravité. Loin de rétablir un fondement légal clair aux juridictions commerciales, elle a couvert a posteriori le coup de force institutionnel commis par le décret n°78-329 du 16 mars 1978, en légitimant sans le dire l’introduction illégale, par voie réglementaire, des dispositions du Code de l’organisation judiciaire (COJ) concernant les tribunaux de commerce. Ce décret, inconstitutionnel dans sa forme comme dans son contenu, avait prétendu créer des juridictions et fixer leurs règles de fonctionnement, sans loi d’habilitation, en violation manifeste des articles 34 et 38 de la Constitution.
Plutôt que de dénoncer cette usurpation de la fonction législative, la loi du 16 juillet 1987 l’a tacitement consacrée. En reprenant à son compte les articles L.411-1 à L.414-7 du COJ, relatifs aux tribunaux de commerce, sans jamais interroger leur origine réglementaire, elle a donné une apparence de légalité à un dispositif fondé sur une norme inconstitutionnelle. Cette transposition silencieuse constitue une fraude législative déguisée, par laquelle le Parlement a endossé les conséquences d’un décret qui n’aurait jamais dû produire d’effets.
Mais l’opération va plus loin : l’article 25 de cette même loi organise une véritable stratégie de brouillage normatif. Au lieu d’abroger explicitement les dispositions fondatrices du Code de commerce relatives aux juridictions commerciales, il supprime uniquement les intitulés des titres Ier, III et IV du Livre IV, tout en abrogeant partiellement quelques articles (notamment les articles 624, 627 à 629, et 644). Cette suppression d’intitulés sans suppression explicite des articles constitue une méthode d’effacement discrète et trompeuse, destinée à masquer la disparition des fondements législatifs de toute une branche du droit judiciaire.
Les conséquences de cette manœuvre sont dramatiques pour l’ensemble des professions judiciaires rattachées aux juridictions commerciales, notamment les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires à la liquidation des entreprises, ainsi que les commissaires de justice dans le cadre des procédures collectives. Ces fonctions, historiquement rattachées aux juridictions commerciales et fondées sur des textes expressément inscrits dans le Code de commerce, ont été brutalement privées de base législative claire.
En ne réinscrivant pas dans la loi les règles relatives à leur statut, leurs conditions de nomination, leurs attributions et leurs émoluments, la loi du 16 juillet 1987 a plongé ces professions dans une zone grise. Elle a laissé subsister leur exercice en apparence, tout en supprimant les fondements juridiques qui leur donnaient légitimité. Dès lors, ces professions ont continué d’exister dans un cadre fictif, soutenues uniquement par des articles issus d’un décret inconstitutionnel ou par des textes ultérieurs eux-mêmes fondés sur cette illégalité initiale.
Cette loi n’a donc pas rétabli l’ordre légal : elle l’a aggravé. Elle a offert une couverture législative à un appareil judiciaire parallèle, constitué hors du contrôle parlementaire, dont les juridictions comme les fonctions qui leur sont rattachées n’ont plus aucun ancrage dans le droit républicain. Elle a perpétué la fiction juridique d’un ordre judiciaire commercial autonome, qui fonctionne sans légitimité, en dehors des règles constitutionnelles de la République.
Ainsi, à compter du 16 juillet 1987, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et les mandataires à la liquidation judiciaire ont été maintenus en fonction sur une base légalement inexistante. Leur statut, leurs pouvoirs et leurs actes sont entachés d’irrégularité. La loi n’a pas restauré les fondements abrogés : elle les a effacés, puis recouverts d’un vernis de légalité fictive. Ce faisant, elle a définitivement ancré ces professions dans l’illégalité structurelle de la justice commerciale française.
La loi du 17 décembre 1991 : l’aveu d’un effondrement juridique et l’enterrement des professions rattachées
La loi n°91-1258 du 17 décembre 1991 constitue l’un des épisodes les plus révélateurs de la faillite juridique et institutionnelle du dispositif commercial français. Sous couvert de « codification à droit constant », elle entérine une série de fraudes à la hiérarchie des normes, en prétendant donner force de loi à des dispositions issues d’un décret inconstitutionnel, tout en les abrogeant dans le même texte. Ce mécanisme de « blanchiment législatif par contradiction » consacre non seulement la disparition du fondement légal des tribunaux de commerce, mais emporte également l’effacement des professions qui y sont rattachées : greffiers, administrateurs judiciaires, mandataires, commissaires à l’exécution du concordat.
L’article 3 de cette loi affirme que « les dispositions contenues dans la partie législative du Code de l’organisation judiciaire ont force de loi ». Or, ces dispositions ne proviennent ni d’un texte voté par le Parlement, ni d’une ordonnance prise sur habilitation. Elles sont directement issues du décret n°78-329 du 16 mars 1978, un décret simple et purement réglementaire, pris sans habilitation législative conforme à l’article 38 de la Constitution. Il est donc juridiquement impossible d’attribuer une valeur législative rétroactive à des normes qui, par nature, sont dépourvues de cette force. Légalement, un décret ne peut pas engendrer de dispositions ayant « force de loi » sans ratification explicite. Le Parlement, au lieu de légiférer directement, a donc validé par un tour de passe-passe un texte qu’il n’a jamais adopté, au mépris de la séparation des pouvoirs.
Plus grave encore, le même article 3 abroge expressément les articles 1er et 2 du décret de 1978, c’est-à-dire les seuls textes qui, bien que juridiquement viciés, mentionnaient les juridictions commerciales dans le Code de l’organisation judiciaire. Ainsi, la loi prétend simultanément donner force législative à des dispositions qui n’existent pas juridiquement, tout en supprimant leur seule base textuelle, issue du décret n°78-329 du 16 mars 1978. Cette opération repose sur une fiction normative absolue : les articles concernés n’avaient aucune valeur législative à l’origine, puisqu’ils émanaient d’un décret réglementaire pris sans habilitation parlementaire, en violation des articles 34 et 38 de la Constitution. En tentant de leur conférer a posteriori une force législative par simple déclaration, la loi du 17 décembre 1991 s’érige en blanchiment législatif d’une norme inexistante.
Pire encore, ces dispositions étaient déjà juridiquement mortes, puisque la loi n°87-550 du 16 juillet 1987 avait abrogé les fondements du Code de commerce concernant les tribunaux de commerce et leurs professions affiliées, sans jamais les recréer dans un texte législatif valide. La loi de 1991 enfonce donc le clou, en supprimant le support réglementaire du COJ, tout en prétendant fonder l’ordre judiciaire commercial sur ce même support inexistant. Il s’agit d’un double aveu de forfaiture constitutionnelle : d’une part en validant un décret illégal, d’autre part en supprimant la base même de cette prétendue validation.
Cette opération de dissimulation trouve son origine dans la loi du 16 juillet 1987, qui avait déjà procédé à l’effacement silencieux des fondements des juridictions commerciales en supprimant plusieurs articles clés du Code de commerce (notamment les articles 624, 627 à 629 et 644), ainsi que les intitulés des titres Ier, III et IV du Livre IV. Mais la loi de 1991 ne rétablit aucun de ces textes fondateurs, ni dans le Code de commerce, ni dans le COJ. Elle entérine au contraire leur disparition, en prétendant fonder les juridictions commerciales sur des dispositions réglementaires illégales… désormais abrogées.
Cette disparition touche de plein fouet les professions judiciaires rattachées aux juridictions commerciales, dont le fondement législatif avait déjà été détruit par le décret de 1978. Ce dernier avait notamment abrogé les articles 631 à 640 du Code de commerce, qui définissaient les conditions de nomination, d’assermentation, de rémunération et d’exercice des greffiers des tribunaux de commerce. Ces articles n’ont jamais été réintroduits par une loi. Leurs substituts (articles L.821-1 à L.821-3 COJ) sont apparus dans une annexe à un décret sans valeur législative, puis ont été « validés » par la loi de 1991… alors même que le décret fondateur était abrogé dans le même texte.
Les administrateurs et mandataires judiciaires, qui dépendaient historiquement des juridictions commerciales pour leur désignation et leur encadrement, se retrouvent donc, eux aussi, orphelins de toute base juridique cohérente. La loi du 25 janvier 1985, censée structurer ces professions, ne rétablit aucun fondement juridictionnel autonome, ne mentionne pas explicitement les tribunaux de commerce comme instances compétentes, et repose sur des institutions (cour d’appel, COJ) elles-mêmes héritées du décret de 1978. Autrement dit, le cadre juridique de ces professions repose sur une construction juridique fictive, superposée à une base abrogée.
En conclusion, la loi du 17 décembre 1991 n’a pas consolidé le système judiciaire commercial : elle l’a effondré définitivement. Elle a validé l’invalide, confirmé l’incompétent, et supprimé les dernières traces des fondements législatifs. À partir de cette date, les tribunaux de commerce, comme les professions qui en dépendent, sont maintenus dans une fiction juridique sans contenu normatif opposable. Il ne s’agit plus d’un dysfonctionnement ponctuel, mais bien d’un système parallèle, opéré par des structures judiciaires illégales, administrées par des professionnels sans titre légitime, et protégé par des lois de dissimulation.
L’ordonnance de 2000 : la résurrection fictive des professions judiciaires commerciales sur fond de vide juridique
Face au vide juridique causé par les abrogations successives opérées en 1987 et 1991, le pouvoir exécutif tente, à partir de l’an 2000, une nouvelle opération de légitimation des juridictions consulaires et de leurs auxiliaires. Cette manœuvre repose sur l’ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000, prise sur le fondement de la loi d’habilitation n°99-1071 du 16 décembre 1999, laquelle autorisait le gouvernement à procéder, par ordonnance, à une codification à droit constant des textes régissant notamment le Code de commerce.
Mais cette codification, censée ne reprendre que les dispositions « en vigueur » à la date de publication, s’est heurtée à une impossibilité juridique fondamentale : au 18 septembre 2000, aucune disposition valable ne régissait les professions rattachées aux tribunaux de commerce. L’article 1er de la loi d’habilitation était pourtant clair : seules les dispositions alors en vigueur pouvaient être codifiées. Or, les textes relatifs aux greffiers des tribunaux de commerce, aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires, ou encore aux commissaires à l’exécution du concordat avaient été abrogés par la loi du 16 juillet 1987 (dans le Code de commerce), puis effacés par la loi du 17 décembre 1991 (dans le Code de l’organisation judiciaire). Le décret n°78-329 du 16 mars 1978, qui avait tenté de maintenir ces professions dans le COJ sans habilitation législative, avait lui-même été abrogé. Il ne subsistait donc aucune base législative valide pouvant faire l’objet d’une codification à droit constant.
Une ratification frauduleuse et tardive : le blanchiment des professions sans base légale
Le projet de loi de ratification de l’ordonnance de 2000, déposé à l’Assemblée nationale le 15 novembre 2000, n’a jamais été adopté. Il est devenu caduc à la fin de la législature en 2002, conformément à la règle parlementaire rappelée par le Sénat. Dès lors, l’ordonnance a perdu toute validité juridique. Pourtant, au lieu d’admettre la caducité, le gouvernement a glissé une ratification implicite dans l’article 50 de la loi n°2003-7 du 3 janvier 2003. Mais cette prétendue validation rétroactive intervient hors délai, et viole les conditions strictes posées par l’article 38 de la Constitution : une ratification doit être pure, explicite, et intervenir dans le délai imparti.
De surcroît, cette tentative tardive modifie le Code de commerce, ce qui est interdit dans le cadre d’une ratification. Pire encore, l’article 50 ne mentionne jamais l’annexe de l’ordonnance — celle qui contient précisément l’ensemble des dispositions relatives aux professions judiciaires commerciales. Même en admettant l’existence d’une ratification, celle-ci serait incomplète et donc inopérante.
Les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, mais aussi les commissaires à l’exécution du concordat, censés être régis par ce nouveau code, se retrouvent dès lors dans un flou juridique absolu. Leurs règles statutaires, leurs prérogatives, leurs obligations et leurs conditions de nomination reposent sur des dispositions sans valeur normative authentique, non ratifiées, jamais validées par le Parlement, et jamais réintroduites par un texte législatif autonome.
Une architecture fictive : modifications ultérieures sur des textes inexistants
Le subterfuge ne s’arrête pas à l’ordonnance de 2000. Dès l’année suivante, la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 vient modifier des articles du Code de l’organisation judiciaire (notamment L.411-1 et suivants), censés redonner une base aux tribunaux de commerce. Mais ces articles avaient été abrogés en 1991 et n’avaient jamais été réintroduits valablement. Pis encore, les articles L.411-1 et suivants avaient été introduits dans la partie législative du COJ par le décret n°78-329 du 16 mars 1978, pris sans habilitation législative. Ce décret avait pour objet de substituer de nouvelles dispositions aux textes législatifs antérieurs (notamment le Code de commerce, la loi des 16-24 août 1790, etc.), en s’appuyant sur l’article 34 de la Constitution et l’article 15 de la loi n°72-626 du 5 juillet 1972. Il s’agissait déjà, à l’époque, d’un exercice inconstitutionnel, puisque seule une loi peut modifier ou abroger une autre loi.
Ainsi, la loi de 2001 modifie non seulement des textes inexistants du point de vue de la légalité, mais elle s’inscrit en continuité d’un montage initialement frauduleux. Elle agit sur un code (le COJ) qui n’a jamais été valablement constitué, et tente de réintroduire des juridictions disparues sur la base d’articles déjà illégaux dès leur insertion initiale.
Une supercherie institutionnelle : l’exercice illégal sous apparence légale
L’ordonnance de 2000, loin de rétablir une quelconque légalité, organise une façade juridique destinée à donner une apparence de normalité à l’exercice d’activités juridictionnelles commerciales. Les greffiers, administrateurs et mandataires judiciaires agissent depuis lors comme si leur statut avait été consolidé, alors qu’il repose sur une imposture législative. Cette situation constitue une atteinte grave au principe de légalité, à la sécurité juridique, à l’égalité devant la justice et au droit au juge impartial.
L’article 4 de l’ordonnance n°2000-912 procède à l’abrogation expresse d’un grand nombre de textes fondamentaux, parmi lesquels la loi du 30 août 1893 sur les greffes et la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Or, cette dernière fournissait la structure juridique de référence pour les formes sociales utilisées par de nombreuses professions libérales réglementées, notamment au travers des SEL (SELARL, SELAFA, SELAS, etc.). Même si les lois régissant directement les SEL (loi n°90-1258 du 31 décembre 1990) et les SCP (loi n°66-879 du 29 novembre 1966) n’y faisaient pas explicitement référence, elles dépendaient en pratique des formes sociétaires issues de la loi de 1966 pour exister.
Plus grave encore, l’ordonnance a abrogé deux lois majeures : la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, et la loi n°85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d’entreprise. Ces deux textes constituaient le socle législatif essentiel encadrant les procédures collectives et définissant le statut, les fonctions, les conditions de nomination et les responsabilités des mandataires de justice.
En supprimant ces lois sans leur substituer un texte de même niveau normatif, l’ordonnance n°2000-912 a vidé de toute substance légale les règles applicables aux procédures de redressement et de liquidation judiciaire. Les administrateurs judiciaires — pourtant chargés d’une mission juridictionnelle fondamentale consistant à administrer les biens d’autrui par décision de justice — se retrouvent ainsi privés de toute base légale d’existence et d’action.
Conclusion : des professions judiciaires sans fondement, des actes sans autorité
La prétendue codification opérée par l’ordonnance de 2000 ne saurait masquer l’effondrement du cadre juridique applicable aux professions rattachées aux juridictions commerciales. Greffiers, administrateurs, mandataires ou commissaires judiciaires interviennent quotidiennement dans des procédures lourdes de conséquences, sans disposer d’un statut légalement fondé, ni d’un cadre d’exercice opposable. L’ensemble de leurs actes — procès-verbaux, désignations, rapports, scellés, notifications ou signatures — sont entachés d’une nullité absolue.
La responsabilité de cette situation pèse sur les institutions de la République, qui ont sciemment laissé se perpétuer un régime fondé sur la dissimulation, la manipulation normative et l’usurpation d’autorité. Il ne s’agit plus ici d’un vide juridique accidentel, mais d’une organisation systémique de la fraude d’État.
La tentative de régularisation par ordonnance : une fraude aggravée entre 2006 et 2009
Cette manœuvre se poursuit avec l’ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006, prise en vertu de l’article 92 de la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004. Cette ordonnance vise à refondre le Code de l’organisation judiciaire, en abrogeant à nouveau les articles L.411-2 à L.411-7, censés régir les tribunaux de commerce, et en transposant les juridictions consulaires dans le Code de commerce sous les articles L.721-1 à L.724-7. Par cette opération, le gouvernement entend également relocaliser les références aux auxiliaires de justice concernés, notamment les greffiers des tribunaux de commerce, dans une section du code pourtant vidée de sa substance légale depuis 1991.
L’article 2 de l’ordonnance procède ainsi à la réécriture intégrale du titre II du livre VII du Code de commerce, et l’article 4 introduit un mécanisme transitoire conditionné à la parution d’un décret fixant la partie réglementaire. Ce système de transition suspendue a pour effet de masquer une réalité juridique accablante : les dispositions ainsi réécrites concernent des professions dont le fondement a été abrogé à plusieurs reprises (en 1987, 1991, et indirectement en 2000) et dont la validité initiale reposait sur un décret inconstitutionnel — le décret n°78-329 du 16 mars 1978.
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance, déposé au Sénat le 30 août 2006, n’a jamais été adopté. Conformément aux règles parlementaires, la fin de la législature intervenue en juin 2007 a rendu ce projet de loi caduc. L’ordonnance, non ratifiée dans les délais, est donc privée de toute valeur législative. Pourtant, loin de corriger cette situation, le gouvernement a persisté dans sa stratégie de régularisation frauduleuse : l’article 138 de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 opère une ratification globale de 38 ordonnances, parmi lesquelles figure l’ordonnance du 8 juin 2006.
Cet article 138 constitue une opération de blanchiment législatif inédite : il tente de ratifier en bloc, sans débat individuel, une série d’ordonnances hors délais, parfois en modifiant leur contenu au sein même du texte de ratification. Ce procédé contrevient directement à l’article 38 de la Constitution, qui impose une ratification expresse, explicite, et dans les délais fixés par la loi d’habilitation. En l’espèce, la loi du 9 décembre 2004 imposait un délai de trois mois pour le dépôt du projet de loi de ratification. Ce délai a été largement dépassé, rendant toute validation ultérieure juridiquement nulle.
Plus grave encore, cette pseudo-ratification transforme certaines ordonnances en lois par simple modification rédactionnelle, sans rétablir leur base légale initiale ni reconstituer les fondements constitutionnels des professions concernées. Les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, et les commissaires à l’exécution du concordat sont donc à nouveau « validés » par ricochet, au moyen d’un texte qui n’a ni autorité constitutionnelle, ni effet régularisateur.
Les articles L.741-1 à L.744-3 (greffiers) et L.821-1 à L.827-18 (administrateurs et mandataires) du Code de commerce, qui avaient été introduits de manière irrégulière en 2000, sont maintenus tels quels dans les versions postérieures du Code. Aucun débat parlementaire n’est venu interroger leur fondement, et aucune loi spécifique n’est venue les recréer valablement. La loi du 12 mai 2009 prétend donc ratifier ce qui n’était ni légalement codifié, ni constitutionnellement possible.
De 2000 à 2009, tous les mécanismes mis en œuvre pour ressusciter les professions judiciaires commerciales ont échoué à produire une base juridique valable. Le recours à des ordonnances prises hors délai, la codification de normes abrogées, la manipulation des échéances parlementaires, et la ratification globale postérieure constituent une fraude constitutionnelle aggravée. Cette séquence, loin de rétablir la légalité, démontre l’incapacité des institutions à restaurer une légitimité perdue sans exposer le caractère fictif et illégal de l’ensemble du dispositif.
L’illégalité radicale de l’exercice en société des professions judiciaires commerciales : une fraude institutionnelle généralisée
La constitution des professions judiciaires commerciales en sociétés commerciales, notamment sous forme de SELARL, SELAS ou SCP, aggrave considérablement l’irrégularité initiale. Ces formes sociétaires, issues du droit commercial et destinées à l’exercice d’activités lucratives privées, sont manifestement incompatibles avec les missions d’autorité publique confiées aux greffiers, administrateurs, mandataires ou commissaires de justice. En l’absence de cadre légal légitime, et au regard de leur participation directe à des procédures judiciaires impliquant la force exécutoire de l’État, leur organisation en société constitue une dénaturation grave de leurs fonctions régaliennes. Le conflit d’intérêts est structurel, permanent, et invalide radicalement l’ensemble des actes qu’ils accomplissent sous cette forme.
Cette illégalité structurelle s’est aggravée avec l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023, présentée comme une réforme destinée à clarifier le régime des professions libérales réglementées. En réécrivant le Titre Ier du Livre VIII du Code de commerce, cette ordonnance prétend régulariser l’exercice en société des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d’entreprise. Mais elle s’appuie sur un Code de commerce juridiquement inexistant, lui-même codifié par une ordonnance non ratifiée (n°2000-912), et n’a jamais été ratifiée avant la dissolution de l’Assemblée nationale. Loin d’apporter une sécurité juridique, cette réforme repose sur un fondement nul et accentue le chaos normatif.
La situation des greffiers des tribunaux de commerce illustre de manière emblématique la fraude institutionnelle dénoncée. Présentés comme officiers publics et ministériels, ils exercent pourtant aujourd’hui sous forme de sociétés commerciales (SELARL, SELAS ou SCP), alors même que le décret n°93-86 du 21 janvier 1993 qui le permettait a été abrogé en 2007, sans jamais avoir été remplacé. Aucun texte en vigueur n’autorise depuis lors leur organisation en société, et leur statut repose exclusivement sur des articles insérés dans un Code de commerce lui-même privé de base légale. Pire encore, ces greffiers procèdent à l’enregistrement de sociétés constituées par d’autres professions judiciaires — notaires, commissaires de justice, mandataires, administrateurs — sur la base de lois elles-mêmes abrogées. Ils agissent ainsi comme juges et parties, validant des actes entachés de nullité tout en perpétuant leur propre illégalité. Ce conflit d’intérêts structurel constitue une atteinte directe au principe d’impartialité et engage leur responsabilité pleine et entière.
Ce constat serait déjà suffisant pour établir l’invalidité radicale de leur statut. Mais il faut ajouter que ces mêmes greffiers, pourtant juridiquement disqualifiés, sont chargés d’enregistrer et de valider les sociétés constituées par d’autres officiers publics — commissaires de justice, notaires, administrateurs et mandataires judiciaires. Ils agissent alors comme juges et parties, enregistrant des statuts fondés sur des lois abrogées, sans exercer la moindre vérification de validité. La loi n°90-1258 du 31 décembre 1990, qui autorisait la constitution de SELARL pour les professions libérales, et la loi n°66-879 du 29 novembre 1966, applicable aux SCP, ont été expressément abrogées par l’ordonnance n°2023-77. Ces textes ne peuvent donc plus justifier aucun enregistrement.
Dans ce contexte, la responsabilité des greffiers est directement engagée. Ils connaissent le caractère obsolète ou caduc des textes sur lesquels reposent les statuts qu’ils valident, et pourtant, ils poursuivent leur activité comme si de rien n’était. Leur propre situation irrégulière les incite à valider celle des autres, dans une logique de préservation mutuelle. Ce conflit d’intérêts manifeste crée une rupture d’impartialité inacceptable, d’autant plus que le ministère de la Justice, chargé de la tutelle de ces professions, se refuse à intervenir. Cette passivité équivaut à une complicité institutionnelle.
Les conséquences de cette situation sont d’une gravité extrême. Tous les actes d’exécution forcée réalisés par des commissaires de justice exerçant en société sur la base de lois abrogées sont entachés de nullité. Les saisies, expulsions, ventes aux enchères et significations opérées sous couvert de ces structures n’ont aucun fondement juridique. Il en va de même pour les désignations d’administrateurs judiciaires dans les procédures collectives, ou les décisions relatives à la gestion ou la liquidation des entreprises. À chaque fois qu’un greffier valide les statuts d’une société d’officier public sur la base de textes caducs, il commet une faute lourde engageant sa responsabilité et celle des autorités de contrôle.
L’ensemble du dispositif normatif encadrant les professions judiciaires affiliées aux juridictions commerciales repose désormais sur une fiction légale. Entre les ordonnances non ratifiées, les lois abrogées, les décrets caducs et les validations de sociétés irrégulières, c’est tout un édifice juridique qui s’est effondré. Cette situation n’est plus une anomalie isolée, mais un système institutionnalisé de fraude et d’illégalité, entretenu sciemment depuis plus de vingt ans. La responsabilité de cet effondrement incombe directement à l’État, à ses organes exécutifs et judiciaires, ainsi qu’aux professionnels qui ont accepté d’exercer sous ce régime, au mépris du droit.
Un système global de dissimulation et de validation illégale : de la constitution aux fonctions exercées
Ce qui pourrait apparaître comme une accumulation d’irrégularités ponctuelles forme en réalité un système structuré et coordonné de dissimulation juridique, visant à maintenir l’illusion de la légalité autour de professions judiciaires commerciales dont les fondements sont inexistants. À chaque niveau du processus — constitution des sociétés, enregistrement au greffe, agrément professionnel, formation initiale, nomination dans les procédures, contrôle disciplinaire — des mécanismes ont été mis en place pour valider des structures pourtant dépourvues de toute base légale.
Les constitutions de sociétés d’officiers publics (greffiers, administrateurs, mandataires, commissaires de justice) s’opèrent systématiquement sur la base de textes abrogés, tels que les lois n°90-1258 du 31 décembre 1990 et n°66-879 du 29 novembre 1966. Le greffe du tribunal de commerce, tenu par les greffiers eux-mêmes, procède à ces enregistrements en toute connaissance de cause, sans vérification de validité juridique, perpétuant un conflit d’intérêts manifeste. Ce cercle vicieux est renforcé par l’inexistence juridique du Code de commerce tel que codifié par l’ordonnance n°2000-912, sur lequel s’appuie toute la chaîne réglementaire actuelle.
La formation initiale et continue de ces professions, souvent dispensée sous l’égide d’organismes contrôlés par les ordres ou par le ministère de la Justice, repose sur des programmes et des référentiels eux-mêmes fondés sur des textes dépourvus de force légale. Les agréments, autorisations d’exercice ou inscriptions sur les listes d’aptitude sont délivrés sans contrôle effectif de la légalité des structures d’exercice. Quant aux nominations dans les procédures judiciaires, elles se font sur la base d’un statut inexistant, dans un circuit fermé entre juridictions commerciales illégales et professionnels eux-mêmes irrégulièrement constitués.
Enfin, les organes de contrôle, qu’ils relèvent du ministère de la Justice ou des instances ordinales, ferment délibérément les yeux sur ces irrégularités structurelles. Les inspections, lorsqu’elles ont lieu, portent sur des aspects secondaires de gestion ou de déontologie, mais jamais sur la validité des fondements juridiques de l’exercice professionnel en société. Ce silence institutionnel s’apparente à une validation tacite du système frauduleux, et engage la responsabilité directe des autorités de tutelle.
Ce dispositif global n’est donc pas une simple anomalie administrative. Il constitue un réseau de validation illégale, dans lequel les professionnels, les greffiers, les juridictions et l’État collaborent — par action ou par omission — pour perpétuer un modèle juridique fictif. Il s’agit d’un détournement systémique du droit, organisé autour d’un socle inexistant et d’une fiction normative, au détriment de la souveraineté populaire, de l’accès à une justice légale et du respect des droits fondamentaux.
Face à cet effondrement normatif généralisé, les autorités ont tenté, par l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023, de camoufler le vide juridique qu’elles avaient elles-mêmes provoqué. Plutôt que de reconnaître l’inexistence légale du régime applicable aux professions judiciaires commerciales, le pouvoir exécutif a choisi de forger une apparente régularisation, appuyée sur un Code de commerce lui-même frappé de nullité. Loin de corriger les illégalités structurelles dénoncées depuis des décennies, cette ordonnance n’a fait que prolonger l’imposture, en prétendant codifier à nouveau ce qui avait été abrogé, supprimé ou jamais valablement instauré. Cette manœuvre appelle donc un examen critique approfondi.
L’ordonnance n°2023‑77 du 8 février 2023 : une tentative avortée de régularisation sur fond d’inexistence juridique
La constitution des professions judiciaires commerciales en sociétés commerciales, notamment sous forme de SELARL, SELAS ou SCP, aggrave considérablement l’irrégularité initiale. Ces formes sociétaires, issues du droit commercial et destinées à l’exercice d’activités lucratives privées, sont manifestement incompatibles avec les missions d’autorité publique confiées aux greffiers, administrateurs, mandataires ou commissaires de justice. En l’absence de cadre légal légitime, et au regard de leur participation directe à des procédures judiciaires impliquant la force exécutoire de l’État, leur organisation en société constitue une dénaturation grave de leurs fonctions régaliennes. Le conflit d’intérêts est structurel, permanent, et invalide radicalement l’ensemble des actes qu’ils accomplissent sous cette forme.
Cette illégalité structurelle s’est aggravée avec l’ordonnance n°2023‑77 du 8 février 2023, présentée comme une réforme destinée à clarifier le régime des professions libérales réglementées. En réécrivant le Titre Ier du Livre VIII du Code de commerce, cette ordonnance prétendait régulariser l’exercice en société des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d’entreprise. Mais elle repose sur un Code de commerce juridiquement inexistant, lui-même issu d’une ordonnance non ratifiée (n°2000‑912), et n’a jamais été ratifiée avant la dissolution de l’Assemblée nationale. Le projet de loi de ratification, enregistré sous le n°847 le 5 juillet 2023, n’a jamais été inscrit à l’ordre du jour, ni discuté, et est devenu caduc avec la fin de la législature. En vertu du principe constitutionnel posé par l’article 38 de la Constitution, une ordonnance non ratifiée dans les délais est privée de toute valeur législative. Par voie de conséquence, l’ordonnance n°2023‑77 est juridiquement inexistante. Loin d’apporter une quelconque sécurité juridique, cette pseudo-réforme prolonge la confusion normative et participe à l’aggravation du régime illégal dans lequel exercent aujourd’hui les professions judiciaires et libérales réglementées.
La situation est encore plus préoccupante s’agissant des greffiers des tribunaux de commerce. Officiellement présentés comme officiers publics et ministériels, leur mission est d’authentifier les actes, d’assurer la tenue des registres et de garantir la sécurité juridique des formalités. Or, non seulement le décret n°93‑86 du 21 janvier 1993, qui leur permettait d’exercer en société, a été abrogé dès le 27 mars 2007, mais leur exercice en société était déjà contraire au droit dès l’origine. En effet, le décret n°78‑329 du 16 mars 1978, qui tentait de réorganiser le statut des professions judiciaires commerciales dans le Code de l’organisation judiciaire, a été pris sans habilitation législative et contrevient aux principes constitutionnels de hiérarchie des normes. La profession de greffier commercial n’avait donc déjà plus de fondement valide à cette époque.
Depuis 2007, plus aucun texte n’autorise les greffiers à exercer sous forme de SELARL, SELAS ou SCP. Pourtant, ils ont poursuivi leurs activités en société, dans un déni total du droit applicable. Pire encore, en tant qu’officiers publics, ils ont validé leur propre organisation sur la base d’un texte inexistant, tout en continuant à exercer une fonction d’autorité publique.
Ce constat serait déjà suffisant pour établir l’invalidité radicale de leur statut. Mais il faut ajouter que ces mêmes greffiers, pourtant juridiquement disqualifiés, sont chargés d’enregistrer et de valider les sociétés constituées par d’autres officiers publics — commissaires de justice, notaires, administrateurs et mandataires judiciaires. Ils agissent alors comme juges et parties, enregistrant des statuts fondés sur des lois abrogées, sans exercer la moindre vérification de validité. La loi n°90‑1258 du 31 décembre 1990, qui autorisait la constitution de SELARL pour les professions libérales, et la loi n°66‑879 du 29 novembre 1966, applicable aux SCP, ont toutes deux été abrogées expressément par l’ordonnance n°2023‑77. Quant à la loi n°66‑537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales — fondement général du régime des sociétés commerciales — elle avait déjà été abrogée par l’ordonnance n°2000‑912 du 18 septembre 2000, prise sans ratification parlementaire. Ces textes, désormais caducs, ne peuvent plus justifier aucun enregistrement de sociétés professionnelles.
Dans ce contexte, la responsabilité des greffiers est directement engagée. Ils connaissent le caractère obsolète ou caduc des textes sur lesquels reposent les statuts qu’ils valident, et pourtant, ils poursuivent leur activité comme si de rien n’était. Leur propre situation irrégulière les incite à valider celle des autres, dans une logique de préservation mutuelle. Ce conflit d’intérêts manifeste crée une rupture d’impartialité inacceptable, d’autant plus que le ministère de la Justice, chargé de la tutelle de ces professions, se refuse à intervenir. Cette passivité équivaut à une complicité institutionnelle.
Les conséquences de cette situation sont d’une gravité extrême. Tous les actes d’exécution forcée réalisés par des commissaires de justice exerçant en société sur la base de lois abrogées sont entachés de nullité. Les saisies, expulsions, ventes aux enchères et significations opérées sous couvert de ces structures n’ont aucun fondement juridique. Il en va de même pour les désignations d’administrateurs judiciaires dans les procédures collectives, ou les décisions relatives à la gestion ou la liquidation des entreprises. À chaque fois qu’un greffier valide les statuts d’une société d’officier public sur la base de textes caducs, il commet une faute lourde engageant sa responsabilité et celle des autorités de contrôle.
L’ensemble du dispositif normatif encadrant les professions judiciaires affiliées aux juridictions commerciales repose désormais sur une fiction légale. Entre les ordonnances non ratifiées, les lois abrogées, les décrets caducs et les validations de sociétés irrégulières, c’est tout un édifice juridique qui s’est effondré. Cette situation n’est plus une anomalie isolée, mais un système institutionnalisé de fraude et d’illégalité, entretenu sciemment depuis plus de quarante ans. La responsabilité de cet effondrement incombe directement à l’État, à ses organes exécutifs et judiciaires, ainsi qu’aux professionnels qui ont accepté d’exercer sous ce régime, au mépris du droit.
L’effondrement juridique du cadre professionnel : conséquences directes et systémiques
L’illégalité des fondements normatifs exposée précédemment n’est pas un simple débat théorique. Elle affecte directement l’ensemble des professions judiciaires et libérales réglementées aujourd’hui en activité en France. Greffiers des tribunaux de commerce, administrateurs et mandataires judiciaires, notaires, avocats, commissaires de justice, experts-comptables ou commissaires aux comptes exercent au sein de structures dépourvues de toute base légale valide.
Depuis l’abrogation de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et l’absence de ratification des ordonnances codifiant le droit professionnel (2000, 2006, 2023), les formes sociétaires dans lesquelles ces professions sont organisées — SELARL, SELAS, SCP, etc. — ne disposent d’aucun fondement normatif conforme à la Constitution. La loi n°90-1258 du 31 décembre 1990, elle-même privée de socle sociétaire autonome depuis l’abrogation de ses références légales, est devenue inopérante en droit strict.
Les actes émis par ces structures — qu’il s’agisse de constats, de ventes judiciaires, de procès-verbaux, d’expertises ou de missions de conseil — sont juridiquement fragilisés, voire frappés de nullité absolue, en raison de l’inexistence légale de leurs auteurs. Aucune régularisation rétroactive n’est possible sans recréation législative en bonne et due forme. Ce constat remet en cause l’effectivité même des fonctions régaliennes déléguées à ces professions.
Cette vacuité juridique n’est pas un échec accidentel du législateur, mais le résultat d’une organisation institutionnelle, dans laquelle les organes de régulation, les juridictions, les ministères et les structures ordinales ont sciemment laissé perdurer un exercice sans fondement. C’est sur cette base que s’est constituée une normalisation frauduleuse de professions juridiquement inexistantes.
C’est dans ce contexte que doivent être analysées les structures ordinales, syndicales et institutionnelles ayant permis la consolidation de ce système illégal. Elles n’ont pas seulement accompagné la fraude : elles en sont les chevilles ouvrières.
Les structures ordinales et syndicales : complices de la fraude par organisation illégale de professions inexistantes
Au-delà des personnes physiques, ce sont des structures collectives organisées, paraétatiques ou professionnelles, qui ont permis la perpétuation de l’illégalité des professions judiciaires commerciales.
Plusieurs instances ordinales, syndicats professionnels et groupements d’intérêt privé se sont constitués, structurés et consolidés autour de professions juridiquement inexistantes, contribuant à légitimer un système fondé sur des lois abrogées et des ordonnances non ratifiées.
Parmi elles :
- Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ), créé par décret n°2004-1467 du 23 décembre 2004, repose entièrement sur des textes abrogés ou non ratifiés (ordonnance de 2000, ordonnance de 2006, ratification globale de 2009). Il organise une profession sans base législative, statue sur les inscriptions, les suspensions, les formations, alors qu’aucune loi valide ne lui en reconnaît le pouvoir.
- La Conférence générale des greffiers des tribunaux de commerce, qui regroupe les greffiers exerçant pourtant sous des formes sociétaires interdites (SELARL, SCP) depuis l’abrogation du décret n°93-86 en 2007. Elle représente publiquement une fonction ministérielle qui n’a, depuis 1978, aucun fondement textuel légitime.
- Des syndicats professionnels de mandataires ou d’administrateurs (ex. : ANMJ, AJMJ, etc.) organisent des formations, publient des référentiels, participent à des groupes de travail ministériels, comme si ces professions existaient légalement. Ils perçoivent parfois des fonds publics ou des subventions, en violation manifeste du principe d’égalité devant les charges publiques.
- Certains centres de formation agréés, parfois rattachés à ces organisations, dispensent des cursus entièrement construits sur des textes dépourvus de force légale, validant ainsi des compétences juridiques sans valeur légale ni opposabilité. La CNCC (commissaires aux comptes), l’OEC (experts-comptables) ou des écoles notariales sont elles-mêmes piégées dans ce système de normalisation frauduleuse.
Ces entités, souvent financées en partie par des cotisations obligatoires, sont en réalité des relais de pouvoir illégitime, assurant la continuité d’un ordre professionnel fictif. Elles participent à l’organisation de concours, à la publication d’annuaires, à l’édition de formulaires officiels, à la tenue de listes de professionnels « habilités »… sans qu’aucun texte en vigueur ne leur en confère la compétence légale.
En outre, ces organisations s’auto légitiment mutuellement : les greffiers enregistrent les sociétés de mandataires judiciaires, qui eux-mêmes désignent des avocats en société, validés par leurs ordres respectifs, dans une chaîne circulaire de validation mutuelle sur des bases juridiquement nulles.
Le ministère de la Justice, qui exerce une tutelle administrative sur ces structures, cautionne de fait leur existence et leurs missions, malgré la connaissance évidente de l’illégalité des fondements législatifs. Ce mécanisme équivaut à une collusion institutionnelle, dans laquelle l’État délègue des pouvoirs régaliens à des entités privées dépourvues de tout fondement légal, en violation du principe de souveraineté populaire et de l’article 1er de la Constitution.
Les autres professions libérales réglementées : un régime d’exercice en société juridiquement inexistant
Au-delà des officiers publics et ministériels, les professions libérales réglementées telles que les avocats, les experts-comptables, les commissaires aux comptes ou encore les géomètres-experts sont elles aussi plongées dans une insécurité juridique manifeste. Si elles ne relèvent pas du statut d’officier ministériel, leur exercice professionnel est néanmoins strictement encadré par la loi, notamment en ce qui concerne leur possibilité d’organisation en sociétés.
Or, les textes ayant historiquement permis à ces professions d’exercer sous forme de sociétés – SCP, SELARL, SELAS – ont fait l’objet de modifications, d’abrogations et de réécritures successives sans jamais reposer sur une base législative solide. L’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023, censée uniformiser le régime des professions réglementées exerçant en société, n’a jamais été ratifiée. En tant qu’ordonnance non ratifiée, elle est juridiquement caduque. Elle ne peut produire aucun effet de droit et ne saurait modifier un Code de commerce lui-même entaché de nullité depuis sa prétendue codification par l’ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000, elle aussi non ratifiée.
Dès lors, les règles encadrant l’exercice en société des professions libérales réglementées sont juridiquement inexistantes. Les structures actuelles dans lesquelles exercent ces professionnels – cabinets en SEL, SCP ou autres formes sociétaires – ne reposent sur aucun fondement valide. Par conséquent, les actes qu’ils produisent, qu’il s’agisse de contrats, d’audits, d’expertises, de certifications ou de conseils, sont affectés d’un vice radical. Les commissaires aux comptes et experts-comptables, notamment, dont les missions ont des effets légaux considérables, agissent dans un vide juridique, ce qui remet en cause la légalité de milliers d’actes de certification et de contrôle.
L’absence de cadre légal valable ne concerne pas seulement la forme sociétaire : elle affecte toute l’architecture de l’exercice professionnel. La prétendue réforme de 2023, loin de rétablir la légalité, l’a au contraire aggravée. En l’absence de ratification, l’ordonnance n°2023-77 n’a aucune valeur législative, mais elle est néanmoins appliquée par les ordres professionnels, les greffes et les juridictions, dans un mépris absolu du principe de souveraineté parlementaire garanti par l’article 38 de la Constitution.
Depuis la décision n°2020-843 QPC du 28 mai 2020, le Conseil constitutionnel a ouvert une brèche considérable dans le droit constitutionnel français, en validant que des ordonnances non ratifiées puissent acquérir valeur législative si elles sont « tacitement » reprises dans une loi. Cette jurisprudence, incompatible avec l’article 38 et la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a permis au pouvoir exécutif d’imposer des normes sans aucun vote, en contournant le Parlement. L’ordonnance du 8 février 2023, appliquée sans ratification, illustre cette dérive grave : elle confère à l’exécutif un pouvoir réglementaire absolu, détruisant l’équilibre républicain fondé sur la séparation des pouvoirs.
Il s’agit d’un véritable coup d’État juridique, silencieux mais redoutable. La démocratie représentative est dévoyée, le droit est réécrit sans le peuple, les professions réglementées sont engagées dans des structures sans base légale, et les actes qu’elles produisent sont entachés de nullité. La souveraineté populaire est bafouée. Cette situation, loin d’être un simple dysfonctionnement technique, révèle un système de gouvernement par ordonnance, par décret, par fraude législative institutionnalisée, sans contrôle parlementaire effectif.
Un tel régime constitue non seulement une violation grave du droit constitutionnel français, mais également une atteinte directe aux droits fondamentaux des citoyens, qui subissent les conséquences d’actes dépourvus de toute validité légale, sans possibilité réelle de recours. Il est impératif que cette situation soit dénoncée publiquement, juridiquement et politiquement, car elle marque la fin de l’État de droit tel qu’il est garanti par la Constitution.
Une chaîne opaque de captation des biens dans les procédures collectives
Derrière les apparences d’un cadre judiciaire organisé, les procédures collectives, censées protéger les entreprises en difficulté, dissimulent en réalité un système structuré de captation opaque des biens. Cette chaîne, étroitement verrouillée, repose sur des mécanismes illégitimes, où se mêlent conflits d’intérêts, collusions professionnelles, absence de transparence, et contournement manifeste du droit.
Dans le cadre des redressements ou des liquidations judiciaires, les rôles-clés sont systématiquement confiés à des administrateurs et mandataires judiciaires, des greffiers, des commissaires de justice et des avocats, tous souvent liés par des intérêts communs ou des relations personnelles, voire structurelles. Ces acteurs, dont le statut est déjà frappé d’irrégularité pour les raisons exposées précédemment, exercent une influence déterminante sur l’ensemble du processus : désignation des experts, validation des créanciers, gestion du patrimoine à liquider, choix des modalités de cession, et organisation des ventes aux enchères. Tout est verrouillé, souvent sans que les parties concernées — débiteurs ou autres candidats acquéreurs — ne disposent d’aucun véritable recours effectif.
Dans les faits, les biens immobiliers saisis dans le cadre d’une liquidation sont souvent vendus à des prix dérisoires, très en deçà de leur valeur réelle. Le processus de mise en vente lui-même est profondément vicié : les visites sont filtrées par des commissaires de justice ou des avocats proches du dossier ; l’accès est limité à certains candidats sélectionnés discrétionnairement ; les conditions de participation sont fixées de manière opaque ; et les offres sont parfois rejetées sans justification. Le rôle de l'avocat "en charge de la vente" est ici central : c’est lui qui contrôle le dépôt du chèque d'acompte, nécessaire pour participer à l’enchère, ce qui lui permet, dans la pratique, de choisir qui peut ou non concourir à l’achat.
Cette mainmise procédurale aboutit à une véritable captation organisée : les biens sont acquis par des tiers proches du réseau judiciaire, parfois via des sociétés liées aux professionnels en charge de la vente. Il n’est pas rare de constater que l'huissier ou l'avocat ayant géré les visites et la procédure est lui-même associé à une société immobilière, souvent enregistrée discrètement à son nom ou au nom d’un proche. Ce cumul des fonctions, totalement illégal en principe, est pourtant devenu courant. Dans certains cas, le professionnel agit comme commissaire-priseur sans désignation judiciaire, et le bien est adjugé au seul participant admis, pour une somme inférieure à 25 % de sa valeur estimée. La fraude est alors dissimulée sous le vernis d'une procédure régulière, alors même que l'ensemble des fondements juridiques de ces fonctions ont disparu.
Ce système repose sur une entente tacite entre professionnels — mandataires, commissaires de justice, avocats, greffiers — qui se cooptent, se désignent mutuellement, et se couvrent les uns les autres. Le conflit d’intérêt est omniprésent. Le contrôle effectif des juridictions est inexistant, d’autant que les tribunaux de commerce eux-mêmes sont juridiquement illégaux et leurs décisions radicalement nulles. La Cour des comptes elle-même, dans plusieurs rapports, a dénoncé les dérives, les abus, et les effets pervers du traitement judiciaire des entreprises, notamment les coûts injustifiés, la faiblesse des contrôles, et l’opacité des nominations.
Cette captation n’est pas seulement une dérive, elle constitue une spoliation organisée et une atteinte grave au droit de propriété, protégée par les textes fondamentaux, tant nationaux (article 17 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789) qu’européens (article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH). Lorsqu’un bien est arraché à son propriétaire par une juridiction illégale, au profit d’un acteur professionnel illégalement constitué, via une procédure truquée, nous ne sommes plus dans un État de droit, mais dans une logique prédatrice institutionnalisée.
Il est urgent de révéler et dénoncer ce système de captation judiciaire, qui dissimule une redistribution opaque et discrétionnaire des richesses, orchestrée par une poignée de professionnels de justice devenus acteurs économiques, investisseurs, et bénéficiaires directs des procédures qu’ils sont censés encadrer. Cette corruption structurelle, nourrie par l’inaction du ministère de la Justice et la passivité des institutions de contrôle, constitue un scandale d’État. L’ensemble des ventes, décisions et cessions intervenues dans ce contexte doivent être reconsidérés, et les victimes de cette machine judiciaire illégitime sont en droit d’exiger réparation.
Conséquences juridiques directes : responsabilité, nullité, inconstitutionnalité et rupture des droits fondamentaux
Les illégalités structurelles exposées dans ce dossier ne relèvent pas seulement d’un vice de forme ou d’un débat doctrinal. Elles emportent des conséquences juridiques directes, graves et immédiates, tant sur le plan de la responsabilité individuelle que de la validité des actes émis. Plusieurs fondements juridiques peuvent ainsi être mobilisés pour engager la responsabilité des auteurs, faire tomber les actes, et dénoncer l’incompatibilité du système avec les normes supérieures.
1. Rupture du droit à un procès équitable – article 6 §1 de la Convention EDH
Le recours à des juridictions commerciales composées de juges consulaires illégalement institués, appuyés par des greffiers ou mandataires judiciaires dépourvus de fondement légal, constitue une rupture flagrante du principe d’impartialité et d’égalité des armes. Le justiciable est confronté à une structure judiciaire viciée, incompatible avec les exigences du procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l’homme.
2. Responsabilité civile des officiers publics – article 1240 du Code civil (ancien art. 1382)
Tout acte validé, enregistré ou authentifié par un professionnel n’ayant pas qualité pour le faire – du fait de l’inexistence de sa base légale – engage sa responsabilité personnelle pour faute. Cette responsabilité est d’autant plus évidente que la connaissance de l’irrégularité est démontrable, tant les textes abrogés et les lacunes normatives sont publics et accessibles.
3. Inconstitutionnalité par défaut de ratification – article 38 de la Constitution et jurisprudence CC
L’ensemble des dispositifs fondés sur des ordonnances non ratifiées viole l’article 38 de la Constitution, qui encadre strictement le recours à l’ordonnance. La décision n°92-316 DC du 20 janvier 1993 a rappelé que seule une loi expressément ratifiée par le Parlement peut produire des effets équivalents à la loi. L’absence de ratification prive l’ordonnance de toute valeur normative dans le bloc de constitutionnalité.
4. Responsabilité pénale – faux, usage de faux et usurpation de fonction
La persistance à exercer une fonction d’autorité publique (greffier, commissaire, mandataire) sur la base d’une loi abrogée ou inexistante, tout en délivrant des actes à force exécutoire, peut relever de la qualification de faux en écriture publique (article 441-4 du Code pénal), d’usage de faux, voire d’usurpation de qualité ou de titre protégé. Cette fraude répétée est susceptible de déclencher des poursuites pénales individuelles.
5. Nullité absolue des actes émis – défaut de capacité juridique
En droit privé comme en droit public, un acte émis par une personne ou entité dépourvue de qualité est frappé de nullité absolue. Cette nullité n’a pas besoin d’être invoquée dans un délai spécifique : elle peut être soulevée à tout moment, y compris d’office. Tous les actes émanant de professions judiciaires commerciales organisées en sociétés illégales, ou instituées par des textes abrogés ou non ratifiés, sont donc juridiquement nuls et sans effet.
6. Atteinte au droit de propriété – article 17 DDHC & article 1er du 1er Protocole CEDH
Toute saisie, vente ou confiscation opérée par une juridiction ou un officier judiciaire illégalement institué constitue une atteinte grave au droit de propriété. En l’absence de base légale, toute expropriation ou aliénation judiciaire opérée par ces structures viole l’article 17 de la Déclaration de 1789 et l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Ces textes imposent que toute privation de propriété soit fondée sur une loi claire, accessible et prévisible, ce qui est manifestement exclu ici.
7. Absence de recours effectif – article 13 de la Convention EDH
Le fonctionnement des juridictions commerciales françaises, ainsi que l’exercice des professions judiciaires affiliées sur la base de textes inexistants, viole l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le justiciable, confronté à des décisions émanant de juridictions illégalement instituées ou de professionnels dépourvus de fondement légal, ne dispose d’aucun recours effectif devant une instance réellement indépendante pour faire valoir ses droits. Aucune juridiction ordinaire ne contrôle la validité constitutionnelle des textes à l’origine de ces fonctions, et les cours suprêmes (Conseil d’État, Cour de cassation) refusent systématiquement d’en tirer les conséquences. Le Conseil constitutionnel, quant à lui, ne peut être saisi par voie directe par un citoyen sans filtre juridictionnel. Ce verrouillage institutionnel constitue une privation de droit au recours effectif, en violation directe de l’article 13 de la CEDH.
Conclusion générale de l’analyse de la CISDHJ : Une République hors-la-loi, une souveraineté confisquée
Au terme de cette démonstration implacable, la Confédération Internationale des Syndicats des Droits de l’Homme pour la Justice (CISDHJ) constate un effondrement total des garanties constitutionnelles, législatives et républicaines censées encadrer l’exercice du droit, de la justice et des professions réglementées en France.
Ce constat ne relève ni d’une hypothèse politique, ni d’un débat doctrinal : il découle d’une analyse rigoureuse des textes en vigueur, des lois abrogées, des décrets détournés, des ordonnances jamais ratifiées et des codifications frauduleuses qui forment aujourd’hui la matrice illégale de l’appareil judiciaire, fiscal, social et professionnel de la République. Le Code de commerce, le Code général des impôts, le Code monétaire et financier, le Code de l’organisation judiciaire, les lois sur les sociétés civiles professionnelles et les ordonnances encadrant les professions libérales ont été méthodiquement vidés de leur légitimité constitutionnelle, réduits à de simples dispositifs administratifs imposés sans fondement parlementaire.
Les juridictions commerciales, les offices ministériels, les organismes de recouvrement comme les URSSAF ou la MSA, les ordres professionnels, les procédures collectives et les ventes judiciaires sont aujourd’hui mis en œuvre par des institutions et des professionnels dépourvus de toute autorité légale. Ce que l’on présente comme des fonctions régaliennes repose en réalité sur une fiction normative construite hors du droit.
Ce système d’usurpation généralisée repose sur la neutralisation des contre-pouvoirs, le contournement systématique du Parlement par des ordonnances non ratifiées, et l’anéantissement du consentement à la loi pourtant garanti par l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. L’apparence de légalité masque une rupture profonde avec l’ordre républicain.
La justice est désormais rendue par des juridictions inexistantes, les actes publics sont signés par des officiers illégaux, et les citoyens sont soumis à des décisions sans valeur normative. Les ventes aux enchères judiciaires, notamment, illustrent avec une acuité particulière cette dérive : des biens privés sont saisis et liquidés par des professionnels exerçant sans base légale, au profit de sociétés souvent liées par des montages opaques aux mandataires eux-mêmes, aux avocats ou aux réseaux d’officiers publics. Ces ventes constituent le point terminal d’une chaîne de dépossession institutionnalisée, dans laquelle les droits fondamentaux du citoyen sont systématiquement niés.
Il ne s’agit plus d’un simple dysfonctionnement : c’est un coup d’État juridique, silencieux, progressif, mais total — une falsification de l’État de droit au profit d’un ordre parallèle d’intérêt privé, dissimulé derrière les apparences républicaines.
Face à cette réalité, la CISDHJ appelle solennellement à :
- la restitution immédiate de la souveraineté populaire,
- la suspension de toutes les fonctions exercées sans base légale,
- la nullité de tous les actes émanant de structures illégales,
- et l’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire et internationale sur les mécanismes de falsification législative, de captation patrimoniale et de fraude institutionnelle perpétrés au sommet de l’État.
Cette commission devra inclure un audit complet des procédures collectives, des ventes judiciaires, des patrimoines spoliés, et des circuits financiers impliquant mandataires, greffiers, avocats, notaires, structures ordinales et sociétés immobilières de rachat. L’analyse des conflits d’intérêts, des connexions entre auxiliaires de justice et réseaux privés, ainsi que des effets économiques et sociaux de cette dépossession organisée est une exigence absolue de transparence, de réparation et de souveraineté.
Ce n’est pas une revendication politique. C’est une obligation républicaine.
Aucune paix sociale, aucune justice équitable, aucune démocratie réelle ne peuvent subsister sur les ruines d’un droit falsifié.
Références
Loi n°66‑537 du 24 juillet 1966
Loi n°66‑879 du 29 novembre 1966
Loi n°72‑626 du 5 juillet 1972
Décret n°78 329 du 16 mars 1978
Loi n°85‑98 du 25 janvier 1985
Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985
Loi n°87‑550 du 16 juillet 1987
Loi n°90‑1258 du 31 décembre 1990
Loi n°91‑1258 du 17 décembre 1991
Décret n°93‑86 du 21 janvier 1993
Loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999
Ordonnance n°2000‑912 du 18 septembre 2000
Projet de loi de ratification (n°2706) Assemblée nationale, 18 octobre 2000
Loi n°2003‑7 du 3 janvier 2003
Ordonnance n°2023‑77 du 8 février 2023
Projet de loi de ratification (n°847) Assemblée nationale, 5 juillet 2023
Loi n°2004‑1343 du 9 décembre 2004
Ordonnance n°2006‑673 du 8 juin 2006