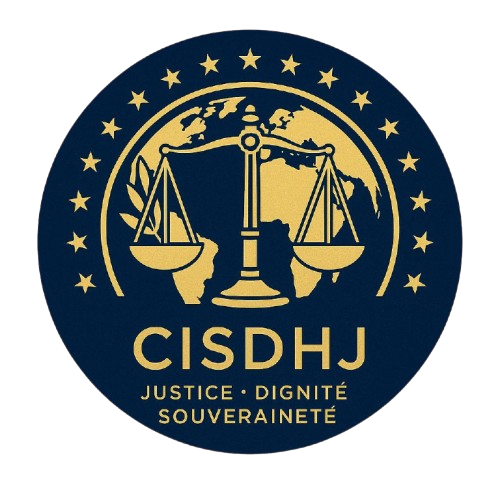Justice administrative
Justice administrative : quand l’État viole sa propre Constitution
Pourquoi lire cette page est essentiel pour comprendre l’effondrement de l’État de droit en France
La majorité des citoyens ignorent encore l’ampleur de la fraude institutionnelle qui gangrène les fondements mêmes de notre République. Derrière le vernis des institutions, une vérité glaçante se dévoile : le Code de justice administrative — socle de milliers de décisions rendues chaque année par les juridictions administratives — repose sur une ordonnance illégale, jamais valablement ratifiée. Cette manipulation, savamment orchestrée par le gouvernement, avalisée par le Parlement, dissimulée par le Conseil constitutionnel, et surtout cautionnée et appliquée par le Conseil d’État lui-même, révèle une trahison silencieuse des principes démocratiques les plus élémentaires.
En refusant d’alerter le public, en continuant à juger, condamner, et imposer sur la base d’un texte sans existence juridique, le Conseil d’État s’est mué en organe de validation d’une norme frauduleuse, détournant la justice administrative de sa mission constitutionnelle.
Comprendre cette fraude, c’est reprendre conscience de la gravité des abus commis au nom de l’autorité de l’État. C’est aussi poser les premières pierres d’une reconquête démocratique fondée sur la légalité, la transparence et le respect des droits fondamentaux. Lire cette page, c’est refuser de se soumettre à une République d’apparence. C’est choisir de voir, de savoir, et d’agir.
Le scandale du Code de justice administrative : une justice sans loi
Sommaire
- La loi d’habilitation du 16 décembre 1999 : un mandat précis, strictement encadré
- Analyse de l’ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du Code de justice administrative
- Caducité de l’ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 et rupture de légalité constitutionnelle
- Modification illégale du Code de justice administrative sous une nouvelle législature
- Ratification frauduleuse par l’article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003
- Détournement des règles constitutionnelles au profit de l’exécutif
- Conséquences juridiques de l’illégalité du Code de justice administrative
- Application abusive du 3ᵉ alinéa de l’article 38 de la Constitution
- Illégalité structurelle des juridictions administratives françaises
- Mise en cause des responsables de la fraude institutionnelle
- Infractions pénales et violations constitutionnelles
- En résumé
- Conclusions de l’analyse de la CISDHJ
La loi d’habilitation du 16 décembre 1999 : un mandat précis, strictement encadré
La loi n° 99‑1071 du 16 décembre 1999 a autorisé le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à adopter par ordonnance la partie législative de plusieurs codes fondamentaux, parmi lesquels figurait le Code de justice administrative. Ce texte s’inscrit dans une série de réformes techniques destinées à regrouper, sans les modifier, les règles existantes relatives à des domaines clés du droit français.
La portée de cette loi d’habilitation était rigoureusement délimitée. Il ne s’agissait pas d’accorder au pouvoir exécutif une compétence générale de réécriture du droit, mais de lui confier une mission de codification à droit constant, dans un cadre temporaire et sous contrôle parlementaire. L’article 1er de la loi énonce sans ambiguïté que chaque code fait l’objet d’une ordonnance distincte, et qu’il regroupe et organise les dispositions législatives relatives à la matière correspondante. Il précise ensuite une règle cardinale : les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sauf ajustements rendus nécessaires au respect de la hiérarchie des normes, à la cohérence rédactionnelle, et à l’harmonisation de l’état du droit.
Cette formulation exclut clairement toute modification de fond. L’opération confiée au Gouvernement était formelle, et visait exclusivement à ordonner le droit existant sans en altérer la substance. La codification à droit constant est une garantie essentielle du respect de la séparation des pouvoirs : le législateur reste le seul maître du contenu normatif, tandis que l’exécutif n’intervient que pour clarifier l’agencement des textes. Toute réforme matérielle, toute suppression de normes en vigueur ou toute création de nouvelles obligations excéderait dès lors le mandat conféré par la loi.
Enfin, la loi précisait des délais stricts : l’ordonnance relative au Code de justice administrative devait être prise dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi d’habilitation, soit avant le 16 septembre 2000. Ce délai s’accompagnait de l’obligation de déposer un projet de loi de ratification dans les deux mois suivant la publication de l’ordonnance.
La volonté du législateur était donc limpide : permettre une réorganisation technique du droit, sans altération de son contenu, dans un délai déterminé, sous le contrôle du Parlement. Tout dépassement de ce cadre constituerait une violation de la Constitution et un détournement manifeste du pouvoir constituant.
Les termes clairs et contraignants de la loi d’habilitation de 1999 ne permettent aucune interprétation extensive : chaque code devait regrouper et organiser les dispositions législatives relatives à la matière considérée, sans en modifier le fond. Le législateur n’a concédé au gouvernement qu’un pouvoir strictement encadré, limité à une opération de codification à droit constant, à l’exclusion de toute réforme ou abrogation. Dès lors, la conformité de l’ordonnance n° 2000‑387 du 4 mai 2000 au cadre ainsi défini appelle une analyse rigoureuse.
Analyse de l’ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du Code de justice administrative
L’ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 a été prise sur le fondement de la loi d’habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999. Elle prétend instituer, en ses annexes, la partie législative du Code de justice administrative. Son analyse détaillée révèle cependant de nombreuses anomalies juridiques, tant sur le fond que dans la structure même des articles qui la composent.
Article 1
L’article premier de l’ordonnance dispose que les dispositions annexées constituent la partie législative du Code de justice administrative. Une telle formulation pose problème. En droit, une ordonnance n’a valeur législative que si elle est ratifiée expressément par le Parlement dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution. En l’absence de ratification, elle conserve la nature d’un acte réglementaire. Cet article affirme donc une portée normative que l’ordonnance n’a pas encore, et ne peut acquérir que sous réserve de sa ratification. Il en résulte une prétention à la légalité législative qui est juridiquement infondée à ce stade.Article 2
Cet article instaure un mécanisme de modification automatique du Code de justice administrative. Il prévoit que toute disposition de ce code qui cite et reproduit un article d’un autre code ou d’une autre loi sera modifiée de plein droit dès que la disposition d’origine est modifiée. Un tel procédé est contraire aux principes fondamentaux du droit public français.
En premier lieu, il viole la séparation des pouvoirs : le Parlement seul est compétent pour modifier une norme de nature législative. En second lieu, il introduit une instabilité permanente dans le droit applicable, en rendant le Code de justice administrative évolutif sans intervention législative. Ce système nie la prévisibilité de la norme, pilier de la sécurité juridique. Enfin, il contrevient au principe de codification à droit constant, défini par la loi d’habilitation, qui ne permettait en aucun cas l’introduction de mécanismes dynamiques ou d’adaptation automatique du droit.Article 3
Cet article prévoit que les références contenues dans des dispositions législatives à des textes abrogés par l’article 4 de l’ordonnance seront remplacées par des références au Code de justice administrative. Derrière une formulation d’apparence technique se dissimule en réalité une substitution normative implicite, opérée sans délibération parlementaire.
Le gouvernement s’octroie ici un pouvoir de réécriture du droit qui excède largement le cadre de la codification à droit constant. Cette substitution automatique, opérée par voie réglementaire, est une atteinte grave à la légalité parlementaire : elle permet de maintenir une illusion de continuité légale là où des textes fondamentaux ont été supprimés sans remplacement conforme à la procédure démocratique.
Article 4
C’est dans cet article que l’ampleur de l’opération d’abrogation apparaît. L’ordonnance supprime une série de textes essentiels à l’organisation de la justice administrative, parmi lesquels : le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, plusieurs articles du Code de l’urbanisme, des dispositions relatives à l’indépendance des magistrats administratifs, et des règles d’exécution des jugements administratifs.
Cette série d’abrogations ne relève pas d’un travail de codification, mais d’une réforme du droit substantiel, interdite par la loi d’habilitation. L’ordonnance ne se contente pas de rassembler les textes en vigueur : elle les supprime, en introduisant par là-même un vide juridique ou une reconstruction normative sans base démocratique.
Article 5
L’article 5 étend l’application de l’ordonnance aux territoires d’outre-mer, sous réserve d’adaptations locales. Il n’appelle pas, en lui-même, de critique particulière, sauf à noter qu’il prolonge l’application d’un texte juridiquement contestable au-delà du territoire métropolitain.Article 6
L’article final confie l’exécution de l’ordonnance aux ministres compétents. Il précise que le texte entre en vigueur le 1er janvier 2001, soit plusieurs mois après sa signature. Cette disposition vise à donner le temps aux juridictions et administrations concernées de se préparer à l’entrée en vigueur du nouveau Code. Toutefois, cette disposition est neutre d’un point de vue contentieux : elle n’éteint en rien les critiques relatives à la validité même de l’ordonnance.Violation manifeste de la loi d’habilitation du 16 décembre 1999
La loi d’habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 imposait expressément une codification « à droit constant ». Cette exigence signifiait que le gouvernement ne pouvait, par ordonnance, ni modifier le fond du droit existant ni introduire de nouvelles règles. Son rôle était strictement limité à l’organisation rédactionnelle des dispositions en vigueur, dans le respect de la hiérarchie des normes et de la cohérence juridique.
Or, l’ordonnance du 4 mai 2000 n’a pas respecté cette contrainte. Elle a procédé à des abrogations substantielles, introduit de nouveaux mécanismes normatifs, et réécrit plusieurs dispositions dans des termes qui en modifient la portée juridique. En ce faisant, elle n’a pas codifié à droit constant : elle a reformé en profondeur, hors du cadre démocratique normal, une matière aussi fondamentale que le droit de la justice administrative.
Par ces transformations non autorisées, le pouvoir exécutif a excédé le mandat qui lui avait été confié par le législateur. Cette dérive est d’autant plus grave qu’elle a été dissimulée sous l’apparence formelle d’une codification. Il s’agit donc bien, juridiquement et politiquement, d’une réforme sans loi, d’un contournement de la souveraineté parlementaire, et partant, d’une violation du principe de séparation des pouvoirs.Caducité de l’ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 et rupture de légalité constitutionnelle
L’ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 a été adoptée sur le fondement de la loi d’habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999. Cette loi, prise en application de l’article 38 de la Constitution, imposait des délais stricts non seulement pour la prise des ordonnances, mais également pour leur ratification. Concernant le Code de justice administrative, qui figurait au 6° de l’article 1er de la loi, le délai pour adopter l’ordonnance était de neuf mois, et le délai pour déposer le projet de loi de ratification était impérativement de deux mois à compter de la publication de l’ordonnance.
L’ordonnance a été publiée le 4 mai 2000. Le projet de loi de ratification correspondant, enregistré sous le numéro 459, a été déposé à l’Assemblée nationale le 29 juin 2000, puis au Sénat le 5 juillet suivant. Toutefois, ce projet n’a jamais été inscrit à l’ordre du jour de l’une ou l’autre des chambres. À la fin de la XIe législature, en 2002, le projet est devenu caduc, conformément aux règles en vigueur. En effet, selon le droit parlementaire, tous les projets de loi dont l’Assemblée nationale est encore saisie à l’expiration de ses pouvoirs deviennent automatiquement caducs, qu’ils aient ou non fait l’objet de lectures ou de débats. Ce principe, rappelé expressément par le Sénat, implique que la procédure de ratification n’a jamais abouti.
Dès lors, l’ordonnance du 4 mai 2000 ne pouvait plus acquérir de valeur législative. Conformément au cadre constitutionnel, une ordonnance non ratifiée dans les délais impartis conserve une valeur réglementaire. Mais une fois le projet de ratification devenu caduc et le délai légal écoulé, cette ordonnance perd toute force juridique au titre de l’article 38 de la Constitution. Une nouvelle tentative de ratification aurait exigé une nouvelle habilitation, ce que le gouvernement n’a pas sollicité. En l’état, l’ordonnance et ses annexes étaient donc réputées nulles et juridiquement inexistantes.
La situation s’aggrave en 2003 lorsque la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 prétend conférer valeur législative à l’ordonnance de 2000. Cette opération législative présente deux vices majeurs. D’une part, elle intervient en dehors du cadre constitutionnel prévu par la loi d’habilitation de 1999, dont les délais sont dépassés depuis trois ans. D’autre part, la loi de 2003 omet de ratifier explicitement les annexes de l’ordonnance, c’est-à-dire les dispositions mêmes du Code de justice administrative. En droit, une ratification partielle ou implicite n’a aucune valeur lorsqu’elle concerne un texte déjà caduque. La ratification doit être expresse, complète et respecter les délais de l’habilitation d’origine. En ratifiant un texte déjà déchu, sans mentionner les annexes qui en constituaient la substance, la loi de 2003 entérine une fraude législative.
Le rapport parlementaire n° 752, enregistré à l’Assemblée nationale le 26 mars 2003, met en lumière les graves dysfonctionnements du processus de ratification des ordonnances. Il déplore l’accumulation des ordonnances non ratifiées, le non-respect des délais prévus par les lois d’habilitation, et les dérives substantielles de certaines ordonnances qui ont introduit des règles nouvelles sous couvert de codification. Le rapport évoque l’insécurité juridique générée par ces pratiques et l’atteinte au principe de séparation des pouvoirs, le législatif étant dessaisi au profit d’un exécutif qui agit hors contrôle parlementaire. Il recommande un renforcement du suivi parlementaire des ordonnances et une clarification des délais et procédures.
En définitive, l’ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000, non ratifiée dans les délais, dépourvue de support législatif depuis 2002, et partiellement et irrégulièrement reprise en 2003, ne peut constituer une base juridique valide pour la partie législative du Code de justice administrative. Son maintien en vigueur constitue une anomalie juridique majeure et manifeste une rupture du pacte démocratique, au détriment de la légitimité des institutions et de la sécurité du droit.
Modification illégale du Code de justice administrative sous une nouvelle législature
La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 a procédé à des modifications du Code de justice administrative, comme s’il s’agissait d’un texte législatif à part entière. Pourtant, à cette date, l’ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000, qui en constitue le fondement, était déjà juridiquement caduque. Le projet de loi de ratification n’ayant jamais été inscrit à l’ordre du jour ni voté, la procédure prévue par l’article 38 de la Constitution était demeurée inachevée. Conformément aux règles du droit parlementaire, le projet de loi était devenu caduc à la fin de la XIe législature en 2002, privant l’ordonnance de toute possibilité de ratification ultérieure.
Dans ce contexte, il est juridiquement inconcevable qu’un texte législatif ait pu être adopté pour modifier un document qui n’avait jamais acquis de valeur législative. Une ordonnance non ratifiée conserve le statut d’un acte réglementaire ; elle n’a pas vocation à entrer dans le bloc de légalité législative. Dès lors, la loi de 2002 ne pouvait, en droit, ni faire référence à l’ordonnance de 2000, ni la modifier. Elle l’a pourtant fait, opérant ainsi une intervention du Parlement sur un support juridique inexistant. Ce geste législatif est doublement vicié : d’une part, il repose sur un fondement dénué de toute légitimité législative ; d’autre part, il consacre une violation directe de la hiérarchie des normes en ce qu’il reconnaît, de fait, une valeur législative à un texte qui n’en possédait pas.
Ce type d’intervention, où le pouvoir législatif agit sur une base juridique irrégulière, constitue ce que l’on peut qualifier de fraude parlementaire. En modifiant un texte qui n’était pas légalement constitué, le Parlement a validé, de facto, une anomalie constitutionnelle sans en corriger l’origine. Il a contribué à renforcer l’illusion de légalité autour du Code de justice administrative, alors que celui-ci reposait toujours sur une ordonnance non ratifiée, donc nulle. Ce glissement normatif, passé inaperçu dans le débat public, constitue une atteinte profonde à la sécurité juridique, au principe de légalité et à la séparation des pouvoirs.
Ce mécanisme montre à quel point une irrégularité d’origine, si elle n’est pas traitée avec rigueur, peut se propager dans l’ensemble de l’édifice normatif, contaminant jusqu’aux lois qui prétendent lui donner consistance. Il confirme la nécessité d’un réexamen intégral de la validité du Code de justice administrative tel qu’il est aujourd’hui en vigueur.
Ratification frauduleuse par l’article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003
À la suite de l’adoption de la loi du 9 septembre 2002 qui prétendait modifier un texte juridiquement inexistant, le gouvernement et le Parlement ont tenté de donner une légitimité rétroactive à l’ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 par le biais de l’article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003. Cette initiative ne relève pas d’une simple irrégularité législative : elle constitue une violation manifeste des principes fondamentaux de l’État de droit, notamment de la séparation des pouvoirs, et une instrumentalisation des procédures parlementaires à des fins politiques.
En premier lieu, cette ratification est intervenue bien au-delà du délai imparti par la loi d’habilitation de 1999. L’ordonnance du 4 mai 2000 n’a jamais été ratifiée dans le délai de deux mois prévu, et le projet de loi déposé est devenu caduc à l’issue de la XIe législature. Une fois ce délai expiré, l’ordonnance n’avait plus aucune existence juridique législative. En droit, un texte caduc ne peut être ratifié a posteriori par une nouvelle législature, sauf à reprendre l’ensemble de la procédure prévue à l’article 38 de la Constitution, ce qui n’a pas été fait.
En second lieu, la ratification par l’article 31 de la loi de 2003 n’a pas été précédée d’un dépôt de projet de loi de ratification autonome, ni d’un débat spécifique sur la portée et la légalité de l’ordonnance en cause. Il s’agit donc d’une insertion furtive, dissimulée dans une loi fourre-tout, évitant sciemment tout examen contradictoire du fondement juridique de l’ordonnance. Ce procédé viole non seulement la Constitution, mais aussi les principes de loyauté du débat parlementaire et de transparence démocratique.
Le détournement des règles constitutionnelles est ici flagrant. L’article 38 de la Constitution fixe un cadre strict pour l’adoption des ordonnances : autorisation par le Parlement, adoption dans un délai déterminé, ratification explicite dans les formes législatives. Aucun de ces éléments n’a été respecté dans le processus de régularisation de 2003. En substituant une ratification indirecte et tardive à la procédure prévue, le législateur a contourné la volonté constitutionnelle du constituant.
L’acceptation silencieuse de cette fraude par les institutions, notamment par le Conseil constitutionnel qui a validé cette loi sans examiner la question de la caducité de l’ordonnance, achève de dresser le tableau d’une dérive institutionnelle complète. Le Parlement, censé être le gardien de la loi, a modifié un texte sans existence légale. L’exécutif, en organisant cette manœuvre, a abusé du pouvoir réglementaire délégué. Le Conseil constitutionnel, en ne soulevant pas d’office la violation du cadre de l’article 38, a manqué à son rôle de garant de la Constitution.
Il ne s’agit donc pas seulement d’une erreur juridique, mais d’un abus de pouvoir organisé, engageant collectivement les trois pouvoirs constitutionnels. Cette situation interroge la légitimité de tout le dispositif législatif relatif au Code de justice administrative. Loin de renforcer l’État de droit, cette ratification frauduleuse le mine en profondeur, en validant ex post une infraction manifeste aux principes démocratiques.
Détournement des règles constitutionnelles au profit de l’exécutif
La ratification tardive et irrégulière de l’ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 ne constitue pas un simple vice de procédure. Elle révèle un détournement systématique des règles constitutionnelles, orchestré au profit du pouvoir exécutif, sans respect des principes fondamentaux du droit public. Cette manipulation procédurale, bien que dissimulée sous des apparences légales, constitue une fraude institutionnelle d’ampleur, aux répercussions considérables sur la légalité des textes en vigueur et la crédibilité des institutions de la République.
La première atteinte manifeste concerne la séparation des pouvoirs. En contournant la procédure de ratification, le gouvernement s’est arrogé un pouvoir législatif qu’il ne détient pas, usurpant le rôle du Parlement. Les citoyens se sont ainsi vus imposer des normes juridiques sans qu’elles aient été, ni débattues ni votées par leurs représentants élus, portant gravement atteinte au principe démocratique.
Les ordonnances non ratifiées dans les délais fixés par la loi d’habilitation, bien qu’insérées au Journal officiel, demeurent privées de toute valeur législative. Leur application dans le domaine de la loi constitue une transgression manifeste de la hiérarchie des normes, transformant un texte réglementaire en prétendue loi sans fondement constitutionnel. Cette illégalité génère une instabilité normative profonde : des règles dépourvues de légitimité continuent d’être appliquées dans les prétoires, créant une jurisprudence bâtie sur du sable.
Le processus démocratique a également été vidé de sa substance. Les citoyens n’ont pu ni contester ni débattre de ces textes, car ceux-ci ont été élaborés et promulgués sans débat parlementaire réel. Cette éviction du peuple souverain du processus normatif constitue une négation du pacte républicain.
À cela s’ajoute une collusion structurelle entre l’exécutif et le législatif. L’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen stipule clairement qu’une société sans séparation des pouvoirs n’a point de Constitution. Or, la majorité parlementaire étant souvent alignée sur l’exécutif, aucun contre-pouvoir n’a pu émerger pour s’opposer à cette dérive. Le Parlement s’est réduit à une chambre d’enregistrement, validant des lois sans contrôle, notamment dans les domaines sensibles comme la régulation bancaire et financière. Cette configuration a permis à l’État de confier la gestion des finances publiques à une entité privée, la Banque de France, enregistrée au registre du commerce et des sociétés, sans fondement légal clair ni contrôle démocratique.
Le Conseil constitutionnel, quant à lui, s’est montré défaillant. Dans sa décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, il n’a pas soulevé le dépassement du délai de ratification de l’ordonnance n° 2000-387, pourtant essentiel à la validité du texte. Ce silence est d’autant plus grave que le Conseil est le gardien de la Constitution et du contrôle de la légalité des lois. Il a failli à sa mission, en ne censurant pas une disposition qui viole de manière flagrante l’article 38 de la Constitution.
La loi constitutionnelle du 3 juin 1958, fondement même de la Cinquième République, repose pourtant sur cinq principes essentiels : la séparation des pouvoirs, le respect de la hiérarchie des normes, et le contrôle de constitutionnalité des lois, entre autres. En validant une ratification illégale, le Conseil a manqué à chacun de ces principes. Le conflit d’intérêts est manifeste : les membres du Conseil sont désignés par les plus hautes autorités politiques, et leur impartialité structurelle est donc contestable dès lors qu’ils valident des lois renforçant le pouvoir exécutif.
L’article 1er du Code civil rappelle que les lois ne peuvent être exécutées qu’après avoir été promulguées et publiées conformément aux règles constitutionnelles. Or, un texte caduque et ratifié hors délai ne peut être considéré comme promulgué conformément à ces règles. En validant la ratification de l’ordonnance du 4 mai 2000, le Conseil constitutionnel a détourné le droit constitutionnel pour légitimer une ordonnance nulle. Cela a permis la création d’un Code de justice administrative sans fondement juridique. Dès lors, l’ensemble de la structure juridictionnelle administrative — Conseil d’État, cours administratives d’appel, tribunaux administratifs — repose sur un édifice juridique dénué de légalité.
Conséquences juridiques de l’illégalité du Code de justice administrative
L’édifice juridique bâti autour du Code de justice administrative repose sur une base frauduleuse et inconstitutionnelle. Cette fragilité originelle n’est pas qu’un vice de forme théorique : elle emporte des conséquences lourdes, directes et potentiellement systémiques sur l’ensemble de l’ordre administratif français. L’absence de fondement légal de l’ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 entraîne la remise en cause de la validité de toutes les décisions rendues, procédures engagées et structures administratives instituées sur ce socle illégal.
Premièrement, toutes les décisions judiciaires ou administratives fondées sur ce code sont atteintes d’une nullité potentielle. Une norme caduque, n’ayant jamais été valablement ratifiée, ne peut produire d’effet juridique. Par conséquent, toute décision de justice qui s’appuie sur les dispositions de ce code peut être considérée comme rendue ultra vires, c’est-à-dire en dehors du cadre légal. Cette nullité est absolue, car elle repose sur une violation directe de la hiérarchie des normes constitutionnelles.
Deuxièmement, les procédures elles-mêmes devant les juridictions administratives sont affectées d’illégalité. Les règles de compétence, de recevabilité, de procédure et de délai issues du Code de justice administrative sont privées de valeur normative. Cela signifie que chaque recours engagé, chaque jugement prononcé, chaque arrêt rendu l’a été selon un cadre juridico-procédural inexistant. C’est tout un pan de l’ordre juridictionnel administratif qui se trouve vicié à la racine.
Troisièmement, les justiciables victimes de cette illégalité structurelle disposent d’un droit à réparation intégrale. Toute personne ayant subi un préjudice du fait de l’application de ce code illégal peut intenter une action en responsabilité contre l’État devant les juridictions judiciaires, notamment sur le fondement de la faute lourde de fonctionnement du service public de la justice. Il est désormais acquis que l’application d’un texte dépourvu de force législative constitue une faute d’une gravité exceptionnelle engageant la responsabilité de l’administration.
Quatrièmement, l’État engage sa responsabilité pour faute lourde, à la fois normative et institutionnelle. En introduisant et en appliquant un texte vicié, malgré la connaissance des irrégularités constitutionnelles qui l’entourent, il commet un manquement d’une extrême gravité à ses obligations. Il incombe alors aux juridictions civiles de condamner l’État à indemniser les victimes — justiciables, avocats, administrations ou collectivités — de cette instabilité juridique.
Enfin, cette situation constitue une violation caractérisée de l’État de droit. Le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, suppose que la procédure soit fondée sur une loi accessible, claire et légitime. Or, ce n’est pas le cas ici. Les juridictions administratives françaises, agissant sur la base d’un code sans valeur législative, ont porté atteinte aux droits fondamentaux des justiciables. Cette situation ouvre la voie à des recours directs devant la Cour européenne des droits de l’Homme, notamment pour absence de base légale du procès, violation de l’égalité des armes et insécurité juridique prolongée.
En résumé, l’illégalité du Code de justice administrative entraîne une réaction en chaîne qui affaiblit la crédibilité de la justice administrative, remet en cause la sécurité juridique des citoyens, expose l’État à des réparations massives, et l’expose à une condamnation internationale. Le silence prolongé des institutions françaises sur ce point n’est pas une négligence : c’est une complicité active dans la mise en place d’un système juridico-administratif dérogatoire aux principes fondateurs de la République.
Application abusive du 3ᵉ alinéa de l’article 38 de la Constitution
L’affaire du Code de justice administrative met en lumière une dérive préoccupante de l’interprétation constitutionnelle française : l’usage abusif du troisième alinéa de l’article 38 de la Constitution. Cet article, qui encadre le recours aux ordonnances, contient en son troisième alinéa une disposition permettant qu’une ordonnance, à défaut de ratification expresse, acquière valeur législative si le délai d’habilitation expire sans rejet parlementaire. En théorie, cette procédure vise à éviter le blocage institutionnel. Mais dans le cas de l’ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000, elle a été détournée au point de constituer une rupture de l’équilibre démocratique.
L’ordonnance en question n’a jamais été ratifiée dans les délais impartis. Le projet de loi n° 459, déposé en juillet 2000, est devenu caduc à l’expiration de la XIe législature en 2002. À cette date, le texte aurait dû être déclaré juridiquement mort. Pourtant, en invoquant le troisième alinéa de l’article 38, l’exécutif a continué à imposer son application. Ce subterfuge constitutionnel a permis au gouvernement d’instaurer un texte législatif de fait, sans que le Parlement ne l’ait jamais voté. L’usage de cette clause, sans ratification expresse, revient à substituer un mécanisme automatique à la volonté du législateur. Or, en droit constitutionnel français, seule une loi votée confère une véritable légitimité démocratique.
Cette pratique contrevient à l’esprit même de la Constitution. Le deuxième alinéa de l’article 38 exige que les ordonnances soient ratifiées expressément pour acquérir valeur législative. Le troisième alinéa ne saurait être interprété comme une échappatoire autorisant une ratification implicite en cas d’inaction parlementaire. Pourtant, c’est précisément cette interprétation extensive qui a été consacrée, notamment par la décision du Conseil constitutionnel QPC n° 2020-843 du 28 mai 2020. Ce jugement a validé un détournement du contrôle parlementaire, permettant à l’exécutif d’imposer un texte par inertie, sans débat ni approbation explicite.
Ce mécanisme met gravement en péril la séparation des pouvoirs. Il permet à l’exécutif de légiférer seul, en vidant de sa substance le rôle du Parlement. Il mine le contrôle démocratique et réduit la souveraineté populaire à une fiction. Il transforme l’article 38, initialement conçu comme un outil d’efficacité législative temporaire, en un vecteur de contournement durable du débat démocratique.
Le résultat de cette dérive est double : un déséquilibre institutionnel d’une part, et une instabilité juridique massive d’autre part. La codification opérée par l’ordonnance n° 2000-387, présentée comme technique et neutre, dissimule en réalité une profonde réforme du droit administratif, intervenue sans aucun débat parlementaire. Cette réforme, imposée par un exécutif qui s’est arrogé des prérogatives législatives, viole frontalement l’article 1er de la Constitution, qui consacre la République française comme démocratique. En excluant les représentants du peuple du processus d’adoption d’un code fondamental, l’État français a failli à son devoir de respect de la souveraineté nationale.
Cette manipulation du droit constitutionnel ne peut rester sans conséquence. L’ordonnance n° 2000-387, et le Code de justice administrative qu’elle a produit, doivent être considérés comme nuls. Leur fondement juridique repose sur un détournement de procédure, une utilisation abusive des prérogatives constitutionnelles de l’exécutif, et une carence manifeste du contrôle juridictionnel. La complicité passive du Conseil constitutionnel, validant ce schéma par des décisions silencieuses ou permissives, entérine une situation de fait qui contredit les fondements même de l’État de droit.
Ainsi, l’article 38, dans sa lecture actuelle, ne garantit plus le respect de l’équilibre entre les pouvoirs. Il est devenu l’instrument d’une gouvernance normative sans mandat, où la loi se fait sans le peuple et contre la Constitution. C’est toute l’architecture républicaine qui vacille lorsque de tels mécanismes sont institutionnalisés.
Illégalité structurelle des juridictions administratives françaises
L’un des effets les plus graves de l’ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 concerne la situation juridique des juridictions administratives elles-mêmes. En prétendant instaurer le Code de justice administrative, cette ordonnance a simultanément abrogé, en son article 4, le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, qui constituait jusqu’alors la base législative de l’existence et de l’organisation de ces juridictions. Cette abrogation aurait nécessité une ratification expresse de l’ordonnance dans les délais prévus par la loi d’habilitation. Or, cette ratification n’est jamais intervenue.
En droit, une ordonnance non ratifiée dans les délais impartis ne peut ni modifier ni abroger une loi. Elle conserve le statut d’un acte réglementaire, dénué de force législative. En supprimant le fondement juridique des tribunaux administratifs par une simple ordonnance non ratifiée, le gouvernement a commis une violation manifeste de la hiérarchie des normes et de la séparation des pouvoirs.
Pire encore, cette ordonnance a prétendu leur substituer un nouveau cadre légal – le Code de justice administrative – qui repose lui-même sur un texte juridiquement caduc. La conséquence directe est que les juridictions administratives françaises – tribunaux administratifs, cours administratives d’appel et même le Conseil d’État en tant que juge – n’ont plus de base législative valide depuis 2002. Elles fonctionnent sur un texte dénué de force obligatoire, appliquant des règles de procédure, de compétence et d’organisation issues d’un code inexistant au regard du droit constitutionnel.
Cette illégalité originelle contamine l’ensemble de l’édifice juridictionnel administratif. Chaque décision rendue sur ce fondement est entachée de nullité potentielle. L’accès à un juge légal, exigé par les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, est compromis. Le justiciable n’est plus garanti d’être jugé par une juridiction légalement instituée, mais par une structure sans existence normative conforme. Cette situation constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux et met en péril l’ensemble de la justice administrative française.
Mise en cause des responsables de la fraude institutionnelle
La crise juridique générée par l’ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 et sa ratification postérieurement irrégulière ne saurait être réduite à une simple erreur administrative. Il s’agit d’une fraude institutionnelle systémique, impliquant une chaîne de responsabilités politiques, parlementaires, juridictionnelles et constitutionnelles. À chaque niveau, des acteurs ont participé, par action ou par omission, à la validation d’un texte caduc en dehors du cadre démocratique prévu par la Constitution.
Au premier rang des responsables figure le gouvernement de Lionel Jospin (1997–2002), qui a pris l’ordonnance du 4 mai 2000, déposé un projet de loi de ratification sans jamais le faire aboutir. En s’abstenant de défendre cette ratification dans les délais fixés par la loi d’habilitation, il a laissé se consumer l’autorisation parlementaire. Son successeur, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, a aggravé la situation en validant, par la loi du 2 juillet 2003, une ordonnance juridiquement caduque, sans respecter les conditions posées à l’article 38 de la Constitution. Il a ainsi acté une ratification frauduleuse.
Le Parlement, de son côté, a failli à sa mission de contrôle. En adoptant des lois modifiant ou se référant au Code de justice administrative, sans s’interroger sur la validité juridique de son fondement, il a donné force à un texte illégal. L’Assemblée nationale et le Sénat, tout comme leurs commissions compétentes, ont montré une absence de vigilance constitutionnelle, contribuant à l’effacement du contrôle démocratique. Le législatif est devenu l’instrument passif d’un exécutif qui s’affranchissait du cadre légal.
Les présidents de la République successifs ont également couvert cette manœuvre. Jacques Chirac, en poste au moment de l’adoption de la loi de ratification de 2003, a promulgué un texte reposant sur une ordonnance inexistante. Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron ont, chacun à leur tour, poursuivi l’application d’un Code sans fondement, perpétuant ses effets dans la durée sans jamais remettre en cause sa légitimité.
Le Conseil constitutionnel n’a pas rempli sa mission fondamentale de gardien de la Constitution. Il a validé, en 2003 puis en 2020, des lois et pratiques manifestement contraires à l’article 38, sans jamais censurer l’irrégularité du processus de ratification. En se montrant silencieux sur une faille aussi grave de la hiérarchie des normes, il a cautionné la marginalisation du Parlement et le contournement du suffrage universel.
Le Conseil d’État, quant à lui, incarne un conflit d’intérêts institutionnalisé. À la fois juge suprême de l’ordre administratif et autorité de tutelle des juridictions administratives, il a validé les effets du Code issu d’une ordonnance caduque tout en exerçant un pouvoir hiérarchique sur les juges qui l’appliquent. Cette double fonction, à la fois juridictionnelle et organique, porte atteinte à l’exigence d’impartialité et à la séparation des pouvoirs. Il a ainsi verrouillé l’ensemble du contentieux administratif dans une illégalité structurelle.
Enfin, les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ont, eux aussi, failli à leur devoir de protection des justiciables. En appliquant un Code dénué de toute valeur législative, sans en vérifier la légalité, ils ont entériné une rupture de la hiérarchie des normes. Leur dépendance organique vis-à-vis du Conseil d’État, leur absence d’indépendance statutaire et leur silence prolongé sur cette irrégularité massive posent un problème majeur de garantie des droits fondamentaux.
Cette chaîne de responsabilités démontre que la fraude institutionnelle ne se résume pas à une erreur ponctuelle, mais à un détournement coordonné des règles constitutionnelles. Ce système a neutralisé le débat démocratique, contourné la volonté parlementaire et imposé aux citoyens un droit administratif construit en dehors du cadre républicain. Il appelle une remise en question radicale des structures de contrôle de la légalité en France.
Infractions pénales et violations constitutionnelles
Les mécanismes décrits tout au long de cette analyse ne relèvent pas uniquement d’une illégalité administrative ou d’un dysfonctionnement institutionnel : ils sont susceptibles de constituer des infractions pénales d’une extrême gravité, ainsi que de violer frontalement les principes fondamentaux garantis tant par la Constitution française que par les engagements internationaux de la République.
Infractions pénales prévues par le Code pénal
Plusieurs qualifications pénales peuvent être envisagées à l’égard des auteurs ou complices de cette architecture frauduleuse :
Faux en écriture publique (article 441‑4 du Code pénal) : Le fait d’avoir fait passer pour législatif un texte qui ne l’était pas, ou de l’avoir utilisé comme tel dans un cadre juridictionnel ou administratif, constitue l’usage d’un faux à valeur probante publique. Chaque application du Code de justice administrative sur cette base équivaut à l’utilisation d’un acte frauduleux.
Escroquerie en bande organisée (article 313‑2 du Code pénal) : En induisant en erreur les juridictions, les justiciables et l’ensemble de la société civile sur la valeur juridique du Code, les institutions ont permis des transferts de fonds, des condamnations financières, et des décisions irréversibles, sur une base mensongère. La nature coordonnée et continue de cette action caractérise la bande organisée.
Extorsion de fonds et de biens (article 312‑1 du Code pénal) : Lorsque des décisions de justice administrative sont exécutées de force (saisies, astreintes, expulsions) sur un fondement illégal, cela constitue une privation arbitraire de biens sous menace ou abus d’autorité.
Association de malfaiteurs (article 450‑1 du Code pénal) : La coordination entre membres du gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil d’État et du Parlement, pour maintenir en vigueur un texte sans existence légale, entre dans la définition d’un groupement structuré agissant en vue de commettre des infractions graves.
Réduction en esclavage ou traitement inhumain (article 224‑1 du Code pénal) : La soumission systématique des citoyens à un régime de justice dépourvu de base légale, les privant d’un recours effectif, d’une sécurité juridique minimale et de droits procéduraux fondamentaux, peut s’apparenter à une atteinte grave à la dignité humaine. Si la qualification de réduction en esclavage requiert prudence, la répression des traitements inhumains et dégradants peut être juridiquement mobilisée.
Violations constitutionnelles et internationales
Outre le droit pénal interne, cette situation heurte les fondements mêmes de l’ordre constitutionnel et des traités internationaux auxquels la France est partie :
Violation de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : En l’absence de séparation effective des pouvoirs et de garantie des droits, le fondement même de la légalité républicaine est anéanti. Une société gouvernée par des normes illégitimes n’a, au sens strict, « point de Constitution ».
Violation du principe de légalité posé à l’article 34 de la Constitution de 1958 : Seul le Parlement est compétent pour établir la loi. Or, le Code de justice administrative a été imposé en dehors du champ de la législation, sans ratification valable, en contradiction directe avec les prérogatives constitutionnelles.
Violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) : Le droit à un procès équitable suppose que les juges appliquent des normes établies de manière claire, prévisible et légitime. Ici, les citoyens ont été jugés sur la base d’un texte non conforme aux règles de formation des lois, ce qui constitue un déni de justice institutionnalisé.
Violation de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) : Ce texte consacre lui aussi le droit à un procès équitable et à une égalité devant les juridictions. En s’affranchissant des procédures régulières de production du droit, la France a failli à ses engagements internationaux.
Conclusion de cette section
La combinaison de ces qualifications démontre que les effets de l’ordonnance du 4 mai 2000 ne sont pas seulement invalides en droit, mais relèvent d’un système d’abus de pouvoir, de contournement des institutions et de mise en échec des droits fondamentaux. Ce système appelle une réponse juridictionnelle forte, pouvant aller jusqu’à la qualification de crimes institutionnels contre la souveraineté populaire.En résumé
La loi d’habilitation n° 99‑1071 du 16 décembre 1999 a autorisé le gouvernement à adopter plusieurs codes, dont le Code de justice administrative, sous réserve d’une ratification expresse par le Parlement dans un délai strict. L’ordonnance n° 2000‑387 du 4 mai 2000, adoptée dans ce cadre, devait donc être ratifiée pour acquérir une valeur législative. Toutefois, le projet de loi n° 459, déposé le 5 juillet 2000 au Sénat, n’a jamais été inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et est devenu caduc à la fin de la législature en 2002. Par conséquent, l’ordonnance a perdu toute portée juridique.
Puis, en 2003, une ratification frauduleuse a été opérée hors délai, en violation de la Constitution et du principe de séparation des pouvoirs, permettant ainsi au Code de justice administrative de s’imposer sans base légale valable. Cette fraude législative implique le gouvernement de Lionel Jospin, le Parlement, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État, qui ont validé et appliqué un texte caduc. En conséquence, des milliers de décisions administratives et judiciaires ont été rendues sur un fondement illégal, entraînant une insécurité juridique massive pour les citoyens et les entreprises, des violations du droit à un procès équitable, et des préjudices économiques et sociaux. De plus, cette manipulation législative constitue une violation de l’article 1er de la Constitution et de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, compromettant gravement l’État de droit en France.
Un schéma récurrent de fraude institutionnelle
L’adoption frauduleuse du Code de justice administrative par ordonnance s’inscrit dans un schéma plus large d’abus du pouvoir exécutif en France. Tous les codes adoptés par ordonnances suivent une mécanique institutionnelle identique : détournement des lois d’habilitation pour imposer des textes non débattus démocratiquement, ratifications frauduleuses hors délais sans contrôle effectif du Parlement, et un Parlement devenu acteur et complice de ces dérives. Le tout, avec la complicité des institutions (Conseil constitutionnel, Conseil d’État, Parlement) qui valident ces fraudes en toute impunité.
Ce procédé a déjà été utilisé pour le Code monétaire et financier, le Code du commerce, le Code de l’environnement, le Code de l’organisation judiciaire et d’autres codes structurants du droit français. L’exécutif s’arroge un pouvoir législatif déguisé, annulant ainsi la souveraineté du Parlement et faussant l’équilibre des pouvoirs.
Une dictature législative déguisée
Ce mode opératoire constitue une dictature législative dissimulée, où le gouvernement impose des règles strictes aux citoyens, alors qu’il ne respecte pas lui-même la hiérarchie des normes et les règles constitutionnelles. L’État applique des décisions fondées sur des textes caduques, plongeant les citoyens et les entreprises dans une insécurité juridique totale.
Conclusions de l’analyse de la CISDHJ
L’analyse juridique rigoureuse conduite par la CISDHJ conclut sans ambiguïté à l’illégalité structurelle et constitutionnelle du Code de justice administrative tel qu’il est appliqué depuis 2001. L’ordonnance n° 2000‑387 du 4 mai 2000, faute d’avoir été ratifiée dans les délais impartis par la loi d’habilitation n° 99‑1071 du 16 décembre 1999, a perdu toute valeur juridique. Le projet de ratification n’ayant jamais été adopté avant la fin de la XIe législature, l’ordonnance est devenue caduque de plein droit. La prétendue ratification opérée par la loi n° 2003‑591 du 2 juillet 2003 ne saurait produire d’effets, étant intervenue hors délai, et sans reprendre les annexes constitutives du Code lui-même. Cette manœuvre constitue une fraude législative manifeste.
Les conséquences de cette illégalité sont immenses. Des juridictions entières — tribunaux administratifs, cours administratives d’appel, Conseil d’État — se trouvent privées de fondement normatif légitime. Chaque décision rendue sur la base d’un texte inexistant est entachée de nullité. Le principe du procès équitable, garanti tant par la Constitution que par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, se trouve violé. Il en résulte une possibilité de recours pour les justiciables, tant au niveau national qu’européen, ainsi qu’un droit à réparation pour les dommages subis du fait de l’application d’un code inconstitutionnel et caduc.
Au-delà de cette invalidité intrinsèque, la mécanique de ratification postérieure utilisée ici constitue un détournement pur et simple du pouvoir constituant. L’article 38 de la Constitution a été vidé de sa substance par une interprétation abusive permettant à l’exécutif d’imposer un texte législatif sans débat ni vote effectif. Cette dérive porte atteinte à la souveraineté populaire et au principe fondamental de la séparation des pouvoirs. Elle illustre la mise en place d’un appareil normatif illégitime, sous couvert de codification, qui mine les fondements mêmes de l’État de droit.
Par conséquent, la CISDHJ constate la caducité de l’ordonnance n° 2000‑387 du 4 mai 2000 et l’invalidité juridique du Code de justice administrative. Elle établit, par une démonstration fondée sur les textes constitutionnels, législatifs et jurisprudentiels, l’ampleur de la fraude institutionnelle commise. La suspension de l’application de ce code illégal, ainsi que la reconnaissance des violations constitutionnelles qui en résultent, s’imposent désormais en droit. Il en va de la survie du droit républicain, de la confiance dans les institutions, et de la protection effective des droits fondamentaux des citoyens français.