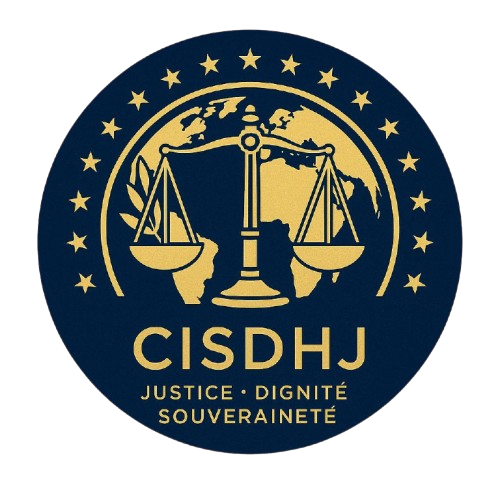Constitutions: une succession de coups d’État
Constitutions françaises : Deux siècles de falsifications et de ruptures illégales
Depuis plus de deux siècles, la France prétend s'appuyer sur des constitutions démocratiques, républicaines, garantes de l'État de droit. Pourtant, derrière l'apparence de la légalité, une analyse rigoureuse révèle une réalité bien différente : celle d’une succession de ruptures institutionnelles dissimulées, de textes jamais promulgués régulièrement, de référendums biaisés, et de régimes imposés par la ruse ou la force.
La Constitution de 1958, souvent présentée comme le socle de la Cinquième République, constitue en réalité l’aboutissement d’un coup d’État juridique, organisé en dehors de toute légitimité populaire. Ce texte, rédigé par le gouvernement de Charles de Gaulle, n’a pas été adopté dans le respect des principes constitutionnels de 1946, ni promulgué comme une véritable loi de révision. Il marque la confiscation définitive du pouvoir constituant au profit de l’exécutif.
Cette page examine la légalité de cette prétendue Constitution et, au-delà, revient sur les principales constitutions françaises adoptées depuis 1791, en démontrant que la souveraineté populaire a été, dans la quasi-totalité des cas, bafouée ou contournée. Il ne s’agit pas d’un simple débat historique, mais d’un enjeu fondamental de légitimité politique et juridique.
Car un peuple privé du pouvoir de faire la loi, de rédiger sa propre Constitution, et de contrôler ses représentants, n’est plus souverain. Il est soumis.
Or, parmi tous les textes constitutionnels de l’histoire de France, un seul répond pleinement aux exigences de légitimité démocratique, de souveraineté populaire et de validité juridique : la Constitution du 24 juin 1793. Rédigée par une assemblée élue, adoptée à la suite d’un référendum national organisé dans les assemblées primaires, puis promulguée officiellement par sa publication dans le Bulletin des lois, elle constitue la seule véritable Constitution du peuple français. Jamais légalement suspendue ni abrogée selon ses propres articles, elle demeure en vigueur de jure et représente l’unique fondement opposable de la souveraineté populaire. Toutes les constitutions postérieures, imposées par décret, plébiscite ou violence, n’en sont que des usurpations.
Sommaire
La Véme république : mise en place d'une dictature administrative
L’année 1958 marque un tournant décisif dans l’histoire politique contemporaine de la France. Minée par l’instabilité ministérielle chronique de la Quatrième République, et paralysée face à la guerre d’Algérie, la classe politique se trouve confrontée à une crise institutionnelle sans précédent. Dans ce contexte explosif, le général Charles de Gaulle, retiré de la vie publique depuis janvier 1946, est rappelé au pouvoir sous la pression croissante de l’armée, des colons d’Algérie et de certaines élites politiques françaises, désireuses d’un changement radical de régime.
Le 1er juin 1958, Charles de Gaulle est investi président du Conseil par 329 voix contre 224 à l’Assemblée nationale, devenant ainsi le dernier chef de gouvernement de la IVe République. Cette investiture, obtenue dans l’urgence et sous la menace d’un effondrement du pouvoir civil, se déroule dans des conditions d’exception qui dérogent aux principes constitutionnels en vigueur. En échange de son retour, de Gaulle exige des pouvoirs élargis, une révision constitutionnelle immédiate, et la possibilité de gouverner par ordonnances.
Pour donner une apparence de légitimité à ce basculement, son gouvernement est composé avec soin : 23 ministres sont nommés, dont 15 parlementaires et 7 hauts fonctionnaires. Toutes les grandes familles politiques sont représentées, à l’exception du Parti communiste, pourtant première force d’opposition. Parmi les ministres d’État figurent Guy Mollet (SFIO), Pierre Pflimlin (MRP), Louis Jacquinot (Indépendant) et Félix Houphouët-Boigny (RDA). Antoine Pinay est nommé aux Finances afin de rassurer les marchés. À l’inverse, seuls trois gaullistes sont présents : Michel Debré, André Malraux et Edmond Michelet.
Mais derrière cette façade d’unité nationale, se prépare en réalité une opération de prise de pouvoir constitutionnel sans précédent. L’objectif du général de Gaulle, soutenu par ses fidèles et par certains hauts fonctionnaires, n’est pas simplement de stabiliser les institutions existantes : il s’agit de les remplacer entièrement, en transférant l’essentiel du pouvoir à l’exécutif. Le retour de de Gaulle marque ainsi le point de départ d’un régime d’exception, fondé sur la dérogation aux règles fondamentales de la République parlementaire.
La loi constitutionnelle du 3 juin 1958 : un transfert illégal du pouvoir constituant
La loi constitutionnelle du 3 juin 1958, adoptée dans un climat d’instabilité politique, marque un tournant décisif dans l’histoire institutionnelle de la France. Officiellement présentée comme une loi de révision de la Constitution de 1946, elle opère en réalité un transfert illégal du pouvoir constituant, violant le principe fondamental de la souveraineté nationale.
Article unique – Loi constitutionnelle du 3 juin 1958
Par dérogation aux dispositions de son article 90, la Constitution sera révisée par le gouvernement investi le 1er juin 1958 et ce, dans les formes suivantes :
Le Gouvernement de la République établit un projet de loi constitutionnelle mettant en œuvre les principes ci-après :
1° Seul le suffrage universel est la source du pouvoir. C’est du suffrage universel ou des instances élues par lui que dérivent le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ;
2° Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être effectivement séparés de façon que le Gouvernement et le Parlement assument chacun pour sa part et sous sa responsabilité la plénitude de leurs attributions ;
3° Le Gouvernement doit être responsable devant le Parlement ;
4° L’autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être à même d’assurer le respect des libertés essentielles telles qu’elles sont définies par le préambule de la Constitution de 1946 et par la Déclaration des droits de l’homme à laquelle il se réfère ;
5° La Constitution doit permettre d’organiser les rapports de la République avec les peuples qui lui sont associés.
Pour établir le projet, le Gouvernement recueille l’avis d’un comité consultatif où siègent notamment des membres du Parlement désignés par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Conseil de la République. Le nombre des membres du comité consultatif désignés par chacune des commissions est au moins égal au tiers du nombre des membres de ces commissions ; le nombre total des membres du comité consultatif désignés par les commissions est égal aux deux tiers des membres du comité.
Le projet de loi arrêté en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, est soumis au référendum. La loi constitutionnelle portant révision de la Constitution est promulguée par le président de la République dans les huit jours de son adoption.
Ce texte semble décrire un processus exceptionnel mais néanmoins encadré. En apparence, le gouvernement agit conformément à une délégation de pouvoir parlementaire. En réalité, cette loi opère une suspension unilatérale de l’article 90 de la Constitution de 1946, article qui imposait une procédure parlementaire stricte, avec double lecture et vote renforcé, avant toute révision. Elle évacue purement et simplement le rôle du Parlement comme garant du pacte constitutionnel.
Le cœur du problème réside dans la nature du pouvoir exercé. Le pouvoir de réviser la Constitution est un pouvoir constitué, soumis à des formes et à des limites. Le pouvoir de rédiger une nouvelle Constitution, en revanche, est un pouvoir constituant, qui n’appartient qu’au peuple souverain ou à une Assemblée spécialement élue à cet effet. En confiant au seul gouvernement le soin d’élaborer un texte fondamental, sans contrôle parlementaire réel ni mandat constituant, la loi du 3 juin 1958 viole ce principe fondamental.
Le comité consultatif prévu n’a aucune valeur démocratique : ce n’est ni une Assemblée constituante ni une instance représentative du suffrage universel. Il s’agit d’un organe désigné, dépourvu de tout pouvoir de décision, réduit au rôle de chambre d’enregistrement. Le projet, une fois rédigé à huis clos, est directement soumis au référendum, sans débat public ni procédure parlementaire.
Le dernier alinéa est tout aussi révélateur : la loi « portant révision » de la Constitution devait être promulguée dans les huit jours de son adoption, conformément au texte voté. Ce terme de « révision » est essentiel : il démontre que la loi ne visait pas à fonder un nouveau régime, mais à modifier le précédent dans des limites définies. Or, dans les faits, ce n’est pas une révision mais une refonte complète du système politique français qui a été opérée, en contradiction flagrante avec le mandat juridique initial.
En droit public, un principe intangible veut qu’un pouvoir délégué ne puisse déléguer à son tour la compétence qui lui a été confiée. Le Parlement, en tant que délégataire de la souveraineté nationale, ne pouvait transférer au gouvernement une mission constituante. Il ne pouvait que l’exercer lui-même ou convoquer une Assemblée spécialement élue à cet effet. En acceptant ce transfert, il s’est rendu complice d’un véritable coup d’État légal, violant le principe d’intangibilité du pouvoir constituant.
La loi constitutionnelle du 3 juin 1958, sous son apparence technique et encadrée, constitue donc un acte de forfaiture juridique : une substitution illégitime des règles fondatrices, un viol du droit constitutionnel existant, et un déni de la souveraineté populaire.
L’ordonnance du 20 août 1958 : un acte inconstitutionnel dépourvu de toute valeur légale
Au cœur du dispositif ayant permis la mise en place de la Cinquième République se trouve un texte fondamental rarement évoqué : l’ordonnance n° 58-734 du 20 août 1958, dite « portant organisation du référendum ». Signée uniquement par Charles de Gaulle, en sa qualité de président du Conseil, cette ordonnance détermine les modalités du scrutin du 28 septembre 1958 : convocation du corps électoral, modèles de bulletins, composition des commissions, contentieux et proclamation des résultats. Mais ce texte, en apparence administratif, constitue en réalité le maillon central de l’illégalité du processus constitutionnel.
La loi constitutionnelle du 3 juin 1958, adoptée sous l’empire de la Constitution du 27 octobre 1946, ne conférait au gouvernement qu’un rôle préparatoire : « Le Gouvernement de la République établit un projet de loi constitutionnelle […] Le projet de loi arrêté en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, est soumis au référendum. » Autrement dit, le gouvernement ne pouvait qu’élaborer un projet ; l’organisation du référendum et sa promulgation relevaient exclusivement du Président de la République.
Or, selon les articles 13, 14, 31 et 36 de la Constitution de 1946, la répartition des compétences était claire :
- Article 13 : « L’Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit. »
- Article 14 : « Le président du Conseil des ministres et les membres du Parlement ont l’initiative des lois. »
- Article 31 : « Le président de la République signe et ratifie les traités, accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires. »
- Article 36 : « Le président de la République promulgue les lois dans les dix jours qui suivent leur adoption. »
Ces dispositions démontrent que seul le Président de la République – alors René Coty – détenait la compétence constitutionnelle pour convoquer le corps électoral et promulguer tout texte de portée législative. En se substituant à lui pour organiser le référendum, Charles de Gaulle a outrepassé la Constitution. L’ordonnance du 20 août 1958 n’a jamais été ratifiée, ni promulguée conformément à la procédure prévue ; elle n’a pas été signée par le Chef de l’État et n’a fait l’objet d’aucun dépôt devant le Parlement.
Il en résulte que le référendum du 28 septembre 1958 a été tenu sur la base d’un texte illégal, sans valeur législative, pris par une autorité incompétente. La convocation du peuple français n’a donc pas reposé sur la légalité constitutionnelle, mais sur une usurpation de compétence. Le corps électoral a été amené à se prononcer dans un cadre juridique inexistant, où la hiérarchie des normes était violée et le Président de la République privé de ses prérogatives.
En droit, une telle procédure ne saurait produire d’effets : un acte pris par une autorité non habilitée est nul et non avenu. L’ordonnance du 20 août 1958, jamais ratifiée, ne pouvait valider ni le référendum, ni la Constitution qu’elle prétendait organiser. Le texte du 4 octobre 1958 repose donc sur un vice originel de compétence et de promulgation, frappant de nullité la totalité de son processus d’adoption.
Sous couvert d’un référendum démocratique, la Cinquième République s’est imposée par un détournement de la légalité constitutionnelle, transformant la procédure de révision autorisée par la loi du 3 juin 1958 en un véritable coup d’État juridique. L’acte fondateur du régime actuel n’émane ni du peuple souverain, ni du Parlement, ni du Président de la République, mais d’un gouvernement agissant seul, par voie d’ordonnance, en dehors de tout cadre légal.
Références : Ordonnance n° 58-734 du 20 août 1958 ; Constitution du 27 octobre 1946 (articles 13, 14, 31, 36) ; Loi constitutionnelle du 3 juin 1958.
L’effondrement de la séparation des pouvoirs et la dictature par ordonnance
L’un des principes fondamentaux énoncés par la loi du 3 juin 1958 était celui de la séparation des pouvoirs. Pourtant, dès la mise en œuvre du nouveau régime, ce principe est vidé de toute substance. Le pouvoir exécutif s’empare de l’intégralité de l’appareil législatif par le biais des ordonnances, sans contrôle effectif du Parlement ni possibilité de censure réelle.
Le recours aux ordonnances en 1958 marque une rupture définitive avec l’équilibre des pouvoirs. Ces textes, souvent présentés comme techniques ou transitoires, ont en réalité réorganisé l’ensemble des institutions : élection du président, nomination des magistrats, fonctionnement du Parlement, Conseil constitutionnel, Conseil supérieur de la magistrature, élections législatives et sénatoriales, etc. Aucun de ces textes fondateurs n’a été ratifié par le Parlement dans les formes exigées. Aucun n’a été promulgué avec une signature présidentielle conforme. La justice, l’Assemblée, les élections et la présidence ont ainsi été refondées sans base légale.
Ce pouvoir normatif sans contrôle, instauré en 1958, préfigure ce que deviendra des décennies plus tard l’usage systématique de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution. Le gouvernement peut désormais imposer ses textes sans vote, en engageant sa responsabilité sur leur adoption, sachant que la discipline partisane rend toute motion de censure illusoire. Ce mécanisme, massivement utilisé sous la Ve République, n’est que la continuité directe du processus engagé par Charles de Gaulle : contourner le débat parlementaire, gouverner par décret ou ordonnance, et imposer la loi par voie d’autorité.
Ainsi, la Ve République n’a jamais été fondée sur une véritable séparation des pouvoirs. Elle repose sur une domination permanente de l’exécutif sur le législatif, et sur une justice subordonnée à l’État. Le principe de souveraineté nationale est vidé de son contenu. Le Parlement est réduit à une chambre d’enregistrement. La démocratie représentative est une façade, dissimulant un pouvoir technocratique centralisé, gouverné par ordonnances, décrets, et mécanismes d’urgence.
Une Constitution consolidée sans valeur juridique
La Constitution du 4 octobre 1958, présentée comme la pierre angulaire de la Ve République, est aujourd’hui un texte fantôme. Elle n’a jamais été republiée intégralement dans une version consolidée, officiellement promulguée et authentifiée après ses nombreuses révisions. Or, en droit, seule une publication régulière au Journal officiel dans sa version complète, signée par une autorité compétente, permet de garantir l’opposabilité d’un texte fondamental. Ce n’est pas le cas ici.
Les versions de la Constitution disponibles sur Légifrance n’ont qu’une valeur informative. Elles ne sont pas juridiquement opposables. Aucune version consolidée de la Constitution n’a été publiée de manière authentique depuis 1958. De multiples révisions sont intervenues – en 1962, 1974, 2000, 2008, entre autres – sans que le texte modifié ne soit jamais repromulgué selon les règles juridiques impératives. Ce défaut n’est pas une simple négligence administrative, mais un vice fondamental. Il prive le texte de toute valeur juridique actuelle. Un texte aussi central que la Constitution ne peut être appliqué qu’en étant intégralement publié, dans une version valide, identifiable, signée, datée, authentifiée. Cela n’a jamais été fait.
En conséquence, le texte constitutionnel invoqué aujourd’hui pour justifier lois, décisions, nominations, élections ou pouvoirs, n’existe pas juridiquement. Il est inopposable en l’état. Le pouvoir exécutif et les autorités publiques prétendent fonder leurs décisions sur un document qui, en réalité, n’est pas un acte juridique régulier mais une compilation d’articles non authentifiés.
Le décret n° 58-806 du 4 septembre 1958 : la convocation illégale du référendum constitutionnel
Le décret n° 58-806 du 4 septembre 1958, publié au Journal officiel, ordonne la soumission au peuple français du projet de Constitution élaboré par le gouvernement de Charles de Gaulle. Signé par le seul président du Conseil des ministres et contresigné par ses ministres d’État – Guy Mollet, Pierre Pflimlin, Félix Houphouët-Boigny, André Malraux, Michel Debré, Antoine Pinay, etc. – il convoque les électeurs pour le référendum du 28 septembre 1958. Aucune signature du Président de la République René Coty n’y figure.
Ce texte, délibéré en Conseil des ministres, aurait dû, en vertu du décret organique du 19 septembre 1870 sur l’organisation des pouvoirs publics, être signé par le Président de la République et contresigné par les ministres chargés de son exécution. Cette règle – « les décrets délibérés en Conseil des ministres sont signés par le Président de la République et contresignés par le ou les ministres responsables » – était toujours en vigueur en 1958 ; elle ne sera abrogée que par l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 (entrée en vigueur le 1er juin 2004). Aucun texte de la IVe République ne l’a supprimée ; elle s’appliquait donc pleinement au gouvernement de De Gaulle.
En signant seul ce décret, Charles de Gaulle a ainsi usurpé la compétence du Chef de l’État. Conformément à la Constitution du 27 octobre 1946, le Président de la République demeurait le seul dépositaire du pouvoir de promulguer les lois et les décrets délibérés en Conseil des ministres : les articles 13, 14, 31 et 36 en faisaient foi. Le président du Conseil ne disposait que de l’initiative des lois ; il n’avait aucun pouvoir propre pour convoquer le corps électoral ni pour promulguer un acte à portée constitutionnelle.
Le décret du 4 septembre 1958 viole donc simultanément :
- la Constitution de 1946, en ce qu’il empiète sur les compétences réservées au Président de la République ;
- le décret organique du 19 septembre 1870, qui imposait la signature présidentielle ;
- et la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, qui n’autorisait le gouvernement qu’à préparer un projet, non à organiser lui-même le référendum.
En droit positif de 1958, un décret délibéré en Conseil des ministres sans signature présidentielle est nul et inopposable. Ce principe sera d’ailleurs rappelé quelques années plus tard par le Conseil d’État dans son arrêt Sicard du 27 avril 1962, confirmant la continuité de la règle : « Les décrets délibérés en Conseil des ministres doivent être signés par le Président de la République ; la signature du Premier ministre ne suffit pas. »
En conséquence, le référendum du 28 septembre 1958 a été convoqué en violation du droit public en vigueur. L’acte fondateur de la Cinquième République repose sur un décret illégal, émanant d’une autorité incompétente et dépourvu de la signature obligatoire du Chef de l’État. Il s’agit d’un vice de compétence absolu, qui rend nul le processus référendaire et prive la Constitution du 4 octobre 1958 de tout fondement juridique.
En d’autres termes, la prétendue adoption démocratique du texte constitutionnel ne résulte pas d’un acte de souveraineté populaire régulier, mais d’une substitution illégale du gouvernement à la Présidence de la République, en violation des normes en vigueur depuis 1870. La Cinquième République est donc née d’un acte administratif irrégulier, pris en dehors de la légalité constitutionnelle.
Références : Décret n° 58-806 du 4 septembre 1958 ; Décret organique du 19 septembre 1870 (abrogé seulement par l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004) ; Constitution du 27 octobre 1946, articles 13, 14, 31 et 36 ; Loi constitutionnelle du 3 juin 1958 ; CE, 27 avril 1962, Sicard.
Une fois la procédure d’organisation illégalement engagée par voie d’ordonnance puis de décret, le pouvoir en place devait donner à cette manœuvre un vernis de légitimité populaire. C’est dans ce contexte que s’inscrit le discours du 4 septembre 1958, véritable pièce de propagande visant à transformer une rupture constitutionnelle en acte de salut national.
Le discours du 4 septembre et le référendum du 28 septembre 1958 : un habillage démocratique illusoire
Le 4 septembre 1958, place de la République à Paris, Charles de Gaulle s’adresse solennellement au peuple français pour présenter ce qu’il appelle le projet d’une « nouvelle République ». Mais avant lui, c’est André Malraux qui prend la parole dans un discours vibrant d’émotion. Il invoque la mémoire de la Révolution, la Résistance, les maquisards, la République éternelle et la grandeur de la France, dans un style lyrique et exalté. Il parle d’égalité, de fraternité, de justice, mais passe sous silence les mécanismes juridiques et politiques concrets par lesquels le régime en place est en train d’être balayé.
Le 1er juin 1958, Charles de Gaulle revient officiellement au pouvoir, nommé président du Conseil par l’Assemblée nationale. Dans la composition de son gouvernement, il confie à André Malraux un poste stratégique : ministre délégué à la présidence du Conseil, en charge de l’Information. Ce rôle, loin d’être anodin, lui donne la responsabilité directe de la communication gouvernementale dans une période charnière de transformation politique. Dès juillet 1958, Malraux voit sa mission élargie à l’expansion et au rayonnement de la culture française, consolidant ainsi sa position comme l’un des grands vecteurs du récit fondateur de la Cinquième République.
Son discours du 4 septembre 1958, lyrique et enflammé, prend alors tout son sens : il n’est pas une parole libre de penseur ou d’intellectuel, mais l’intervention d’un ministre chargé de canaliser l’émotion populaire pour légitimer un projet institutionnel préétabli. En exaltant les valeurs de la République, la mémoire de la Résistance, la fierté nationale et la fraternité combattante, il détourne l’attention du peuple des enjeux juridiques réels et de la rupture institutionnelle qui se prépare. À aucun moment, Malraux ne mentionne les modalités d’élaboration de la Constitution, ni le processus de confiscation du pouvoir constituant par l’exécutif. Il prépare ainsi le terrain pour Charles de Gaulle, dont le discours prolonge cette mise en scène consensuelle, masquant habilement la nature profondément unilatérale et opaque du processus constitutionnel en cours.
Certes, Malraux évoque la Cinquième République, mais il le fait dans des termes purement symboliques et abstraits :
« L’espoir est immense, même dans l’ordre de la justice, car de ce qui fut l’empire colonial de la IIIᵉ République, la Ve va faire avec vous la communauté. [...] Le pays sait que la Ve République apporte avec elle une chance et un espoir, alors que la IVᵉ ne portait plus en elle qu’échecs ou abandons. [...] C’est à vous qu’il appartient de tenter de faire de la Ve République l’héritière de la Iʳᵉ ou l’héritière de la machine à crise ministérielle [...] »
Mais à aucun moment il n’explique ce que contient cette Ve République, comment elle est née, ni ce qu’elle modifie du régime républicain. Il n’y a aucune mention du processus de rédaction opaque, du rôle du gouvernement, ni du fait que le peuple n’a pas été associé à l’élaboration de ce texte.
Puis vient le discours de Charles de Gaulle, construit sur la même logique. Il évoque le salut national, la stabilité retrouvée, l’efficacité de l’État, mais sans jamais présenter le contenu du texte constitutionnel soumis au référendum. Le général De Gaulle se garde bien de citer l’article 92, qui permettra au gouvernement de légiférer sans contrôle pour mettre en œuvre la Constitution. Il ne mentionne pas que le texte a été rédigé en dehors de toute assemblée constituante, qu’il résulte d’un processus unilatéral, ni qu’il déroge gravement aux principes de souveraineté populaire énoncés dans la Déclaration des droits de l’homme et la Constitution de 1946.
Le peuple, rassemblé pour écouter les figures historiques qui incarnent la Résistance et la République, n’a en réalité aucun moyen de comprendre ce qu’on s’apprête à lui imposer. Le texte de la Constitution n’est pas publié dans son intégralité dans la presse de masse, il n’est pas débattu, il n’est pas commenté librement par tous les partis. Le discours du 4 septembre n’est pas une présentation démocratique d’un projet constitutionnel, mais un outil de communication destiné à légitimer une rupture de régime par l’émotion et la confiance aveugle.
Il est essentiel de rappeler que le référendum du 28 septembre 1958 s’est tenu sous les institutions encore en vigueur de la IVᵉ République. Si le Parlement avait été dissous dès juin 1958, conformément aux conditions prévues par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, les autres structures institutionnelles, telles que la présidence de la République, les ministères, le Conseil de la République et le Conseil d’État, demeuraient pleinement opérationnelles. Le Conseil constitutionnel n’existait pas encore : il ne sera créé que par l’ordonnance du 7 novembre 1958, après le référendum. Le Président René Coty, investi selon la Constitution de 1946, est d’ailleurs resté en exercice jusqu’à la passation de pouvoir du 8 janvier 1959 avec Charles de Gaulle. Ce contexte démontre qu’aucune rupture formelle de régime n’a été actée, mais qu’un simple glissement institutionnel a été opéré sous couvert de révision.
De plus, le texte soumis au référendum n’a pas été élaboré par une assemblée constituante élue, comme l’exigerait tout véritable processus démocratique, mais rédigé en coulisses par le gouvernement, principalement sous la plume de Michel Debré, ministre de la Justice. Cette rédaction unilatérale, hors de tout cadre parlementaire et sans participation populaire, constitue une confiscation complète du pouvoir constituant, en violation flagrante du principe de souveraineté nationale.
Le référendum du 28 septembre 1958, censé consacrer le « choix du peuple », s’est tenu dans un contexte radicalement contraire aux principes de la démocratie. L’Assemblée nationale était suspendue, le Conseil de la République neutralisé, les partis d’opposition bâillonnés, et la propagande omniprésente. Le « oui » était présenté comme un acte patriotique indispensable, le « non » comme une trahison nationale. Aucune alternative n’était proposée, aucun débat libre ne pouvait avoir lieu, et le peuple n’a jamais eu l’opportunité de choisir entre plusieurs projets ni d’amender le texte.
Ainsi, le discours du 4 septembre et le référendum du 28 septembre n’ont pas été des actes de souveraineté populaire, mais des instruments de validation d’une prise de pouvoir unilatérale par l’exécutif. Les symboles républicains ont été détournés pour masquer un basculement autoritaire. Le peuple n’a pas participé à l’écriture de la Constitution, il n’en a pas débattu, il n’en a même pas pris pleinement connaissance. Il n’a donc pas pu y consentir. Le régime né de cette manipulation n’a aucune légitimité démocratique véritable : la Ve République repose sur un mensonge fondateur.
Une passation dans la continuité, non une fondation républicaine
La Constitution du 4 octobre 1958 n’a pas été promulguée par une nouvelle autorité constituée, mais bien par René Coty, président de la IVᵉ République, encore en fonction au moment de sa mise en œuvre. Ce dernier préside même la passation de pouvoir le 8 janvier 1959 à Charles de Gaulle, ce qui démontre, sans ambiguïté, que la nouvelle Constitution n’a pas rompu juridiquement avec la précédente, mais s’est inscrite dans la continuité de l’ordre constitutionnel antérieur.
Il s’agit donc moins de la naissance d’une République nouvelle que d’une succession institutionnelle camouflée sous un habillage démocratique. Charles de Gaulle, profondément hostile à la Constitution de 1946 qu’il avait quittée en janvier 1946, a volontairement refusé toute affiliation explicite à cette dernière. Pourtant, la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 n’autorisait qu’une révision, et non une refondation. Ce tour de passe-passe juridique constitue en réalité un coup d’État politique, un hold-up constitutionnel, perpétré avec l’apparence du droit.
Car malgré l’apparente nouveauté de la Ve République, la Constitution de 1958 reprend en réalité les fondements juridiques et les références de celle de 1946. Elle conserve notamment le préambule, réaffirme certains principes fondamentaux, et procède à une réorganisation des pouvoirs sans changer la nature républicaine du régime. L’innovation principale réside dans le renforcement des pouvoirs du Président, au détriment du Parlement.
La Cinquième République n’est donc pas une nouvelle République au sens juridique du terme, mais un aménagement autoritaire de la Quatrième, entériné sous contrainte et sans véritable consentement populaire. L’Assemblée nationale, désormais subordonnée à l’exécutif, voit son rôle réduit à celui de chambre d’enregistrement, cantonnée au vote du budget et des lois, tandis que les députés, devenus des professionnels du carriérisme politique, servent les intérêts de leurs partis plutôt que ceux du peuple.
Ainsi, la prétendue « nouvelle République » n’est qu’un changement de façade destiné à masquer une confiscation du pouvoir, une trahison des principes fondamentaux de la démocratie représentative. En réalité, la Ve République est née dans le mensonge et dans la continuité, non dans la rupture. Elle ne résulte pas d’une volonté populaire exprimée librement, mais d’un acte de force habillé en référendum. Il est donc légitime de contester sa légitimité même.
Le Titre XV de la Constitution de 1958 : Preuve écrite d’un pouvoir sans légitimité démocratique
Les articles 90 à 92 de la Constitution de 1958, regroupés dans son Titre XV intitulé « Dispositions transitoires », dévoilent sans ambiguïté la nature profondément antidémocratique du processus de fondation du nouveau régime.
L’article 90 suspend expressément la session ordinaire du Parlement et stipule que les députés en fonction verront leur mandat expirer à la date de la réunion de la future Assemblée nationale. Autrement dit, le corps législatif est mis en sommeil, ce qui prive le peuple de tout relais institutionnel durant une période déterminante. Le gouvernement s’octroie ainsi le monopole de l’initiative politique, sans contre-pouvoir.
L’article 91 organise le maintien en fonction de toutes les autorités existantes, notamment du président de la République — René Coty —, jusqu’à la mise en place des nouvelles institutions. Il précise que le Conseil de la République sera provisoirement transformé en Sénat, et qu’une commission transitoire, non élue, exercera les attributions du Conseil constitutionnel. Cela confirme que la prétendue « nouvelle République » s’installe en recyclant les structures de la précédente.
Mais c’est l’article 92 qui trahit le plus clairement la volonté de concentrer le pouvoir entre les mains de l’exécutif. Il autorise le gouvernement à légiférer par ordonnances « ayant force de loi » dans tous les domaines qu’il juge utiles « à la vie de la nation ». Il peut fixer le régime électoral des futures assemblées et prendre toutes les mesures qu’il estime nécessaires. Le pouvoir constituant, au lieu d’être exercé par le peuple ou par une assemblée élue, est ainsi capté par le gouvernement en place.
Ces trois articles agissent comme le mode d’emploi d’un coup d’État juridique : ils neutralisent le Parlement, suppriment tout contre-pouvoir, et permettent à l’exécutif de se substituer à la souveraineté populaire. Loin de constituer de simples « dispositions techniques », ils révèlent la stratégie de contournement démocratique qui a permis d’imposer un nouveau régime sans rupture légale apparente.
La prétendue Cinquième République n’est donc pas issue d’un processus constituant légitime, mais d’un dispositif transitoire visant à donner une apparence de légalité à un accaparement du pouvoir. Le Titre XV constitue la preuve écrite de cette opération de subversion juridique.
Une promulgation irrégulière et une mise en œuvre frauduleuse des institutions
La Constitution du 4 octobre 1958 est présentée officiellement comme ayant été adoptée par le peuple français lors du référendum du 28 septembre 1958. Pourtant, cette adoption repose sur une série d’irrégularités et d’illégalités majeures. Non seulement le texte promulgué n’a pas respecté les procédures prévues par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, mais sa mise en œuvre s’est déroulée dans un cadre frauduleux, sans respect des principes de continuité constitutionnelle ni des exigences fondamentales du consentement populaire éclairé.
La loi du 3 juin 1958 ne prévoyait qu’une révision de la Constitution de 1946, dans un cadre strictement encadré. Elle n’autorisait nullement une rupture du régime ou la rédaction d’un nouveau texte constitutionnel. Le gouvernement de Charles de Gaulle était limité à proposer un projet conforme aux cinq principes impératifs explicitement fixés : souveraineté du suffrage universel, séparation des pouvoirs, responsabilité du gouvernement devant le Parlement, indépendance de l’autorité judiciaire et respect des droits fondamentaux. Ces principes étaient issus du préambule de la Constitution de 1946, que la loi de révision ne pouvait ni ignorer, ni écarter.
Le dernier alinéa de la loi du 3 juin est sans équivoque : « Le projet de loi arrêté en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, est soumis au référendum. La loi constitutionnelle portant révision de la Constitution est promulguée par le président de la République dans les huit jours de son adoption. »
Or, le texte promulgué le 4 octobre 1958 ne constitue pas une « loi constitutionnelle portant révision » : il s’agit d’un acte unilatéral intitulé « Constitution de la République française », promulgué sans qu’aucune loi de révision conforme n’ait été adoptée. Il n’existe aucun texte intermédiaire transformant le résultat du référendum en loi constitutionnelle. Ce glissement illégal, de nature réglementaire, constitue une rupture manifeste de la chaîne de légalité constitutionnelle. La souveraineté populaire a été invoquée pour justifier un acte qui n’avait en réalité aucune base légale.
Pire encore, la Constitution de 1946 n’a jamais été formellement abrogée. Aucun article de la nouvelle Constitution n’en proclame explicitement la caducité. Aucune loi d’abrogation n’a été promulguée. Aucune dissolution de la IVᵉ République n’a été juridiquement actée. La continuité de certaines institutions – présidence, ministères, juridictions – jusqu’à janvier 1959 prouve qu’aucun acte formel de transition n’a été réalisé. Ce silence procédural, volontairement entretenu, aggrave le caractère frauduleux du basculement de régime.
Le texte soumis au référendum n’a jamais été présenté dans son intégralité au peuple français. Le discours du général de Gaulle du 4 septembre 1958, tout en mobilisant l’émotion collective, ne mentionne ni l’article 92, ni le rôle dévolu aux ordonnances. Le contenu juridique du projet reste volontairement occulté. Ce choix délibéré empêche tout consentement véritablement éclairé.
L’article 92 de la nouvelle Constitution, inséré sans débat démocratique, accorde au gouvernement un pouvoir de légiférer seul, par ordonnances, dans tous les domaines nécessaires à la mise en place des institutions du nouveau régime. Cette disposition instaure de facto un régime d’exception constitutionnalisé, sans aucun fondement dans la loi d’habilitation du 3 juin 1958. Elle consacre la mise en œuvre d’une dictature provisoire, masquée par les apparences d’un processus républicain.
Les conditions matérielles du référendum achèvent de discréditer ce prétendu acte de souveraineté : l’Assemblée nationale était suspendue, les partis d’opposition marginalisés, la presse muselée, et la propagande d’État omniprésente. Le scrutin n’a laissé place à aucun débat contradictoire, aucun amendement possible, aucun choix alternatif. Le peuple n’a pu que dire « oui » ou « non » à un texte qu’il n’avait pas écrit, qu’il ne pouvait modifier, et qu’il n’avait, pour la plupart, même pas pu lire dans son intégralité.
Dans ces conditions, il est juridiquement et politiquement faux d’affirmer que la Constitution du 4 octobre 1958 aurait été librement adoptée par le peuple français. Il n’y eut ni ratification régulière, ni abrogation formelle du texte antérieur, ni promulgation conforme aux règles constitutionnelles. Il y eut, en réalité, une usurpation du pouvoir constituant, opérée par un gouvernement agissant en dehors de tout mandat légitime, et dissimulant une prise de pouvoir sous les traits d’une réforme institutionnelle.
Une continuité de façade : le faux-semblant des préambules pour maquiller une rupture illégale
Pour tenter de donner une apparence de légalité à leur entreprise, les auteurs de la Constitution de 1958 ont intégré dans le texte le préambule de la Constitution de 1946, lui-même renvoyant à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Ce choix n’est pas anodin : en reprenant ces textes de référence, ils ont voulu suggérer une continuité juridique avec les régimes précédents, comme si la Cinquième République s’inscrivait dans une tradition républicaine ininterrompue. Mais cette opération relève du pur trompe-l’œil.
Il s’agissait d’un artifice destiné à masquer ce qui était en réalité une rupture radicale de régime. La loi constitutionnelle du 3 juin 1958 n’autorisait qu’une révision du texte de 1946, dans un cadre restreint et selon des principes strictement définis. Or, dès le discours du 4 septembre 1958, Charles de Gaulle évoque une « nouvelle République », ce qui trahit une volonté délibérée de rompre avec le régime antérieur. Il reconnaît implicitement qu’il ne s’agit pas d’une révision, mais d’une refondation complète du système constitutionnel, sans base juridique pour ce faire.
Cette contradiction entre l’apparence de continuité (via le maintien des préambules) et la réalité d’un changement de régime constitue une fraude constitutionnelle manifeste. Elle a permis de faire croire que le texte était une suite logique de l’histoire républicaine, alors qu’il en constitue une discontinuité totale, imposée sans respect de la souveraineté populaire.
De Gaulle, profondément hostile aux institutions parlementaires de la IVe République qu’il jugeait impuissantes, voulait rendre au président de la République un pouvoir exécutif fort. Le nouveau texte consacre ce changement : le président devient chef de l’exécutif, maître de la politique étrangère et de la défense, et peut dissoudre l’Assemblée nationale. Il s’agit d’un transfert massif de compétences, sans fondement légal, qui outrepasse largement le cadre autorisé par la loi du 3 juin 1958.
En somme, en préservant les symboles (préambules, références historiques), les auteurs de la Constitution de 1958 ont voulu neutraliser toute critique sur la rupture opérée. Mais cette continuité n’est qu’apparente. Le texte de 1958 constitue un véritable acte de refondation illégitime, un coup d’État juridique masqué sous les oripeaux de la légalité républicaine. C’est ainsi que, sous couvert d’un retour à l’ordre, la Cinquième République est née d’un acte de falsification constitutionnelle.
Les régimes constitutionnels d’autrefois : entre droit et imposture
De 1940 à 1946 : un basculement de l’État de droit vers l’exception
Pour comprendre l’illégalité originelle de la Constitution de 1958, il faut revenir à l’effondrement du cadre organique de 1875 entre 1940 et 1946. En pleine guerre, la France passe d’un ordre constitutionnel fondé sur les lois de 1875 à une légitimité de fait, façonnée par la défaite militaire, l’occupation, puis un gouvernement provisoire gouvernant par ordonnances. La souveraineté populaire y est progressivement neutralisée par des mécanismes d’exception et des délégations du pouvoir constituant.
La procédure de révision prévue par les lois constitutionnelles de 1875
Les lois constitutionnelles de 1875 prévoyaient une procédure stricte de révision : vote séparé par chacune des deux Chambres, puis réunion des deux Chambres en Assemblée nationale et adoption à la majorité absolue des membres composant cette Assemblée. Ce formalisme empêchait toute captation du pouvoir constituant par l’exécutif ou par un vote de circonstance. Aucune abrogation formelle de ces lois n’intervient en 1940 ; elles demeurent juridiquement en vigueur, même si leur application est neutralisée par l’état d’exception.
Le 10 juillet 1940 : un coup d’État constitutionnel sous couvert de « loi constitutionnelle »
Le 10 juillet 1940, réunie à Vichy, l’Assemblée nationale vote une « loi constitutionnelle » donnant tous pouvoirs au Gouvernement « sous l’autorité et la signature du maréchal Pétain » afin de promulguer, par un ou plusieurs actes, une nouvelle constitution. Ce vote intervient directement en Assemblée nationale sans les votes séparés préalables exigés par les lois de 1875. En transférant la totalité du pouvoir constituant à un militaire en temps de guerre, dans un contexte de contrainte et d’occupation, le régime bascule hors du droit : c’est un coup d’État constitutionnel, c’est-à-dire un changement de norme suprême sans respect de la norme de changement.
Le même jour, un décret présidentiel, signé par Albert Lebrun et contresigné par Pétain, ordonne la clôture immédiate de la session extraordinaire du Sénat et de la Chambre des députés, en se fondant sur l’article 2 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 relative aux rapports des pouvoirs publics. Ce texte dispose :
« La session extraordinaire du Sénat et de la Chambre des députés, ouverte le … juillet 1940, est et demeure close. »
Par ce geste, le pouvoir exécutif empêche toute poursuite des débats ou remise en cause parlementaire de la loi constitutionnelle votée quelques heures plus tôt. L’invocation formelle de l’article 2 de la loi de 1875, normalement destinée à régler l’ouverture et la fermeture des sessions, sert ici à neutraliser le législatif et à verrouiller la prise de pouvoir. Ce décret constitue ainsi un élément central du coup d’État constitutionnel : il scelle la fin de la procédure parlementaire normale et rend impossible tout retour à la légalité organique sans l’accord du nouvel exécutif.
Les « actes constitutionnels » de Vichy (1940–1941) et la neutralisation de la IIIᵉ République
À la suite du vote du 10 juillet, la réorganisation de l’État s’opère par une série d’« actes constitutionnels » pris par Pétain en 1940–1941, concentrant les pouvoirs entre les mains du Chef de l’État, dissolvant la représentation parlementaire effective et restreignant les libertés publiques. En 1941, un acte constitutionnel majeur parachève cette concentration tout en laissant subsister formellement les lois de 1875 : elles ne sont pas abrogées, mais rendues inapplicables. Le régime substitue aux contrôles parlementaires une administration autoritaire.
« Opération Sultan » (janvier–février 1943) : l’autoritarisme à l’œuvre
Au début de 1943, le régime met sa logique de pouvoir en pratique lors de l’« opération Sultan » à Marseille : une vaste opération de police, conduite avec la collaboration des autorités vichystes et de la police française, aboutit à l’évacuation forcée d’environ vingt mille habitants du quartier du Vieux-Port et à la destruction de centaines d’immeubles. Exécutée en lien étroit avec les forces d’occupation, cette opération illustre la nature du pouvoir né de la rupture de 1940 : un pouvoir militaire-administratif affranchi des garanties constitutionnelles, exerçant une violence d’État sans contrôle ni contre-pouvoirs.
L’« opération Sultan » menée à Marseille en janvier–février 1943 n’est pas un épisode isolé mais s’inscrit dans une série d’actions répressives conduites par le régime de Vichy, souvent en étroite collaboration avec les forces d’occupation. Comme lors des rafles du Vél’ d’Hiv (juillet 1942) ou des coups de filet de la zone sud (août 1942), Sultan combine planification administrative, exécution policière et objectifs politiques : épuration raciale, répression de la Résistance et remodelage urbain autoritaire. À Marseille, environ vingt mille habitants du quartier du Vieux-Port furent expulsés manu militari et des centaines d’immeubles rasés, sous couvert d’« assainissement » urbain. Cette opération illustre la logique profonde du régime issu du coup d’État constitutionnel de 1940 : un pouvoir militaire-administratif affranchi du cadre légal, capable de déployer une violence d’État massive et ciblée contre des populations civiles.
1944–1946 : gouvernement provisoire, ordonnances et référendums de délégation
À la Libération, le Gouvernement provisoire de la République française (GPRF), présidé par le général de Gaulle, ne rétablit pas le cadre organique de 1875. Il gouverne par ordonnances et organise, par l’ordonnance n° 45-1836 du 17 août 1945, un référendum qui ne porte pas sur l’adoption d’une Constitution mais sur la délégation du pouvoir constituant à une Assemblée élue. Le décret n° 45-2057 du 12 septembre 1945 fixe le bulletin de vote : la question posée est « Voulez-vous que l’Assemblée élue ce jour soit constituante ? ». Le « oui » l’emporte, transférant au législatif le pouvoir de rédiger la Constitution, tandis qu’une « loi constitutionnelle » du 2 novembre 1945 organise provisoirement les pouvoirs publics sans abrogation formelle des lois de 1875. La France demeure dans un entre-deux juridique où la légalité organique est écartée au profit d’une légitimité de fait.
Le référendum de 1945 ne soumettait aucun texte constitutionnel aux électeurs, mais une question de principe emportant délégation du pouvoir constituant. L’Assemblée constituante élue le 21 octobre 1945 comptait 586 membres élus à la proportionnelle nationale (PCF : 159 sièges, MRP : 151, SFIO : 146, Modérés : 64, Radicaux-socialistes : 60, et divers). La représentation féminine y était faible (33 élues, soit 5,6 %). Au verso du bulletin figurait le « Projet de loi portant organisation provisoire des pouvoirs publics », reproduisant huit articles : élection du président du Gouvernement provisoire (art. 1er), rédaction de la nouvelle Constitution (art. 2), soumission à référendum (art. 3), partage du pouvoir législatif avec le Gouvernement (art. 4), vote du budget sans initiative de dépenses (art. 5), expiration du mandat à l’entrée en vigueur de la Constitution ou au plus tard sept mois après la première réunion (art. 6), renouvellement immédiat en cas de rejet (art. 7) et force constitutionnelle de la loi (art. 8). L’inscription de ces dispositions sur le bulletin renforçait la délégation inconditionnelle du pouvoir constituant.
Le 2 novembre 1945, cette loi approuvée par référendum est promulguée comme « loi constitutionnelle » sans abrogation formelle des lois de 1875, qui demeurent suspendues de fait. Les successions de de Gaulle à Félix Gouin (23 janvier 1946), puis à Georges Bidault (12 juin 1946), se font par protocoles partisans, sans réunion du Parlement en Congrès ni élection présidentielle formelle, en contrariété avec la logique organique de 1875 relative à la vacance de la présidence.
1946 : promulgation de la Constitution de la IVᵉ République
Après le rejet d’un premier projet, un second texte est adopté par référendum le 13 octobre 1946, promulgué par Bidault le 27 octobre et publié le 28. Aucun président en titre n’a signé ces actes, le Parlement en Congrès ne s’est jamais réuni, et la souveraineté populaire n’a été exercée que pour valider une délégation du pouvoir constituant déjà accordée. La IVᵉ République naît d’un processus transitoire piloté par l’exécutif et légitimé par des référendums de délégation, prolongeant la rupture procédurale ouverte en 1940.
Ordonnances et culture de l’exception : un précédent répliqué
La période 1945–1946 est marquée par une panoplie d’ordonnances, méthode qui sera reprise en 1958. Parmi elles, la série n° 45-2590, 45-2591, 45-2592, 45-2593 témoigne d’un usage extensif du pouvoir réglementaire-constituant, au mépris du formalisme parlementaire. Certaines de ces ordonnances ont poursuivi leur existence normative, preuve de l’enracinement d’une légitimité de fait au détriment de la légalité organique.
Conclusion : continuité de la rupture et effacement de la souveraineté
Entre 1940 et 1946, la France passe d’un ordre constitutionnel régi par les lois de 1875 à un régime d’exception qui se normalise. Le vote du 10 juillet 1940, les actes constitutionnels de 1940–1941 et l’« opération Sultan » manifestent un pouvoir militaire-administratif issu d’un coup d’État constitutionnel. La Libération ne restaure pas le formalisme de 1875 ; elle entérine, par ordonnances et référendums de délégation, la substitution de la légalité de droit par une légitimité de fait. La IVᵉ République naît ainsi sur une rupture de continuité constitutionnelle qui préparera, en 1958, un nouveau basculement au profit d’un exécutif renforcé et d’une souveraineté populaire affaiblie.
Textes et procédure (1940 & 1875)
Loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 — Article unique (extrait) :
« L’Assemblée nationale donne tous pouvoirs au Gouvernement de la République, sous l’autorité et la signature du maréchal Pétain, à l’effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l’État français […] Elle sera ratifiée par la Nation et appliquée par les Assemblées qu’elle aura créées. »
Formule de promulgation et signatures :
« La présente loi constitutionnelle, délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale, sera exécutée comme loi de l’État.
Fait à Vichy, le 10 juillet 1940. ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République : Le maréchal de France, président du Conseil, PH. PÉTAIN. »
Procédure de révision des lois constitutionnelles de 1875 (rappel) :
Toute révision devait être votée séparément par chaque Chambre, puis soumise à l’Assemblée nationale (réunion des deux Chambres) et adoptée à la majorité absolue des membres la composant. Le vote direct et unique du 10 juillet 1940 en Assemblée nationale, sans votes séparés préalables, a donc violé la procédure en vigueur.
Qualification juridique : en l’absence de respect de la procédure de révision, le transfert du pouvoir constituant au maréchal Pétain constitue un coup d’État constitutionnel, opéré sous couvert d’une « loi constitutionnelle » mais en contrariété avec la norme supérieure alors applicable.
Au cœur de la fraude : comment naquit la Troisième République
Si l’on y regarde de plus près, les « lois constitutionnelles » de 1875 ne sauraient passer pour des textes neutres et légitimes : élaborées dans l’urgence politique qui suivit la défaite de 1870 et la Commune de Paris, elles furent adoptées dans un climat de manœuvres et de marchandages entre légitimistes, orléanistes et républicains opportunistes. Leurs votes successifs au Parlement (en février, juillet et décembre 1875) ont souvent obéi à des accords de coulisse plutôt qu’à un débat public transparent : plusieurs députés témoignent de tractations secrètes et de promesses de portefeuilles ou de circonscriptions en échange de leur soutien, révélant une véritable fraude politique à base de clientélisme et de pression. Mais, au-delà de la manipulation parlementaire, c’est surtout la procédure même de promulgation qui pose problème : ces lois, bien que inscrites dans les registres officiels, n’ont jamais été publiées conformément aux formes prévues par le Code civil – absence de contreseing ministériel, manque de publication au Bulletin des lois dans sa version définitive, parfois même divergence de textes entre les différents exemplaires officiels conservés. Cette lacune juridique privait donc la Troisième République de toute base constitutionnelle incontestable, laissant ouverte la possibilité d’un retour à un régime personnel ou monarchique, à tout moment.
Le précédent avait pourtant été donné en 1851, lorsque Louis-Napoléon Bonaparte, au terme d’une présidence entachée de vices de forme, organisa son coup d’État du 2 décembre 1851. Profitant de l’ambiguïté des pouvoirs présidentiels – conférés sans clarification par la Constitution de 1848 – il fit arrêter l’opposition, suspendit la liberté de la presse, et modifia à la marge les textes existants pour se maintenir à vie. La fraude électorale du 10 décembre 1848, qui l’avait porté au pouvoir avec un score de près de 75 % des voix, avait déjà été dénoncée pour absence de contrôle de la sincérité du scrutin et pressions locales exercées par les préfets. À la lumière de cet épisode, il apparaît que la Deuxième République, issue du vote de l’Assemblée du 4 novembre 1848, était de fait viciée dans son principe même : Louis-Napoléon y fit appliquer des modalités de promulgation et de publication tout aussi opaques, contournant ainsi les exigences du Code civil et créant un précédent dangereux pour l’avenir.
Ainsi, l’absence de toute promulgation régulière postérieure au 16 juillet 1875 – date à laquelle le dernier des textes fondateurs de la Troisième République fut promulgué – confère à notre régime constitutionnel un fondement légal plus que douteux. Cette faille originelle a servi de prétexte aux tentatives récurrentes de retour au pouvoir personnel au XXᵉ siècle (putsch de 1940, crises de mai 1958, complots royalistes ou bonapartistes, etc.), montrant combien les « irrégularités fondatrices » de 1875 continuent d’ombreler la trajectoire constitutionnelle française.
Révolutions, fraudes et coups d’État : la trajectoire instable de la République (1793-1875)
Avant même la naissance incertaine de la Troisième République, la France avait déjà traversé une longue succession de crises politiques, de manipulations électorales et de coups de force. Dès la chute du Directoire, Napoléon Bonaparte s’empare du pouvoir par le coup d’État du 18 Brumaire (9 novembre 1799), appuyant son entreprise sur la présence militaire et la pression sur les assemblées pour faire proclamer le Consulat. Deux ans plus tôt, en 1797, le coup d’État du 18 Fructidor avait vu les Directeurs renverser une majorité jugée trop favorable aux royalistes, faisant arrêter députés et ministres et invalidant des dizaines de milliers de suffrages pour préserver l’héritage révolutionnaire. Sous la Restauration, les Bourbons usèrent d’un suffrage censitaire étroitement contrôlé : préfets zélés, listes officielles et censure de la presse garantissaient la prééminence des grands propriétaires et des ultras, tandis que l’opposition se voyait systématiquement écartée. À l’avènement de la Deuxième République, les lois Falloux sur l’enseignement et la nouvelle loi électorale furent promulguées dans la précipitation, sans véritable concertation, pour fortifier le pouvoir exécutif que le président Louis-Napoléon Bonaparte entendait déjà étendre. L’élection présidentielle du 10 décembre 1848 fut entachée d’intimidations et de falsifications : bureaux de vote fantômes, pressions locales et procès-verbaux altérés permirent au neveu de Napoléon Ier de l’emporter avec plus de 74 % des suffrages. Dès lors, le coup d’État du 2 décembre 1851 ne fut plus qu’une issue logique : profitant de l’ambiguïté de son mandat unique et de la faiblesse d’une Constitution mal définie, Louis-Napoléon dissout l’Assemblée, suspend la liberté de la presse et se fait proclamer empereur, inaugurant le Second Empire.
Tous ces épisodes, marqués par la force et les rétro-manœuvres institutionnelles, montrent que la France s’éloignait peu à peu de l’idéal d’une souveraineté populaire pleinement assumée. C’est pourtant dans la tourmente de 1793 que se trouve un moment de bascule décisif : la Convention nationale, portée par le souffle révolutionnaire et par la volonté même du peuple insurgé, proclame la République, consacre le suffrage universel masculin et affirme que le pouvoir naît de la volonté des citoyens. Cette transition, née de la Révolution et “issue du peuple”, restera le jalon d’une légitimité démocratique que chaque régime ultérieur s’efforcera, tant bien que mal, de rappeler ou de trahir.
Convention nationale de 1793 issue du peuple
Contrairement à l’idée souvent véhiculée par l’historiographie officielle, la Constitution de 1793 n’est ni restée lettre morte, ni juridiquement inopérante. Adoptée à la suite d’un référendum national organisé dans les assemblées primaires entre le 20 juin et le 2 août 1793, elle fut officiellement promulguée par sa publication dans le Bulletin des lois du mois d’août, ce qui lui conféra pleine valeur légale. Aucun décret de suspension, ni acte abrogatif conforme à ses articles 115 à 119, n’a jamais été pris. Elle constitue ainsi la seule norme constitutionnelle pleinement légitime, démocratiquement ratifiée, et toujours en vigueur de jure. Sa mise entre parenthèses durant la Terreur ne remet nullement en cause sa validité juridique. Ce sont au contraire les régimes suivants — Directoire, Consulat, Empire, Monarchie, Républiques successives — qui ont imposé leurs constitutions sans fondement légitime, par la force ou la fraude. Analyse de la Constitution de 1793, seule Constitution légitime
Ainsi, les constitutions de la Deuxième, Troisième, Quatrième et Cinquième République reposent toutes sur des actes non promulgués régulièrement ou sur des procédures viciées, en violation du droit constitutionnel en vigueur. Quant à la Constitution de 1791, bien qu’elle ait été formellement promulguée, elle instituait une monarchie constitutionnelle fondée sur le suffrage censitaire, et fut définitivement abrogée par le décret du 21 septembre 1792 qui proclama l’abolition de la royauté et la fondation de la République. La seule véritable Constitution républicaine, démocratique et juridiquement valide, à la fois adoptée, ratifiée par référendum et promulguée, demeure celle du 24 juin 1793.
La Constitution de 1793, seule ratifiée et promulguée par référendum populaire, énonce à l’article 115 que « les actes du pouvoir législatif ne peuvent être promulgués qu’au nom du peuple français ». Contrairement aux affirmations officielles, aucun texte ne l’a suspendue ni abrogée. Le décret du 10 octobre 1793, qui proclame que « le gouvernement sera révolutionnaire jusqu’à la paix », n’a pas pour effet de mettre fin à la Constitution mais seulement d’instaurer un régime d’exception temporaire, laissant subsister en droit la norme suprême adoptée par le peuple. Dès lors, toutes les constitutions postérieures ont été mises en place en violation de l’article 115, privant le peuple de son droit imprescriptible à approuver lui-même les régimes successifs. Conscients de cette faille originelle, tous les présidents de la République ont gardé le silence, cautionnant un ordre juridique bâti sur une fraude institutionnelle. Il s’agit d’une usurpation permanente du pouvoir, fondée sur un dol constitutionnel : aucun chef de l’État n’a dénoncé ce système ni assumé la responsabilité de cette imposture. Dans ces conditions, les titulaires de la présidence ne sauraient revendiquer la moindre immunité ; ayant exercé leurs fonctions sans base légale et en méconnaissance de l’article 115, ils doivent être tenus personnellement responsables de cette supercherie républicaine.
Après sa ratification par référendum populaire et sa promulgation officielle le 24 juin 1793, la Constitution de l’an I entrait pleinement en vigueur sur le plan juridique : adoptée par la Convention, approuvée par les assemblées primaires et publiée, elle constituait la norme suprême de la République. Aucun texte n’a jamais prononcé sa suspension ou son abrogation. Toutefois, sa mise en application institutionnelle fut différée par le décret du 10 octobre 1793, qui instaura un gouvernement révolutionnaire d’exception « jusqu’à la paix », concentrant les pouvoirs entre les mains de la Convention et du Comité de salut public. Cet état d’exception, prolongé par les circonstances militaires et politiques, retarda indéfiniment l’installation des institutions prévues par la Constitution. En 1795, ce n’est pas le droit mais la politique et l’exécutif thermidoriens qui écartèrent la Constitution de l’an I : sans aucune abrogation formelle, la Convention adopta un nouveau texte, la Constitution de l’an III, élaborée et votée sans consultation directe du peuple. Ce remplacement illégal d’une norme suprême adoptée par référendum par une norme issue d’une assemblée restreinte constitue un coup de force institutionnel, rompant le lien direct entre le pouvoir constituant et le souverain, en violation manifeste de l’article 115 de la Constitution de 1793.
Conclusion de l’analyse de la CISDHJ : La République confisquée – un coup d’État permanent contre la souveraineté du peuple
Au fil des deux siècles qui succédèrent à la Révolution, chaque Constitution fut imposée « d’en haut », sans que le peuple n’ait jamais retrouvé, après 1793, la possibilité d’exercer pleinement son droit de consentement. La Constitution de 1791, quoique promulguée selon les formes légales, instaura un suffrage censitaire excluant l’immense majorité des citoyens. La suspension, le 10 octobre 1793, de la seule Constitution jamais ratifiée par référendum populaire laissa la place, en 1795, à la Constitution de l’An III — un véritable coup d’État juridique contre le souffle démocratique de la Convention.
Le Directoire ouvrit l’ère des régimes censitaires : la Constitution de l’an VIII, puis celles de l’An X et de 1814 sous la Restauration, validèrent tour à tour des structures de pouvoir concentré, non soumises à l’approbation populaire. La Monarchie de Juillet (1830) et la Deuxième République (1848) usèrent de plébiscites largement orientés pour légitimer leur ordre. Le coup d’État du 2 décembre 1851 rendit caduc le principe même d’un mandat constitutionnel non renouvelable, et la Constitution de l’An XII consacra un pouvoir personnel sans aucun mandat constituant.
Après la courte parenthèse de 1848–1851, tous les régimes du XIXᵉ siècle se contentèrent de valider des textes concoctés par l’exécutif ou par une majorité parlementaire restreinte, sans référendum véritable : la Constitution de 1875 résulta de tractations de coulisse et demeura, jusque dans sa promulgation, juridiquement viciée. Quant aux Constitutions de 1946 et de 1958, elles furent adoptées selon des procédures dérogatoires — ordinances, lois constitutionnelles en trompe-l’œil, plébiscites accompagnés de fortes pressions — contournant la règle fondamentale posée en 1793 que « les actes du pouvoir législatif ne peuvent être promulgués qu’au nom du peuple français ».
Jamais, hors 1793, le peuple n’a été invité à approuver un texte constitutionnel dans un cadre libre, éclairé et contraignant. Chaque nouveau régime a préféré maquiller sa légitimation sous des plébiscites partiels, des votes parlementaires tronqués ou des promesses de révisions futures, sans jamais rendre effective la souveraineté populaire. C’est ainsi qu’a perduré, de 1791 à 1958, une usurpation systématique du pouvoir, fondée sur un dol constitutionnel et privant les Français d’un véritable contrat social.
Il est aujourd’hui indispensable de rompre avec cette tradition d’imposture : redonner au peuple le pouvoir constituant, rétablir une procédure de ratification réellement démocratique et garantir que toute future Constitution naisse d’un référendum libre, égal et sincère. Surtout, il faut reprendre les principes et dispositions de la Constitution de 1793 — notamment son article 61 (« les lois, les décrets, les jugements et tous les actes publics sont intitulés : Au nom du peuple français ») — afin de briser la dictature administrative pilotée par des faux élus et des usurpateurs, et de restaurer une légalité fondée sur la souveraineté populaire.
Une succession de coups d’État constitutionnels
Depuis 1791, l’histoire constitutionnelle française est jalonnée de ruptures illégales, de régimes imposés sans consentement populaire, et de manipulations institutionnelles opérées par le haut. À l’exception de la Constitution du 24 juin 1793, issue d’un véritable suffrage universel direct, toutes les constitutions postérieures furent le fruit de coups d’État politiques, militaires ou législatifs. Qu’il s’agisse de la monarchie constitutionnelle de 1791, des constitutions imposées par Napoléon, des restaurations monarchiques, ou encore des républiques installées par plébiscite ou manipulation législative, toutes ont été imposées sans respect de la souveraineté populaire.
| Année | Nom de la Constitution | Forme de gouvernement | Mode d'adoption | Nature du changement | Légitimité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1791 | Constitution de 1791 | Monarchie constitutionnelle | Vote par l'Assemblée constituante | Rupture avec l’absolutisme | Illégitime : pas de référendum populaire |
| 1793 | Constitution de l’an II (1793) | République démocratique | Référendum populaire (1,8 M de OUI) | République populaire, souveraineté directe | Légitime : référendum universel masculin |
| 1795 | Constitution de l’an III (1795) | Directoire | Vote par la Convention, plébiscite restreint | Contre-révolution contre 1793 | Illégitime : contraire à 1793 |
| 1799 | Constitution de l’an VIII (1799) | Consulat (Bonaparte) | Coup d’État du 18 Brumaire, plébiscite organisé | Concentration du pouvoir (Bonaparte) | Illégitime : usurpation militaire |
| 1804 | Constitution de l’an XII (1804) | Empire (Napoléon Ier) | Plébiscite | Transformation du Consulat en Empire | Illégitime : régime personnel |
| 1814 | Charte constitutionnelle de 1814 | Monarchie restaurée (Louis XVIII) | Octroi par le roi, sans référendum | Restauration monarchique post-napoléonienne | Illégitime : sans consentement populaire |
| 1830 | Charte révisée de 1830 | Monarchie de Juillet (Louis-Philippe) | Révision de la Charte par ordonnance | Révision libérale mais monarchique | Illégitime : absence de souveraineté populaire |
| 1848 | Constitution de 1848 | Deuxième République | Élection d'une Assemblée constituante | Retour au suffrage universel | Relativement légitime : élu par le peuple |
| 1852 | Constitution de 1852 | Second Empire (Napoléon III) | Coup d’État du 2 décembre, plébiscite organisé | Consolidation autoritaire du pouvoir impérial | Illégitime : coup d’État constitutionnel |
| 1875 | Lois constitutionnelles de 1875 | Troisième République | Adoption parlementaire sans référendum | Stabilisation post-Commune | Illégitime : élite parlementaire sans peuple |
| 1946 | Constitution de 1946 | Quatrième République | Auto-ratifiée par le GPRF, référendum tronqué | Usurpation du pouvoir constituant par le GPRF | Illégitime : Coup d'Etat de De Gaulle |
| 1958 | Constitution de 1958 | Cinquième République | Loi d’habilitation du 3 juin 1958, projet imposé par le gouvernement, référendum illégal | Violation de l’article 90 de la Constitution de 1946 | Illégitime : coup d’Etat de De Gaulle |